Barbara Stiegler est professeur de philosophie politique à l’université Bordeaux-Montaigne et responsable du Master « Soin, éthique et santé ». Initialement spécialisée en philosophie allemande et dans les philosophies de la vie et de la biologie, elle a notamment publié Nietzsche et la biologie (Paris, Puf, 2001) et Nietzsche et la critique de la chair (Paris, Pur, 2005). Depuis plusieurs années, elle étend ses recherches à la philosophie politique, en s’intéressant aux croisements entre le biologique et le politique, notamment dans le champ de l’éducation et de la santé et à la lumière de l’histoire des libéralismes et de la démocratie. L’ouvrage « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel impératif politique (Paris, Gallimard, 2019) est le dernier résultat de ce chantier intellectuel en cours.
A : Nietzsche et Foucault comme précurseurs de la pensée généalogique
Actu-Philosophia : Barbara Stiegler, seriez-vous d’accord avec l’idée que votre livre a pour ambition de décrire plus que de dénoncer l’idéologie néolibérale ?
Barbara Stiegler : J’ai en effet des réserves avec les attitudes de dénonciation. Par exemple dans mon enseignement, je reprends régulièrement les étudiants qui disent que Nietzsche dénonce ou qu’il condamne. J’estime, en effet, que quand un travail est proprement philosophique, il ne s’agit pas, en tout cas, en première instance, de dénoncer. Il s’agit dans un premier temps, de comprendre et de construire une question.
Par conséquent, si je me suis intéressée dans un premier temps au néolibéralisme, c’est parce que je pense qu’il nous pose des questions très difficiles et parce qu’il y a une puissance de cette pensée qu’il faut reconnaître. Avant d’en faire un ennemi extrêmement simple qu’il suffirait d’abattre d’une formule, il me semble qu’il faut faire tout un travail, toute une exploration parce que ma conviction, est que, et ça c’est très nietzschéen, alors même que le néolibéralisme est à nos yeux quelque chose d’extrêmement dangereux, qui a des effets délétères, pourtant il nous imprègne et nous envahit intimement. Le problème de la dénonciation, c’est que ça consisterait à dire que cela ne nous concerne pas. Ce n’est pas philosophique comme attitude. La philosophie suppose de prendre un phénomène au sérieux au sens où l’on comprend que l’on est pris dedans, que l’on est compris dans la chose. C’est ce que Nietzsche a fait avec le christianisme, il sait qu’il est imprégné de christianisme. Et au lieu de le condamner, il en fait l’analyse et il essaie de voir pourquoi c’est si puissant. C’est plutôt mon attitude. C’est la raison pour laquelle il y a toute une dimension du livre qui endure la complexité du phénomène et qui est donc entièrement descriptive.

Mais en même temps que je suis descriptive, je suis toujours dans l’évaluation, c’est-à-dire que je ne crois pas qu’on puisse, quand on fait du travail philosophique, y compris académique à prétention scientifique, avoir le discours du spectateur impartial objectif et désengagé. Comme Nietzsche, je n’y crois pas une seconde. Quand on travaille à une opération de connaissance, on est affecté, on est intéressé à la chose et on porte des jugements de valeur. Mon livre est imbibé de jugements de valeur en permanence, mais je ne veux pas que ces jugements de valeur soient des anathèmes, des condamnations, je veux que ce soit un travail d’évaluation fin et toujours en même temps descriptif.
AP : En quoi le débat, vieux d’un siècle, entre Lippmann et Dewey nous concerne-t-il aujourd’hui ?
BS : Le livre, extérieurement, parle des années 1910 à 1930, sauf que j’explique clairement dans l’introduction que ma démarche est généalogique. J’emprunte ce terme de « généalogie » à Foucault qui lui-même l’emprunte à Nietzsche. La généalogie est le fait de plonger dans le passé au service d’un diagnostic du présent et pour essayer de penser notre présent. Le terme « diagnostic » est un terme médical important : de quoi notre temps souffre-t-il ? D’ailleurs dans le sens courant du terme « généalogie », par exemple la généalogie familiale, il s’agit bien de se plonger dans le passé pour comprendre notre identité d’aujourd’hui. D’où le caractère étrange du livre qui parle d’une pensée dominante aujourd’hui en ne parlant que des années 1910 à 1930.
AP : Vous vous situez comme héritière des travaux de Foucault ; pourriez-vous préciser le lien d’inspiration que vous entretenez avec lui ainsi qu’éventuellement les divergences ?
BS : Ce livre n’existerait pas s’il n’y avait pas eu le travail préalable de Michel Foucault et de tous ceux qui s’en sont inspirés. Je pense en particulier à son cours de 1978-1979 : Naissance de la biopolitique[1] qui, en dépit de son titre, est assez peu un cours sur la biopolitique (il n’en parle que les trois premières leçons). C’est en réalité un cours sur le néolibéralisme. J’ai lu ce cours parce que j’entreprenais cette enquête sur le néolibéralisme.
Foucault permet d’y voir plus clair et notamment de clarifier une contradiction dans l’usage du terme néolibéral. Ce que l’on appelle, dans le sens courant, « néolibéralisme », c’est un retrait de l’Etat. Or, dans le même temps, on va appeler néo-libérale une réforme de la santé ou de l’éducation dans laquelle l’action de l’Etat est extrêmement invasive, tatillonne et constamment présente pour modifier les pratiques et les conduites par toute une série de normes et de codifications. Alors l’Etat n’agit pas seulement pour des considérations économiques, mais pour transformer le rapport au temps, au travail, à l’éducation, autant de choses qui touchent à une anthropologie fondamentale. L’Etat néo-libéral est-il en retrait ou, au contraire, omniprésent ? Cette énigme, celle d’une désignation paradoxale de ce phénomène politique ne me satisfaisait pas. C’est pourquoi j’ai voulu comprendre. Et le cours de Foucault m’y a aidée quand je l’ai lu en 2008, quatre ans après sa publication. C’est grâce à sa lecture que j’ai découvert le rôle central de l’essayiste américain Walter Lippmann et que j’ai décidé de le lire, lecture qui a été l’élément déclencheur de mon propre livre.
Mais je dois aussi à Foucault la notion de biopolitique. La biopolitique est le moment où le politique fait de la vie (la démographie, la santé, l’urbanisme, le rapport aux ressources alimentaires, toutes les questions de population) son objet fondamental. On a là une très longue histoire politique multiséculaire. La biopolitique apparaît néanmoins très récemment. Presque soudainement les gouvernements se mettent à se passionner pour la vie des populations. Foucault a merveilleusement bien décrit ce renversement, cette transformation. Cela émerge durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui est aussi le moment du décollage sanitaire de l’occident. Il lance ce chantier de la biopolitique qui va être enrichi par la découverte d’autres types de biopouvoirs. Il va regarder comment cela se passe à l’hôpital également notamment dans Surveiller et punir.

Mais, au moment où il s’engage dans sa réflexion sur le néolibéralisme dans son cours sur la biopolitique, il abandonne paradoxalement la biopolitique. Il souligne lui-même à un moment de son cours qu’il avait prévu de parler de la biopolitique mais qu’il a finalement plus parlé de néolibéralisme et en particulier du courant ordolibéral allemand. Or, le courant allemand rejette toute référence à la nature et c’est en cela qu’il tranche avec le libéralisme classique qui faisait confiance à la bonne nature des hommes, des échanges et du marché censés produire une forme d’harmonie. Pour Foucault, l’ordolibéralisme allemand est un antinaturalisme qui rejette toute référence à la biologie, et la question de la biopolitique semble dès lors se dissoudre. Mais cette conclusion ne me satisfaisait pas. J’ai imaginé qu’il devait y avoir quelque chose d’autre dans le néolibéralisme parce que j’entendais dans la ritournelle de nos manières de vivre actuelles imprégnées de néolibéralisme qu’il faut s’adapter, suivre l’évolution, survivre à la sélection et à la compétition… j’entendais un discours confusément inspiré de l’évolutionnisme darwinien dont Foucault ne rendait pas du tout compte. C’est un peu à la recherche de tout cela que je suis allé lire les textes eux-mêmes.
Je suis donc tombée sur le livre de Lippmann, The Good Society[2], celui qui a lancé le courant néolibéral à l’occasion du colloque Lippmann de 1938. Et là, à ma stupéfaction, j’ai découvert que tout l’arrière-plan théorique du nouveau libéralisme de Lippmann était évolutionniste. Il se référait systématiquement à la révolution darwinienne et il entendait imposer une refondation complète du libéralisme à partir des acquis de la révolution darwinienne. Pour moi, et en rupture avec Foucault sur ce point, cela a relancé le chantier de la biopolitique appliqué cette fois au néolibéralisme.
AP : Pour mener à bien votre recherche, vous vous intéressez au texte et c’est incontestablement le travail du philosophe. Mais une question se pose, c’est la question du rapport entre les textes programmatiques à la Lippmann et le fait politique.
BS : C’est une question qui m’a énormément tourmentée durant des années. Voici la position à laquelle je suis finalement arrivée. Je crois qu’il serait tout à fait naïf d’imaginer que les grands textes philosophiques ou les textes mineurs sont des causes de ce qui nous arrive. Il peut y avoir des textes qui déclenchent des événements historiques ou qui vont aider à les déclencher. Mais c’est rare. La plupart des textes ont des effets considérables mais très pluriels et difficiles à mesurer.
Pourquoi alors s’intéresser à Lippmann ? Parce qu’un bon texte ou un grand texte a cette capacité assez inouïe à cristalliser merveilleusement bien ce qui se passe à un moment. Lippmann a parfaitement saisi des forces qui étaient en train de se mettre en place. Et cela a un effet de clarification. De la même manière, je ne pense pas que le cogito de Descartes soit la cause des temps modernes et du primat de la subjectivité. Mais quand on lit les deux premières Méditations on voit comme dans du cristal ce que sont les temps modernes. C’est juste ça, mais c’est déjà beaucoup et justifie pleinement que l’on passe tant de temps à lire des textes.
B : Darwin et le darwinisme dans la pensée néolibérale
AP : L’approche évolutionniste substitue à une forme de progrès orienté par la raison humaine, des mécanismes déterminés par le hasard et la nécessité. Ne pensez-vous pas que l’introduction du darwinisme en sciences sociales signe ce que l’on pourrait appeler une sorte de tournant hétéronome de la pensée du social ? L’homme cesse alors de se penser libre et actif pour se considérer comme passif et déterminé par les impératifs de l’évolution. N’est-ce pas une rupture majeure avec la pensée des Lumières ?
BS : Avant de répondre, je me permets de faire une précision historique nécessaire. La révolution darwinienne, c’est 1859 et les années qui suivent. C’est une révolution parce que c’est un choc considérable non seulement par l’idée que la vie évolue, mais parce que le grand choc du darwinisme est que son mode d’explication est si puissant qu’il devrait pouvoir rendre compte de toute chose, y compris de l’humain, de notre histoire, de notre morale et de notre organisation sociale.
Les années qui vont suivre les travaux de Darwin sont vraiment sous le choc de cette histoire qui change tout. Certains philosophes vont être prêts à envisager que nous sommes une espèce ayant une histoire évolutive et qu’on ne peut pas séparer ce qui relèverait de la nature de ce qui relèverait de la liberté. Ils remettent en cause la partition kantienne entre le monde de la nature et le monde de la liberté. Deux lignées vont donc s’opposer du fait du choc darwinien entre ceux qui pensent que la révolution darwinienne nous concerne et ceux qui estiment qu’elle n’a pas d’impact sur la compréhension de la vie humaine.
Les philosophes qui m’ont passionnée ont fait le choix de la biologisation de l’anthropologie, c’est-à-dire d’accepter le tournant darwinien. Pour donner des noms : c’est Nietzsche, Bergson, Canguilhem, James, Dewey. Ce sont des philosophes qui ont décidé de voir ce que la révolution darwinienne voulait dire pour nous.
Ce qui est passionnant est que lorsque l’on se penche sur ces philosophies de la vie, sur ces philosophies de la biologie, c’est qu’elles contestent la variante mécaniciste du darwinisme et qu’elles considèrent que les darwiniens mécanistes passent à côté de la vie et passent peut-être à côté de Darwin lui-même parce qu’il y aurait autre chose dans L’Origine des espèces, une autre vision beaucoup plus créatrice que mécaniste. Par exemple, chez Darwin, il n’y a pas de lois de la nature. S’imaginer que la révolution darwinienne consisterait à dire que tout serait dorénavant soumis aux lois de la nature est une erreur. Il y a un rôle fondamental du hasard, une créativité de l’évolution, une imprévisibilité fondamentale de l’évolution.
Cela ouvre les choses et déplace le curseur de la liberté vers des phénomènes antérieurs à ce que l’on considérait comme le lieu de la liberté jusqu’à présent, à savoir : la volonté du sujet conscient. Peut-être que dans la vie il y a déjà de la liberté, de la créativité et des renversements imprévisibles. Peut-être que la vie est déjà un phénomène essentiellement marqué par la liberté et c’est justement ce que pensent Nietzsche et Bergson. Cela renverse tous les grands partages habituels.
AP : On a souvent tendance à avoir Spencer en tête quand on pense à l’application de l’évolutionnisme darwinien au social, mais en réalité ce que montre ton ouvrage, c’est qu’il n’y a pas un mais des évolutionnismes appliqués à la société. Qu’en pensez-vous ?
BS : Le darwinisme est assez mal connu des philosophes contemporains à part en philosophie des sciences bien sûr. Cela s’explique par le grand partage que nous avons évoqué entre les philosophes favorables à l’utilisation de Darwin pour penser l’anthropologie et ceux qui considèrent que son usage n’est pas pertinent. Ce débat a été apparemment tranché par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale quand on a découvert ce qu’était le biologisme nazi et les désastres auxquels il conduisait immanquablement. A partir de là, il est devenu impossible de se référer à la biologie quand on parlait de morale ou de politique, en particulier en Europe. Tout emprunt au biologique dans le champ du social ou du politique est devenu tabou, ce qui a fait gagner la lignée favorable au maintien de la partition entre monde biologique et monde humain.
En réalité, quand on s’intéresse de près au darwinisme et que l’on replonge dans ces philosophies de la vie, on découvre que le darwinisme est un continent passionnant où il y a toute une série de conflits, de controverses et de pensées s’opposant les unes aux autres.
Pour ce qui est de Lippmann, il a retenu de Darwin que ce qui était central pour comprendre l’évolution naturelle c’est qu’elle se produisait par la sélection graduelle de petites variations au cours de l’histoire du vivant. Le critère de la sélection naturelle est que ces petites variations sont favorables ou utiles, c’est-à-dire qu’elles permettent à l’organisme de mieux s’adapter aux conditions de son environnement, schéma explicatif qui selon Lippmann rend parfaitement compte de tous les phénomènes vivants, y compris sociaux et politiques. Mais par rapport au cadre darwinien, Lippmann fait un pas de plus. Son hypothèse est qu’à partir du moment où l’espèce humaine a déclenché elle-même la révolution industrielle et la mondialisation des échanges, elle a créé une situation nouvelle et en rupture où les modes de fonctionnement darwiniens ne pouvaient plus marcher. Tandis que Spencer croyait que la société industrielle adviendrait par les lois de la vie, Lippmann, comme tous les contemporains de la crise du capitalisme avancé, celle qui culminera dans la Grande Dépression, se dit que quelque chose ne marche pas. La thèse de Lippmann est que Jusqu’à cette rupture brutale nous avons, comme les autres animaux, évolué sur un mode graduel en nous adaptant à des environnements locaux relativement stables avec des rythmes lents. Il faut rappeler ici que Darwin est tributaire d’une conception géologique de la temporalité qu’il emprunte à Charles Lyell. C’est pourquoi il est gradualiste. Les processus évolutifs sont très lents et se font toujours pas petites touches. Or le milieu de vie de l’homme moderne n’est plus relativement fermé comme l’étaient les autres écosystèmes et les rythmes de cet environnement artificiel sont en accélération constante. Cette situation crée pour Lippmann un cadre où pour la première fois dans l’histoire de la vie, on a affaire à une espèce totalement inadaptée à son propre environnement. La réponse de Lippmann va être de tout mettre en œuvre artificiellement pour répondre à cet objectif de l’évolution qui est qu’est l’adaptation. Il faut passer par l’artifice de la politique de l’Etat et de la loi qui vont avoir comme mission fondamentale, comme agenda, de réadapter l’espèce humaine à son nouvel environnement. Voilà pourquoi Lippmann est à la fois darwinien et au-delà de Darwin.
Le naturalisme de Lippmann est un peu particulier car c’est un naturalisme de la rupture. Pour lui le laisser-faire des libéraux classiques, la confiance dans les processus naturels spontanés, ne suffit plus. Il faut avoir recours à l’Etat et à ses artifices et c’est en cela qu’il faut imaginer un nouveau libéralisme qui va littéralement transformer l’espèce humaine pour la rendre apte à vivre dans cet environnement nouveau.
AP : Quid alors du rapport entre Spencer que j’évoquais dans ma question comme figure la plus connue du darwinisme social et Lippmann ?
BS : Le rapport de Lippmann à Darwin passe massivement par Herbert Spencer. Herbert Spencer est un des derniers savants universels de notre histoire qui a une influence considérable à la fin du XIXe et début du XXe siècle, notamment aux Etats-Unis. Son idée était effectivement de transposer tout en les déformant les principes de Darwin dans les sociétés humaines. Lippmann emprunte beaucoup à Spencer même s’il refuse les conclusions de Spencer.
Pour Spencer, il suffit de laisser faire les processus darwiniens pour que la société s’adapte. Il faut donc que l’Etat se retire au maximum et qu’il n’assure que ses missions régaliennes strictes sinon il va venir perturber le jeu. Spencer va soutenir une sorte d’ultra-libéralisme qui prône l’Etat minimal des futurs libertariens au XXe siècle. On est dans une vision dérégulatrice.
Il faut laisser faire le marché et les choses iront vers la fin ultime de l’évolution celle de la grande société industrielle dans laquelle les membres de l’espèce humaine sont à la fois dans des relations de coopération et de compétition. Alors l’espèce humaine échappera à toute forme de conflit comme dans une immense horloge où tout serait parfaitement ajusté, grâce à la division mondialisée du travail.
Lippmann refuse l’idée qu’il suffirait de laisser faire, d’où le fait que son nouveau libéralisme soit marqué par le retour de l’Etat. Mais là où il est complètement spencérien c’est qu’il pense qu’il y a une fin de l’évolution. La fin de l’évolution, c’est la Grande Société industrielle, elle-même réduite à la division mondialisée du travail. Ce faisant Lippmann et Spencer trahissent totalement la pensée de Darwin pour qui il n’y a justement plus de fin ultime de l’évolution, leçon que Nietzsche retiendra pour toute histoire en général, y compris l’histoire humaine. Il y a une multiplicité de fins qui sont des directions provisoires et locales qui sont sans cesse rediscutées ou transformées. La vie part dans toutes les directions, elle est multidirectionnelle. L’évolution ne ressemble pas à un arbre mais à un buisson, elle est buissonnante. C’est donc un paradoxe d’avoir tiré comme conséquence de la révolution darwinienne une nouvelle téléologie qui nous raconte un nouveau grand récit sur la fin de l’histoire exactement comme dans les philosophies de l’histoire et les socialismes révolutionnaires. C’est pourtant ce que fait, depuis maintenant près d’un siècle, le nouveau libéralisme des « néolibéraux ».
AP : Pourrait-on revenir sur l’opposition entre Lippmann et Dewey concernant l’évolutionnisme. Pourriez-vous rappeler la différence entre la version lippmannienne et la version deweyenne du darwinisme ?
BS : J’ai découvert durant mes recherches que Lippmann avait croisé sur son chemin un redoutable contradicteur, un des plus grands philosophes américains de son siècle : John Dewey. Il a compris la puissance de la proposition politique de Lippmann mais l’a systématiquement déconstruite. Or pour mener cette déconstruction, Dewey oppose à Lippmann le véritable sens de la révolution darwinienne. Il montre qu’il est fondamentalement spencérien quand il reconduit le contresens téléologique de Spencer si bien critiqué par Bergson dans L’Evolution créatrice. Dewey va également opposer à Lippmann, lui aussi, un nouveau libéralisme mais qui aura un sens complètement différent. J’ai ainsi découvert deux nouveaux libéralismes en conflit qui se référaient de manière complètement opposée à la révolution darwinienne.
C : Les nouveaux libéralismes et la démocratie libérale
AP : Au chapitre 6, vous considérez l’idée lippmannienne selon laquelle la compétition équitable (fair) doit être encadrée par des règles qui doivent être suivies avec fair-play comme une version néo-libérale de l’égalité des chances. Mais rend-on justice au concept d’égalité des chances quand on le définit comme le fait d’avoir tous le droit de concourir selon des règles équitables à un système de compétition généralisé ? Est-ce qu’il n’y aurait pas d’autres versions de l’égalité des chances qui auraient vocation à corriger certains des biais que la compétition non-faussée tend à renforcer à travers, par exemple, l’accès gratuit de tous à l’éducation, la mise en place d’aides spécifiques pour que les personnes handicapées aient les mêmes opportunités que les autres de prendre les transports en commun, de visiter un musée ou d’avoir un emploi ? Pour le dire synthétiquement, est-ce que toute invocation de l’égalité des chances serait entachée de l’aspiration néo-libérale à faire sélectionner les meilleurs compétiteurs ?
BS : Surtout pas. Ce qui est passionnant dans le long débat de Lippmann et Dewey sur une multitude de sujet, c’est notamment leurs discussions sur l’égalité des chances. L’égalité des chances, c’est également une expression de Dewey, mais elle ne veut pas du tout dire la même chose. L’expression c’est « equality of opportunity ». Quelles sont différentes massives entre ces deux conceptions de l’égalité des chances de ces deux nouveaux libéralismes ? Cela me paraît crucial parce qu’aujourd’hui on a ces deux sens qui sont utilisés à tort et à travers ce qui fait que l’on ne sait plus de quoi on parle.
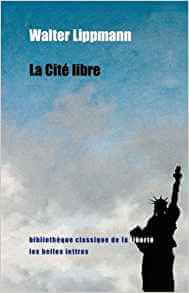
Pour Lippmann, l’égalité des chances, c’est l’égalité des chances dans un jeu – d’où le terme de « chances » d’ailleurs. Ce jeu est défini comme une compétition obligatoirement fair-play selon des règles établies où il y a forcément des gagnants et des perdants. Il s’agit de sublimer, de canaliser et de dépasser les formes de la violence et du conflit social. Cette compétition, il faut le souligner, est en même temps une coopération exactement comme sur le terrain sportif.
L’égalité des chances pour Dewey, ce n’est pas l’égalité des chances dans un jeu, c’est l’égalité dans les possibilités d’expression des potentialités de la vie humaine dans ce qu’elles ont de plus large et de plus ouvert. Puisqu’aucune direction n’est jamais donnée, le grand laboratoire expérimental qu’est la vie se cherche depuis toujours des directions plurielles et elle le fait par tâtonnement et démarche d’essais/erreurs. Ce qui s’est passé avec l’espèce humaine, c’est que les mécanismes de tâtonnement se sont mis à ne plus fonctionner parce que l’humain était trop déficient pour survivre. L’humain a dû façonner un nouvel organe qui n’avait pas cette fonction dans la vie animale, et il s’agit pour Dewey de l’intelligence, qui prend chez l’homme une forme collective. L’intelligence collective est venue en quelque sorte compenser les déficiences de l’espèce humaine, notamment sa néoténie qui fait qu’elle est toujours en retard, en formation. L’espèce humaine a réussi à faire de cet état de fait une chance en « exaptant », comme le dit Stephen Jay Gould, l’intelligence individuelle animale pour en faire une intelligence collective. Pour Dewey, l’intelligence collective a au fond pris le relais de la sélection naturelle pour procéder à un contrôle beaucoup plus fin des causes et des conséquences.
Or aujourd’hui, on est imprégné de la conception néo-libérale de l’égalité des chances. L’égalité des chances est vue, notamment dans l’éducation, comme une façon de former les enfants à être compétitifs sur le marché de l’emploi et on voit l’opportunité comme une façon d’être gagnant ou perdant. Mais les règles du jeu devraient, elles-mêmes, être discutées démocratiquement sur le plan politique. Or nos gouvernants tendent à nous imposer comme acquise l’idée que tout doit être organisé comme un moyen de favoriser l’accès de tous à la compétition non-faussée. Ce jeu qu’on nous impose n’est au fond pas un jeu décidé par notre intelligence collective, et il est même ce qui détruit les conditions d’une véritable socialisation de l’intelligence.
AP : Vous montrez que Lippmann développe, au sein de la Grande Société mondialisée, une conception de la démocratie représentative ayant nécessairement recours à la technocratie et au savoir expert. Face à lui, Dewey propose une conception alternative de la démocratie fondée sur un appel aux publics et à la communauté délibérante. Que pouvez-vous dire de cela ?
BS : Lippmann développe en effet une conception spécifique de la démocratie qui me semble dominante aujourd’hui. Cette conception est que comme les choses ne fonctionnent pas bien, il faut que l’Etat revienne dans le jeu pour réadapter les populations et il faut le faire non pas par la violence mais avec le consentement de ces populations. Sauf que ce consentement, il ne faut pas le recueillir, mais le fabriquer et à l’échelle d’une fabrication industrielle. C’est le thème lippmannien de la manufacture ou de la fabrique du consentement (The Manufacture of Consent). L’idée est bien de fabriquer à l’échelle industrielle, par tous les moyens que nous donnent les médias de masse et les industries culturelles, le consentement des populations aux exigences de son nouvel environnement mondialisé. C’est une conception de la démocratie où les gouvernants sont des leaders qui mènent les populations. Mais comme ces leaders ne sont pas outillés pour comprendre la complexité de la Grande Société, ils ont besoin en permanence de faire appel à des experts. Lippmann théorise donc une démocratie qui est un gouvernement des leaders et des experts, et dans laquelle les populations sont conçues comme des masses malléables mais en même temps trop rigides, et qu’il faut donc transformer en un matériau flexible.
Dewey considère que Lippmann a complètement manqué le sens évolutionniste de la démocratie celle d’être cette organisation politique dans laquelle l’intelligence collective s’organise. Ce que Lippmann ne comprend pas, c’est que la démocratie prend le relais de l’évolution du vivant en étant un processus profondément expérimental. Pour que ce processus expérimental opère, il faut que ceux qui mènent l’expérimentation soient à la fois agissant et affectés par l’expérimentation qu’ils mènent. Inversement, la conception lippmannienne de la démocratie conduit à déconnecter complètement les leaders assistés des experts qui sont seuls actifs et la population qui est une cible passive. Cette déconnexion détruit, selon Dewey, des conditions de toute expérimentation, qui implique au contraire la participation continue des publics. On a ainsi chez Dewey la première grande définition philosophique de la démocratie participative.
AP : On considère souvent que le libéralisme promeut une forme de neutralité axiologique concernant les finalités que chacun donne à sa vie et qu’il permet à chacun de vivre selon sa propre représentation de la vie bonne. Mais vous montrez que le néo-libéralisme impose, au contraire, de façon paternaliste, une certaine conception de la vie à travers un programme visant à réformer les cadres traditionnels de l’existence humaine. Le néo-libéralisme lippmanien, n’est-il pas, paradoxalement, illibéral ?
BS : Il faut revenir ici au titre de l’ouvrage princeps du courant néolibéral qui est le livre de Lippmann de 1937 traduit en français en 1938 La cité libre, mais il faut revenir aussi au titre original anglais, qui nous dit que c’est une enquête sur les principes de la bonne société (The good Society). Il faut prendre cela très au sérieux. Il y a bien une conception téléologique de l’histoire : on sait où l’on va, c’est extrêmement normatif. C’est en rupture avec le discours des libéraux sur la neutralité axiologique. Il n’y a aucune neutralité axiologique dans ce nouveau libéralisme : il y a des comportements bons et d’autres qui ne le sont pas, la voix est tracée.
Or, c’est vrai, il y a, dans le libéralisme de Lippmann, des choses qui menacent le libéralisme et c’est précisément ce que va lui objecter Dewey. Dewey objecte à Lippmann qu’il est lui un véritable libéral non pas parce que la liberté serait garantie par cette soi-disant « neutralité axiologique ». Parce que Dewey est un philosophe de la valeur, il ne pense pas que l’on puisse vivre sans évaluer. Si Dewey est libéral, c’est parce qu’il pense que la vie passe son temps à produire des évaluations multiples et multidimensionnelles.
Pour Dewey, il faut revenir au libéralisme des origines et à ce qu’il y avait d’émancipateur dans le libéralisme des origines, et c’est pourquoi il a promu un nouveau libéralisme. Mais le libéralisme est, pour lui, ce qui rend possible les déviations, la possibilité de faire un écart. Il considère que tous les enfants portent avec eux cette capacité de déviation qu’il appelle l’impulse. L’enjeu est de préserver cet impulse des habitudes stabilisatrices du groupe avec ses règles, ses lois, ses coutumes, habitudes stabilisatrices qui elles aussi sont nécessaires, et qui sont donc dans une tension tragique perpétuelle avec l’impulse…
Mais l’erreur du libéralisme est de croire que l’individu pourrait développer ces propriétés de déviation tout seul, alors que tout cela n’est possible que par la vie sociale et par l’intelligence collective. C’est pourquoi Dewey se considère à la fois comme libéral et comme socialiste parce qu’il pense qu’il faut non seulement faire une critique de la façon dont sont organisés les moyens de production mais aussi les moyens de connaissance qui ont tendance à être concentrés dans les mains d’une élite, détruisant les conditions de l’expérimentation collective. Il est à la fois libéral et socialiste parce qu’il veut faire une critique au nom du social de l’individualisme atomiste.
AP : La question du rôle et du statut de l’Etat dans votre travail peut sembler problématique, pourriez vous clarifier ce point ? En effet, dans une recension de votre livre paru sur Erudit.org, Jean-Fabien Spitz écrit la chose suivante : « Le mot d’ordre de ce livre est donc — sans jeu de mots — un antistatisme de principe, une prise de position contre l’État, paradigme de la stase et de l’anti-flux, une prise de position contre toute volonté de régler l’évolution, de lui donner une forme en accord avec des idées d’égalité et de justice. » Êtes-vous d’accord avec la façon dont il restitue votre propos ?
BS : Il y a là un malentendu. En effet, mon point de vue n’est pas de critiquer l’Etat parce que les néolibéraux lippmanniens seraient étatistes. Par ailleurs, ce qui m’a intéressé dans ce que raconte Dewey, c’est qu’il s’agit justement d’une théorie de l’Etat. Le terme d’Etat est décisif dans la théorie politique de Dewey. Pour Dewey, la politique commence parce qu’on a besoin d’un Etat et de tout ce qui va avec l’Etat : des fonctionnaires et une organisation étatique pour incarner l’intelligence collective et rendre possible l’existence des publics. L’existence des publics n’est pas spontanée mais est extrêmement fragile. Ce n’est pas quelque chose d’assuré et qui se ferait tout seul automatiquement. Ce n’est donc pas quelque chose qui peut se passer de l’Etat. Mais, c’est vrai, l’Etat n’a, chez Dewey, rien à voir avec l’Etat central français, c’est une toute autre forme d’Etat : l’Etat est la puissance collective, mais résolument décentralisée.
Conclusion
AP : En guise de conclusion, n’en finissez-vous pas par valoriser le flux dans sa version deweyenne plutôt que la stase ? Ne peut-on pas reconsidérer les bienfaits de la stase ?
BS : C’est là aussi un malentendu puisque ce que j’objecte à Lippmann avec Dewey, c’est précisément qu’il néglige la tension tragique, nécessaire et impossible à surmonter entre flux et stase. Avant Dewey, Nietzsche est un des grands penseurs de l’apparition du flux absolu et qui a vu que la vie supposait à la fois d’affronter le flux du devenir en même temps qu’elle impliquait de manière vitale et nécessaire des stases. C’est l’un des aspects de la pensée de Machiavel qui fascine Nietzsche : le conflit impossible à résoudre entre l’Etat ou la stase qui veut durer, et le point de vue de la multitude, d’où peut surgir la liberté et la nouveauté. Lippmann a repris de Nietzsche cette valorisation du flux, mais il n’a absolument pas compris qu’il y avait une tension tragique nécessaire entre le flux et la stase. Il a transformé la tension tragique entre flux et stase en une hiérarchie où le flux serait supérieur aux stases qui, étant retardataires, seraient toujours inférieures et qu’il faudrait liquéfier. Ce faisant, il a en réalité trahi le flux lui-même, en le convertissant en un terrifiant statu quo : l’Etat final du monde mondialisé.
Ce qui m’a intéressée chez Dewey, c’est que j’y ai retrouvé la tension tragique nietzschéenne entre flux et stase dans un ouvrage qui n’est malheureusement pas encore traduit en français, il s’agit de Human Nature and Conduct. Il y théorise précisément la manière dont les sociétés humaines évoluent à partir de cette tension, c’est-à-dire à la fois la possibilité de dévier du fait de l’impulse en faisant de la place au nouveau, et puis, d’un autre côté, la nécessité d’incorporer dans des stases relativement durables et stables, dans des habitudes (habits), les états du groupe. Il n’y a pas de supériorité du nouveau sur l’ancien, du flux sur la stase.
Et c’est précisément la grande erreur du néolibéralisme qui oppose toujours les amoureux du flux aux retardataires attachés à la stase et qui renvoie tout ce qui en nous résiste au flux au camp du retard. C’est exactement le discours dominant actuellement sur les populismes. Toute forme de refus de l’agenda néolibéral est immédiatement disqualifiée comme populiste, c’est-à-dire archaïque, du côté de la stase, du retard. Ce manichéisme est un héritage profond du néolibéralisme lippmannien et c’est une de ses plus graves erreurs à laquelle j’oppose la tension tragique, nietzschéenne et deweyenne, entre le flux et les stases. Sur la base de cette reconnaissance, de toutes nouvelles questions politiques s’ouvrent devant nous : celle du conflit nécessaire entre la diversité des rythmes de vie ou des manières de vivre, ou de ce que j’ai appelé l’hétérochronie, dont la politique a peut-être justement pour tâche de rendre possible la coexistence.
[1] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979), Paris, Seuil/Gallimard, 2004
[2] Walter Lippmann, La société libre, Paris, Les Belles Lettres, 2011.







