Le dernier livre de Renaud Barbaras, Métaphysique du sentiment1 constitue à n’en pas douter à la fois un point d’étape fondamental dans l’œuvre de son auteur, et une contribution de grande importance à la réflexion phénoménologique contemporaine. Ouvrage d’une très grande densité, notamment dans la longue et profonde introduction, il se propose tout à la fois de défendre une métaphysique – en un sens fort différent de la recherche des raisons –, d’interroger la portée métaphysique de la poésie, de penser des concepts désormais riches de sens chez Renaud Barbaras comme la vie, la distance, le désir, mais aussi l’exil ou l’exode, et de s’expliquer avec des philosophes comme Merleau-Ponty, Michel Henry, Henri Maldiney ou encore Mikel Dufrenne. C’est là, sans grandiloquence, une nouvelle preuve en faveur du fait que Renaud Barbaras a construit une oeuvre, forte, puissante, singulière, dont nul phénoménologue ne saurait désormais faire l’économie.
A ce titre, et comme cela avait été clairement exposé dans Dynamique de la manifestation[Renaud Barbaras, Dynamique de la manifestation, Paris, Vrin, 2013. Cf. Recension à [cette adresse .[/efn_note], Renaud Barbaras creuse cette intuition profonde consistant à montrer que pratiquer la phénoménologie conduit inéluctablement à quelque chose de plus que la phénoménologie, cette dernière appelant son propre dépassement que l’auteur sonde inlassablement. C’est pourquoi il sera difficile de rendre compte de cet ouvrage qui envisage un champ si large qu’une recension ne pourra que le mutiler et n’en présenter que quelques aspects partiels, imparfaits et déformants. Nous essaierons néanmoins de rendre justice à la richesse du livre en proposant une analyse de ce qui nous a semblé majeur dans son élaboration, et extrêmement stimulant au cours de notre propre lecture.
A : La question du sensible et du « sentiment »
1°) Le sens du sensible
Le propos de Renaud Barbaras s’inscrit très explicitement dans les pas de Merleau-Ponty dont il est un des meilleurs spécialistes en France. A cet égard, la question de la perception et du sensible joue un rôle crucial dans toute son œuvre et s’établit de manière anti-objectiviste sur un terrain pré-objectif. Dès Le désir et la distance, le combat contre l’approche cartésienne de la perception du sensible était mené, Descartes étant présenté comme celui n’ayant pas perçu le fait que toute perception résulte d’une présence incarnée antérieure à l’acte perceptif. Aux yeux de Descartes, percevoir quelque chose signifie nécessairement appréhender une signification objective, au sens de ce qui est idéalement déterminable, « et la question de la perception devient alors celle de la faculté nous livrant accès à l’invariant d’une infinité de variations. »2 Dans une perspective pré-objective, il manque la dimension sensible constitutive de l’apparition perceptive ; autrement dit, et c’est crucial, la perception n’est pas qu’une intellection. Ainsi, « d’une certaine manière, toute la difficulté d’une philosophie de la perception réside dans cet écart, c’est-à-dire dans l’exigence de penser une identité qui ne relève pas d’une position de rendre compte d’une unité sensible, qui ne diffère pas de la diversité dont elle est l’unité. »3
Un peu plus loin, en discussion avec Husserl, R. Barbaras arrivait à l’idée fondamentale dans son œuvre que c’est dans le sensible que le monde peut préserver son irréductibilité. « C’est pourquoi parler d’un monde sensible relève de la tautologie : il n’y a de monde que comme sensible, il n’y a de sensible que comme présentation d’un monde. »4 Admirable est la constance de l’auteur qui, dans Métaphysique du sentiment, conserve cette approche affranchissant le caractère intrinsèquement sensible du monde de toute faculté transcendantale, de toute conditionnalité issue du sujet transcendantal, de toute « sensibilité » pour parler comme Kant. Si le monde nous apparaît sur le mode sensible, affirme Renaud Barbaras, s’il est un monde perçu « c’est parce qu’il est intrinsèquement sensible, parce que l’être sensible, c’est-à-dire la possibilité de se manifester sur le mode sensible, qualifie son être. »5 Ainsi, et peut-être plus clairement encore, « c’est dans la mesure où l’être est sensible qu’il peut être appréhendé comme sensible et on appellera alors sensibilité l’accès à l’être tel qu’il est, bref son mode propre d’apparaître. Ainsi, ce n’est pas parce que la réalité est sentie par la sensibilité qu’elle peut être qualifiée de sensible ; c’est au contraire parce qu’elle est intrinsèquement sensible qu’elle peut être sentie. »6
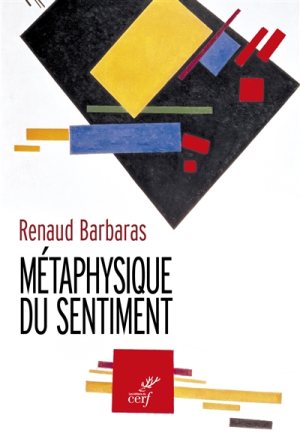
C’est là un point de départ extrêmement important et qui n’est pas sans rappeler la position de Merleau-Ponty qui, dans Le Visible et l’Invisible allait jusqu’à parler de « la généralité du Sensible en-soi »7, absolutisant donc le sensible en le rendant non relatif à la structure du sujet. De ce fait, parce que le monde est absolument sensible, le sujet est comme condamné en retour à s’y rapporter par les sens, le mode d’accès au monde étant une réponse à la structure en-soi du monde et non une continuation de la structure même du sujet.
2°) Discussion de ce sens
Cette approche du sensible est cruciale et structure selon nous l’œuvre de Renaud Barbaras ; en même temps, elle ne va pas de soi, et soulève une difficulté logique autant que grammaticale. Du point de vue logique, d’abord, la démarche de Merleau-Ponty et de Renaud Barbaras consiste à envisager le rapport du sujet au monde comme un effet de ce que le monde est en-soi, comme une manière de s’y rapporter découlant de la structure absolue de ce dernier. Or, peut-être pourrait-on se demander comment l’on sait que notre rapport sensible est un effet de la structure du monde. Il y a là comme une affirmation qui, si elle se comprend tout à fait dans le rapport spontané au monde pour lequel nous semblons bien sentir le monde parce qu’il est sensible, peut faire l’objet d’une prise de distance dès lors que l’on s’interroge sur la raison d’être de ce rapport. En d’autres termes, il nous semble que la preuve du caractère secondaire et dérivé du rapport sensible au monde pourrait être fortifiée. D’autre part, du point de vue grammatical, est sensible ce qui est perçu par les sens, ou ce qui peut faire l’objet d’une sensation. De ce fait, il est difficile de comprendre comment il serait possible de qualifier le monde de « sensible » indépendamment du fait de la sensation, indépendamment du fait que le sujet le sente. Pourquoi conserver un terme qui renvoie nécessairement au sujet sentant pour qualifier un monde décrit de manière précisément pré-objective ? Pourquoi ne pas plutôt parler d’un monde matériel, terme dont la grammaire n’implique pas la présence d’un sujet sentant, autorisant ainsi la possibilité d’une qualification du monde de manière absolue. Au fond, comment peut-on savoir que le monde non-senti, pris absolument, est sensible ?
En réalité, l’interrogation que nous formulons demeure prise dans les rais du savoir, et se demande donc si l’on peut connaître la nature intrinsèque du monde ; or, et cela est également fondamental, notre interrogation est quelque peu neutralisée par le propos de l’auteur car ce dernier ne prétend pas dire de manière objective ce que serait celle-ci. Ou, plus exactement, il nous semble possible de considérer que l’ontologie décrite n’est pas celle d’un sujet sachant, ni même d’une res cogitans mais bien plutôt la description d’un sentiment qui, seul, ouvre à l’ontologie. Dans la deuxième partie de l’ouvrage est en effet thématisée la recherche d’un sentiment qui « enveloppe une dimension ontologique »8. Précisons : « L’ouverture du monde par le sentiment est la condition originaire de sa connaissance sous forme d’objets comme des émotions que peuvent susciter les objets. »9 Le sentiment est donc une dimension pré-cognitive et pré-affective du rapport au monde, il est « l’épreuve de la transcendance du monde dans son inaccessibilité fondamentale ; il est la découverte de la perte, non pas tant au sens de celle de quelque chose qui manquerait que comme perte faite épreuve, déchirement, vécu. »10
Bien que l’auteur ne le présente nullement ainsi, nous pourrions émettre l’hypothèse suivante : dire que le monde est sensible n’est pas le produit d’une connaissance objectivante, devant obéir aux lois classiques de l’objet, c’est peut-être une manière de faire l’épreuve d’un champ sensible infini qui, incessamment, se dérobe à nous. Autrement dit, j’éprouve le fait que le monde est sensible, et par cette épreuve d’un champ sensible infini, je m’ouvre à cela même qui m’excède et que je vais tenter de connaître. Toute réflexion sur le rapport de conditionnement entre la dimension intrinsèquement sensible du monde et mon rapport au monde est, dans cette optique, déjà postérieure au « sentiment », et déjà objectivée ; c’est pourquoi, d’ailleurs, R. Barbaras, montre que la distinction monde sensible / rapport sensible est déjà trop dualiste et déjà trop prise dans la scission sujet-objet. « Si l’être apparaît sur le mode sensible, il n’a plus besoin d’être senti à proprement parler et la question est donc plutôt celle du sens d’être d’un sujet capable, non plus de sentir ni, a fortiori, d’avoir des sensations, mais d’accueillir cet apparaître sensible, de lui correspondre ou de lui répondre. »11
Néanmoins, à supposer que notre interprétation du propos de R. Barbaras soit la bonne, à savoir que seul le sentiment permette d’éprouver comme telle la dimension intrinsèquement sensible du monde, il faudrait alors se demander si une telle lecture ne risque pas d’immuniser une telle thèse car, en se situant sur le terrain pré-objectif et même pré-affectif, toute objection rationnelle se trouve condamnée par avance car c’est un terrain où la raison n’a, par définition, aucun mot à dire. Plus délicat encore, même un « autre sentiment » ne pourrait être opposé à ce sentiment originaire, car le « sentiment » tel que le définit R. Barbaras ne saurait être confondu avec un sentiment particulier, avec un affect particulier : il est au contraire ce par quoi s’effectue de manière générale l’épreuve du sensible, si bien qu’une épreuve particulière du rapport au monde ne saurait s’y opposer puisqu’elle serait déjà épreuve, donc déjà ouverte par le sentiment dont parle l’auteur. Il est dès lors permis de se demander s’il n’y a pas là production d’un discours par nature immunisé, tant contre l’objection logico-rationnelle en étant pré-objective que contre l’objection de l’épreuve dissidente, du fait même que l’épreuve dissidente serait déjà une épreuve, donc déjà conditionnée par le « sentiment ». Dit autrement, on pourrait se demander de quel point de vue cette thèse pourrait être discutée et même si cette thèse pourrait tout simplement être discutée.
B : De la « distance » à l’ « exil » : apparition d’une « gnose inversée »
1°) La distance irrémédiable et l’exil
La question du sentiment, telle que nous l’avons exposée, renvoie à ce que l’auteur appelle la « perte faite épreuve » dont il nous faut préciser la teneur. Là encore inscrit dans les traces fondatrices de Merleau-Ponty, l’auteur montre d’une manière remarquable à quel point le monde, comme monde sensible, nous échappe, se dérobe à notre prise. Le monde, tout à la fois, se montre, c’est-à-dire est senti, et se retire, c’est-à-dire demeure insaisissable en son fond sensible. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, Renaud Barbaras conceptualise la notion de distance pour qualifier ce mouvement : « La distance inhérente à l’épreuve de soi, la dépossession qui caractérise le sujet répondent précisément au retrait irrémédiable du monde en chaque apparition. »12 C’est peut-être dans l’Introduction à une phénoménologie de la vie que le concept de distance connut d’ailleurs sa formulation la plus aboutie, la plus élaborée :
« puisque nous sommes situés dans le monde, notre expérience est caractérisée par la non-coïncidence ou par la distance et il faut intégrer cette distance à l’essence de l’expérience, comprendre en quoi il n’y a de proximité que par la distance et de clarté que par l’obscurité […]. La chair n’est pas un autre nom du corps : elle désigne ici le sens d’être du sujet lui-même en tant que, inscrit dans le monde et donc à distance de son objet, il en est cependant proche en ce qu’il est capable de le percevoir. »13
La perception est tentative de réduire la distance qui nous sépare du monde, mais du fait même que le sujet est objectivant, la distance avec le cœur de la dimension sensible du monde apparaît comme irrémédiable. Cependant, à mesure que progresse l’œuvre de Renaud Barbaras, s’estompe progressivement le terme de « distance » pour faire droit à celui d’ « exil », porteur d’une charge peut-être moins neutre, plus tragique. Métaphysique du sentiment est ainsi entièrement structuré autour de cette notion d’exil qui acquiert une dimension ontologique en tant qu’elle qualifie notre rapport de coïncidence impossible avec l’être du monde, donc avec le sensible.

C’est pourquoi, nous autorisant de la revendication par l’auteur de la présence d’une cosmologie et d’une métaphysique dans son œuvre, nous allons proposer une interprétation de cet exil à partir de ce que nous pourrions appeler « gnose inversée », c’est-à-dire à partir du sentiment d’un exil qui ne se référait plus à une réalité spirituelle extra-mondaine mais au contraire d’un exil se référant au monde lui-même : l’homme apparaît ainsi comme un être mondain tragiquement exilé du monde lui-même.
2°) Une « gnose inversée » ?
Précisons le sens de notre lecture. Le gnostique, de manière traditionnelle, éprouve douloureusement sa présence au monde comme un exil, et se sent du même geste comme relevant d’une nature extra-mondaine ; il se sent, note Jacques Lacarrière, « dans la même condition qu’un prisonnier déporté sur une planète maudite, un exilé, un étranger perdu au cœur d’un monde hostile. »14 La même thématique est développée par Hans Jonas qui décrit fort bien la manière dont la présence de l’homme dans l’univers physique correspond à un exil tragique.
Si le terme d’exil demeure chez Renaud Barbaras, il prend une tout autre teneur puisque son référent s’inverse. Nous appellerons référent ce par rapport à quoi l’homme se sent en exil. La gnose s’inverse ici pour deux raisons :
– d’abord pour une raison évidente puisque la connaissance – gnosis – ne peut plus être une voie d’accès à l’être dans l’optique pré-objectivante que retient l’auteur. C’était du reste l’objet de la fin de notre première partie.
– Mais surtout, dans perspective de Renaud Barbaras, l’homme est l’être qui ne parvient pas à coïncider avec cela même dont il provient, l’être qui éprouve douloureusement sa difficulté à coïncider avec ce dont il procède. L’homme est au monde et du monde, mais tout le déploiement de son existence en tant que subjective s’effectue curieusement hors-monde, par une mise à distance du monde avec lequel la coïncidence devient impossible. De là l’analyse de Renaud Barbaras :
« A nos yeux, l’existence du sujet ne va pas sans impliquer une aliénation fondamentale, un exil radical auxquels seule la fin de l’existence subjective, autrement dit une désindividuation radicale, mettrait fin. »15
Il peut sembler que l’exil à l’égard de la profondeur du monde est la condition de compréhension de l’appréhension du sujet comme mouvement telle que la propose Renaud Barbaras : en effet, dans une gnose traditionnelle, le sujet exilé doit interrompre le mouvement du monde associé au temps et à la corruption. Dans la gnose traditionnelle, le mouvement est la catastrophe même, la catastrophe du temps, du flux, qui incessamment éloigne davantage le gnostique de son origine véritable et la lui dissimule du même geste. Le gnostique, écrit ainsi Henri-Charles Puech, « sait qu’il préexistait en quelque sorte à lui-même, qu’il est issu et venu d’ailleurs que du monde ; se situant ainsi au-delà du temps et du monde, hors du devenir, il se convainc qu’il appartient, en droit et par nature, à l’Au-delà et qu’en raison de son origine, son être authentique est intemporel. »16
De ce fait, le gnostique au sens traditionnel fuit le mouvement, c’est-à-dire le temps et le devenir du monde pour se tourner vers lui-même et retrouver sa nature incorruptible, sa nature divine qui gît au fond de son être le plus profond. Par ce que Mircéa Eliade appelait l’ « instase », le gnostique retrouve sa nature divine profonde, son fond intérieur véritable.
Mais là aussi, les choses s’inversent chez Renaud Barbaras, la gnose se renverse : puisque l’exil se réfère au monde lui-même, alors l’attitude logique de l’exilé est celle non plus de l’instase mais de l’extase vers le monde, donc celle d’un mouvement vers la profondeur du monde qui, à chaque instant, semble se dérober. En d’autres termes, il semble que c’est le sentiment d’exil qui rend pleinement intelligible la nécessité de concevoir le sujet en termes de mouvement vers ce qui se dérobe.
3°) Objections à notre lecture
A cette lecture, deux faits centraux de Métaphysique du sentiment pourraient nous être objectés. Premièrement, nous accentuons peut-être le caractère tragique de l’exil en sous-estimant ce que l’auteur appelle « l’exode », soit cette errance, particulièrement prégnante chez l’animal, qualifiant le fait même que le monde est le lieu de l’animal, qu’il se donne « comme ce qui est susceptible d’être rejoint en une quête indéfinie. »17 Cela étant dit, dans la gnose elle-même, la dimension tragique est elle-même atténuée par le fait que la nature divine de l’homme présente un caractère inamissible que la présence au monde ne saurait totalement occulter. Mieux encore, par la « vraie connaissance », le gnostique peut se sauver, et ainsi échapper sa condition mondaine et au temps. En revanche, il semble chez Renaud Barbaras, en dépit de l’exode, que l’exil est si fort que même l’animal ne peut coïncider avec ce dont il est parti, et que sa quête est condamnée à rester précisément « indéfinie ».
Deuxièmement, en faisant de l’exil le cœur de l’intelligibilité de l’ouvrage, nous minimisons peut-être la volonté de lutter contre toute réification du sujet que porte d’ailleurs la notion de « mouvement ». « Le mouvement, écrit R. Barbaras, est négation effective de l’identité et donc de la substantialité, il est la seule manière concrète de ne pas être ce que l’on est. C’est donc parce qu’il existe comme mouvement que le sujet diffère effectivement radicalement des autres étants. »18. En somme, c’est la volonté de lutter contre la substantialité du sujet qui impose de déterminer le sujet comme mouvement.
Mais ne pourrait-on pas parvenir au même résultat en partant non pas du refus de la réification du sujet, mais en partant de l’exil ? Dès lors que ce dernier vis-à-vis du monde est au cœur de la réflexion de Renaud Barbaras, il va de soi que le sujet ne peut plus être substantiel car, s’il l’était, le sentiment de l’exil vis-à-vis du monde ne se comprendrait plus dans la mesure où le sujet trouverait en lui-même le sens plénier qui le comblerait et qui lui imposerait de qualifier le rapport à la profondeur du monde non plus d’exil mais de simple distance. Autrement dit, parce qu’elle porte en elle un arrachement irrémédiable à l’égard du monde, la notion d’exil signifie par elle-même que le sujet ne peut être substantiel, sous peine de quoi il y aurait en lui quelque chose de précisément substantiel qui serait l’objet réel du désir. Ainsi s’accuse la différence cruciale entre la gnose classique et la « gnose inversée » de Renaud Barbaras : parce que le sujet est en lui-même divin dans la gnose traditionnelle, alors ce dernier cherche à se connaître lui-même pour retrouver une existence conforme à une nature non-mondaine. Inversement, parce qu’il provient du monde dont il est exilé, le sujet de la gnose inversée se cherche non plus en tant que nature substantielle mais en tant qu’élément mondain, si bien que le désir de soi est un désir du monde. Néanmoins, nous pouvons également noter que le désir fondamental de la gnose traditionnelle et de la gnose inversée de R. Barbaras est un désir de l’origine, un désir portant sur l’origine divine perdue dans le premier cas, sur l’origine précédant la scission événementiale dans le second.
C : Cet obscur objet du désir…
1°) Sens du désir chez Renaud Barbaras
On pourrait à ce stade de la lecture se demander pourquoi le sujet, par le désir, ne parvient pas à coïncider avec cela même qu’il désire. Il est d’abord clair qu’en bon phénoménologue Renaud Barbaras fait droit à l’intentionnalité ; mais il la pense justement sous l’angle du désir. Autrement dit, C’est parce que nous sommes d’abord désir que nous avons accès à des objets. De surcroît, d’une manière qui pourrait sembler classique de prime abord, le désir renvoie à un manque originaire. « Ce qui importe ici est que la mise en évidence de l’autonomie de l’intentionnalité pulsionnelle ouvre la voie d’une dépendance génétique de l’intentionnalité objectivante vis-à-vis du désir. »19 Il faut ici se prémunir contre une mécompréhension qui pourrait grever la lecture globale de l’œuvre de Renaud Barbaras : il ne s’agit pas de penser le désir comme désir d’un objet particulier ; bien plutôt, le désir est désir du monde en tant que j’en suis exilé. De ce fait, désirer, c’est-à-dire tendre vers le monde objectivé, c’est me rapporter à ce qui me manque – le monde – sous une forme structurellement inadéquate – la forme objectivée à laquelle seule le sujet a accès. Dit autrement, si la perception est désir, alors tout étant n’apparaît jamais que sur fond d’un apparaissant ultime qui n’apparaît pas. Avec ces remarques tirées du Désir et la distance, on comprend à quel point le concept d’exil était en fait rendu nécessaire bien avant sa thématisation explicite dans Métaphysique du sentiment.
Dans ce dernier, le sens du désir est donc ressaisi à partir de l’exil. En exil du monde en son fond sensible, le sujet tente de se le réapproprier d’un geste désespéré que nomme le désir. « Le désir n’est donc pas manque, faute de quelque chose de déterminé qui serait susceptible de l’apaiser ; le désir ne manque de rien non pas parce que rien ne lui fait défaut mais plutôt parce que ce qui lui fait défaut est de l’ordre du rien, n’est rien d’étant. En effet, tout se passe comme si l’objet du désir se donnait comme en défaut vis-à-vis de quelque chose qui l’excède, de ce qui serait alors l’objet véritable du désir au sens où il le comblerait – mais il ne s’agit justement pas d’un objet. »20 Pour le dire autrement, le drame du désir est que, analogue à l’intentionnalité, il est nécessairement objectivant ; or, l’objet véritable du désir n’étant pas un objet, il ne peut jamais être atteint par le désir.
Autrement dit, le désir est désir de retrouver, comme nous le disions plus haut, l’origine même de soi. Le désir est toujours recherche de soi, « c’est-à-dire recherche de soi en l’autre ; même s’il se réalise dans l’ordre de l’avoir, il est d’abord désir d’être. Ainsi, le désir n’aurait aucun sens s’il n’y allait pas de l’être du désirant dans le désiré : en tendant vers un autre, c’est en vérité à lui-même que le sujet du désir aspire. »21 Mais cette réconciliation est évidemment impossible : le désir fait l’épreuve de la séparation, de l’exil ontologique.
Dans le cas de l’homme, le désir est objectivant, ce qui revient à dire que la subjectivité nous contraint d’accéder au monde sous une forme qui n’est pas adéquate à ce dernier. Il y a donc un double problème si l’on suit l’auteur jusqu’au bout : non seulement il y a arrachement au fond sensible du monde, mais de surcroît il y a condamnation à se rapporter à cette origine perdue de manière inadéquate. Le désir est, d’une certaine manière, le nom de cette inadéquation, de cet échec intrinsèque dans notre rapport à ce vers quoi nous tendons.
2°) Un noun inversé ?
Cela étant dit, si le désir est objectivant, et si, pour cette raison, il conduit à l’échec, c’est donc qu’idéalement il faudrait retrouver un monde pré-objectif. Mais qu’est-ce qu’un monde pré-objectif ? Qu’est-ce que ce fond du monde que recherche le désir ? Se le représenter, c’est déjà l’objectiver, et le langage semble condamné à forger un terme dont toute représentation est, par définition, exclue. Pourtant, Renaud Barbaras donne quelques pistes, par exemple page 29 :
« Autant dire que ce fond n’est pas radicalement autre que le monde auquel il donne lieu, que son indifférenciation n’est pas celle d’une sorte de nuit absolue, qui demeurerait en elle-même et dont rien ne pourrait sortir, mais plutôt déjà une virtualité de différenciation, un procès vers la multiplication des différents. Ce procès est exactement celui du monde, celui de l’advenue du monde. »
Le vocabulaire est ici passionnant. Une « virtualité de différenciation », « un procès vers la multiplication des différents », peuvent évoquer un élément mythologique célèbre, en ceci qu’un fond indifférencié, mais contenant virtuellement toutes les différences qui feront le monde, c’est très exactement ce que les Égyptiens, dans leur mythologie, appelaient le noun, l’espèce de magma aqueux informe et indéterminé qui contenait pourtant virtuellement toutes les formes à venir. Mieux encore, Renaud Barbaras précise que la sortie hors du fond n’est ni dépassement ni négation ; la sortie « emporte en quelque sorte le fond avec elle, si bien que celui-ci demeure coprésent au multiple auquel il donne lieu, le transit encore de son indétermination. »22 Dans la mythologie égyptienne, le noun n’est jamais dépassé ni nié : il demeure lui aussi co-présent au monde organisé, il est littéralement le désordre qui, à chaque instant, continue de menacer le monde ordonné. Il est figuré par le serpent Apophis qui, chaque matin, doit être vaincu par Rê, pour permettre à l’ordre de persévérer.
Peut-on alors penser que le monde pré-objectif peut être représenté à la manière du noun égyptien ? Oui si, comme dans la question gnostique, nous en inversons le sens. Chez Renaud Barbaras, le désordre du fond, l’indétermination du fond n’est plus menace mais espoir, il est même objet réel du désir. Ou plutôt, le fond n’est pas nécessairement désordre mais ordre radicalement autre de celui de la représentation. C’est peut-être là ce qu’il y a de plus singulier, de plus puissant dans la pensée de l’auteur, à savoir que l’objectivation du monde, logico-rationnelle, n’est pas l’objet réel du désir. Une sorte de cassure philosophique s’accomplit, car tout homme ne désire plus naturellement savoir, au sens d’un savoir objectif : tout homme désire retrouver son inscription mondaine, c’est-à-dire rompre avec l’ordonnancement que lui propose son rapport subjectif au monde. Bref, tout sujet désire rompre avec sa subjectivité mais, pour un homme, il n’est de désir que subjectif et tel est l’autre versant de la tragédie humaine.
« A nos yeux, l’existence du sujet ne va pas sans impliquer une aliénation fondamentale, un exil radical auxquels seule la fin de l’existence subjective, autrement dit une désindividuation radicale, mettrait fin. »23
L’existence subjective ordonne à sa manière le monde ; mais cet ordre n’est pas celui du monde, il est celui de la subjectivité en tant qu’elle objective le monde ; revenir au fond, ce n’est donc pas tant succomber au désordre que coïncider avec un ordre auquel la subjectivité nous interdit d’accéder, à l’égard duquel la subjectivité nous maintient en exil. C’est, si l’on peut dire, la victoire du noun inversé, c’est-à-dire la victoire d’un fond sensible certes indifférencié mais peut-être ordonné, d’un fond où l’indétermination n’implique plus le désordre mais la détermination intrinsèque du sensible qu’il ne s’agit plus de combattre mais, au contraire, de désirer ardemment.
D : Une métaphysique du désir davantage qu’un « désir métaphysique »
Cette recension serait incomplète si nous ne précisions pas le sens de la « métaphysique » telle que l’emploie Renaud Barbaras. Il ne s’agit pas de déterminer des raisons supraphysiques, mais bien plutôt de remonter à ce que l’auteur appelle l’ « archi-événement », soit à ce qui produit au sein du monde une scission dont naissent les sujets vivants. L’archi-événement, objet propre de la métaphysique, est le producteur de la scission. « L’archi-événement est ce qui vient en lieu et place d’une genèse impossible ; comme pur surgissement, il nomme un passage non-génétique, un abîme plutôt qu’un pont. »24 Comme tel, il relève de la métaphysique, car il n’est rien d’étant : il est un rien singulier qui n’est pas un néant, mais un pur advenir. « Il faudrait donc parler de métaphysique négative pour dire que rien de positif ne peut être affirmé de l’archi-événement. »25 Bref, la métaphysique ne renvoie pas au rien mais à un événement, à la négativité pure qu’est la scission archi-événementiale.
On comprend ainsi le sens du titre : par l’épreuve de la transcendance du monde que l’auteur nomme « sentiment », nous sommes renvoyés à l’archi-événement, à la scission originaire qui, comme telle, ne peut être pensée comme un étant classique ; de ce fait, seule une métaphysique au sens indiqué ci-dessus permet de rendre compte du fait même du sentiment.
Néanmoins, il ne faudrait pas en conclure, par une combinaison du désir et de la métaphysique que Renaud Barbaras reprend le désir levinassien de l’absolument autre et ce pour deux raisons. D’abord, parce que le désir chez Renaud Barbaras est désir de soi ; il n’y a de désir que parce que le soi fait défaut. Ensuite parce que la subjectivité ne se reçoit pas de l’extériorité, ne s’adonne pas. Et enfin parce que le désir demeure pensé en termes de satisfaction, fût-elle impossible. Le désir chez Renaud Barbaras n’est pas distance infinie vis-à-vis d’une altérité excédant la totalité, mais bien plutôt désir de soi qui, parce qu’il est désir, ne peut se manifester que comme distance, laquelle exprime l’exil originaire. Dit autrement, le désir fait paraître ce qu’il objective, et du mouvement même de ce qu’il fait paraître, interdit la saisie de ce qui était réellement désiré. Le désir est tjrs recherche de soi, « c’est-à-dire recherche de soi en l’autre ; même s’il se réalise dans l’ordre de l’avoir, il est d’abord désir d’être. Ainsi, le désir n’aurait aucun sens s’il n’y allait pas de l’être du désirant dans le désiré : en tendant vers un autre, c’est en vérité à lui-même que le sujet du désir aspire. »26
Conclusion : où est passé l’Ouvert ?
En conclusion, nous ne pouvons que redire notre admiration devant cet ouvrage, riche, stimulant, profond et dense. Bien des expériences sont phénoménologiquement décrites, et sont restituées avec bonheur. On peut parfois regretter le manque d’illustrations des thèses proposées, mais il n’en demeure pas moins que la thématisation du désir ou de l’exil est remarquable.
Toutefois, et pour conclure, il nous semble possible de manifester un étonnement devant la démarche de l’auteur, étonnement que nous avions signalé en première partie : tout se passe comme s’il posait qu’il nous était structurellement impossible de coïncider avec notre origine – le monde en sa profondeur sensible –, et que cela signifiait paradoxalement notre appartenance originaire au monde. L’impossibilité de coïncider avec x est présentée comme signifiant le caractère originant de x ; or, il serait tout à fait possible d’y voir au contraire la preuve du fait que le monde n’est pas notre origine, la différence de nature étant accusée par cette impossible coïncidence. Pourtant, l’incapacité permanente du sujet à coïncider avec le monde est au fond complètement neutralisée dans les écrits de l’auteur puisque le point de départ consiste à affirmer que cette non-coïncidence révèle non pas l’extériorité du sujet vis-à-vis du monde mais au contraire la tentative de retrouver le monde. En d’autres termes, cette approche phénoménologique fait come s’il était évident que la transcendance du sujet à l’égard du monde devait immédiatement être interprétée dans un sens immanent. Mais d’où provient pareille évidence ?
Peut-être pourrait-on y voir une pétition de principe car, en définissant d’emblée le sujet comme mouvement, se trouve fermée toute interrogation véritable sur la signification de l’impossibilité de coïncider avec le monde. Dès le départ, on décide de ne s’intéresser qu’au mouvement vers le monde, ce qui revient à dire que le fait de l’absence de coïncidence est d’emblée interprété comme raison d’être du mouvement et donc neutralisé en tant qu’indice d’une nature non-exclusivement mondaine du sujet. Mais rien ne prouve que le fait de l’absence de coïncidence signifie l’appartenance originaire au monde ; et peut-être même peut-on aller plus loin en constatant que les intentions des premières pages, à savoir conférer à la poésie sa portée métaphysique maximale, sont étrangement mises de côté en ceci que la question poétique est très peu traitée comme telle dans l’ouvrage. Distinguant la poésie comme telle du poétique, l’auteur note ainsi que « le poétique est indistinctement épreuve de la séparation ou de l’exil ontologique et tentative de la dépasser. »27 Mais, du poétique, il est finalement bien peu question dans Métaphysique du sentiment, bien moins d’ailleurs que dans l’Introduction à une phénoménologie de la vie où Rilke était convoqué pour son concept d’Ouvert28 qualifiant le monde comme tel. L’Ouvert, c’est-à-dire le monde en sa profondeur sensible, y était décrit comme une origine toujours déjà perdue. De manière significative, d’ailleurs, c’est dans cette réflexion sur l’Ouvert qu’était apparue la notion d’exil puisque « l’unité originaire du Leben et de l’Erleben dans le vivre renvoie au défaut et à l’exil qui caractérisent ce vivre en tant qu’il est vivre dans l’Ouvert. »29
Ouvert, le monde l’est en tant qu’il est ce dans quoi je peux m’inscrire, ce qui accueille ; en même temps, il n’y a d’ouverture que s’il y a séparation ou mieux encore, scission. C’était là un terme du poétique parfaitement choisi pour rendre compte de la métaphysique en jeu ; pourtant, l’Ouvert disparaît dans Métaphysique du sentiment, et avec lui toute utilisation effective du poétique, disparition dont on peut interroger la signification et pour laquelle on peut proposer l’hypothèse suivante : peut-être parce que la voie d’accès véritable au monde en sa profondeur sensible est-elle moins le poétique que la danse. Par cette dernière, l’homme se met comme à l’unisson du monde, co-vibre avec le mouvement du monde ; par la danse, presque au sens antique du terme, l’homme échappe à la représentation – sonore, visuelle, tactile – mais exprime par son corps ce qui lui semble être le mouvement du monde, comme si le corps humain se faisait transcription corporelle de ce mouvement. En outre, du fait même que la danse est toujours danse d’un corps subjectif, demeure l’épreuve de la séparation et de la limitation.
En somme, on voit très bien pour quelle raison le langage poétique propose une épreuve qui est celle de la séparation fondamentale, mais on voit moins bien pourquoi le langage poétique dépasserait l’exil, tel qu’il est défini, de manière plus aboutie que la danse. Peut-être faut-il alors y voir le symptôme de la présence secrète de la gnose au sens traditionnel cette fois, travaillant la pensée de l’auteur : le fait d’avoir préféré le langage poétique à la danse constitue peut-être un indice en faveur du fait que le référent de l’exil n’est pas si clair que cela, car autant la danse, par le corps, réduit la transcendance du sujet à l’égard du monde, autant le langage poétique confirme le sujet dans son extériorité, dans l’accès à son Moi pur (Valéry), au divin, à la transcendance de certains sentiments.
Dès lors, le sens explicite de l’ouvrage faisant droit à une pleine appartenance du sujet au monde se trouve peut-être contredit par le primat de la poésie sur la danse, révélant ainsi un sens implicite, à savoir l’immense difficulté à garantir que le référent de l’exil soit bel et bien le monde et non une réalité transcendante au monde.
Pour le dire autrement, il nous semble que Renaud Barbaras pourrait être amené dans les années à venir à devoir interroger le référent de l’exil et à donc affronter le sentiment gnostique classique comme tel. Du reste, un écrivain comme Cioran, dont la teneur gnostique des écrits est depuis longtemps reconnue par tous, évoque à travers la figure de Rilke non seulement l’exil (tant métaphysique que géographique) mais le relie de surcroît au poétique, comme si donc ce dernier ne pouvait être mobilisé que pour signifier une irréductible transcendance au monde :
« Sous quelque forme qu’il se présente, et quelle qu’en soit la cause, l’exil, à ses débuts, est une école de vertige. Et le vertige, à tous n’est pas donnée la chance d’y accéder. C’est une situation limite et comme l’extrémité de l’état poétique. N’est-ce point une faveur que d’y être transporté d’emblée, sans les détours d’une discipline par la seule bienveillance de la fatalité ? Pensez à cet apatride de luxe, à Rilke, au nombre des solitudes qu’il lui fallut accumuler pour liquider ses attaches, pour prendre pied dans l’invisible. […]. S’arracher au monde, quel travail d’abolition ! »30
Ce ne sont là que quelques hypothèses émises à partir de la lecture d’un livre dont, nous le redisons, nos quelques remarques ne sauraient épuiser ni la richesse ni la profondeur ni même la stimulation qu’il offre au lecteur, et pour lesquelles nous adressons toute notre gratitude à l’auteur.
- Renaud Barbaras, Métaphysique du sentiment, Paris, Cerf, 2016
- Renaud Barbaras, Le désir et la distance, Paris, Vrin, 1999, p. 15
- Ibid.
- Ibid., p. 102
- Métaphysique du sentiment, op. cit., p. 12
- Ibid.
- Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l’Invisible, Paris, Gallimard, p. 183
- Métaphysique du sentiment., p. 179
- Ibid., p. 186
- Ibid., p. 189
- Ibid., p. 12
- Le désir et la distance, op. cit., p. 89
- Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie, Paris, Vrin, 1976, p. 75-76
- Jacques Lacarrière, Les gnostiques, Paris, Albin-Michel, 1994, p. 33
- Renaud Barbaras, Métaphysique du sentiment, op. cit., p. 210
- Henri-Charles Puech, En quête de la gnose. La gnose et le temps, Préface, Paris, Gallimard, p. XVI
- Métaphysique du sentiment., p. 132
- Ibid., p. 18
- Le désir et la distance, op. cit., p. 138
- Métaphysique du sentiment, op. cit., p. 22
- Ibid., p. 72
- Métaphysique du sentiment, p. 29
- Ibid., p. 210
- Ibid., p. 101
- Ibid., p. 103
- Métaphysique du sentiment, op. cit., p. 72
- Ibid., p. 10
- « L’Ouvert est bien, en vertu de son essence même, élément de l’éclosion de l’étant, ce qui a toujours déjà été dépassé, c’est-à-dire finalement nié, et donc toujours déjà occulté. » (page 262)
- Introduction à une phénoménologie de la vie, op. cit., p. 250
- Cioran, La tentation d’exister, « Avantages de l’exil », in Cioran, Œuvres, Gallimard, coll. Quarto, 1995, p. 855-856







