John Baird Callicott est un penseur américain, né en 1941, dont les travaux s’inscrivent dans le cadre de l’environnemental ethics. Celle-ci interroge les comportements humains dans une perspective écologique : comment définir un mode de vie soutenable tant pour la perpétuation de l’homme que pour la préservation des milieux naturels ?
Callicott défend l’idée que c’est la terre (land) qui sera le principal sujet de préoccupation pour le 21ème siècle. Le land est la terre comme territoire et comme habitat, comme parcelle de monde dont nous sommes en charge. L’éthique environnementale entend renouveler en profondeur la réflexion philosophique en réanimant une idée philosophique, vénérable mais un peu oubliée, celle de Nature. Pour cela, Callicott s’appuie sur les développements des sciences physiques et biologiques depuis un siècle, afin d’en tirer toutes les implications philosophiques dont elles sont porteuses : qu’est-ce que la Nature après Einstein et la physique quantique ? Loin d’y voir une ruine de cette idée, Callicott y cherche une source de pensée nouvelle pour comprendre les relations des vivants entre eux et avec leur milieu. L’homme est pour cette raison invité à adopter une vision écocentrique du monde. Ce décentrement n’est pourtant pas un oubli de l’homme, mais une manière nouvelle de solliciter ses ressources morales : quel comportement adopter, quelles nouvelles manières de vivre inventer, pour surmonter cette « crise tranquille » (quiet crisis) que traverse notre civilisation de la puissance machinique ?
Trois livres de l’auteur ont récemment été traduits en français : Éthique de la terre, Pensées de la terre et Genèse 1 . Je m’intéresserai surtout au premier d’entre eux, Éthique de la terre, recueil d’essais qui expose les principaux problèmes auxquels est confronté celui qui voudrait réfléchir aux valeurs du XXIe siècle -projet que l’auteur définit, à la suite d’Aldo Léopold, par la belle expression de Land Ethic, éthique de la terre.
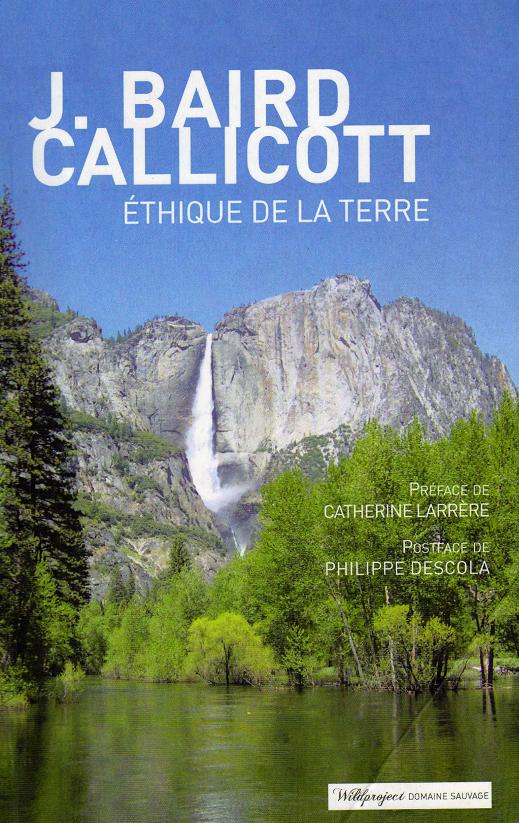
Critique de la philosophie académique
Si on peut le dire en termes heideggeriens, c’est notre être-au-monde que Callicott nous invite à repenser. Repenser la Nature et notre place en son sein, c’est se remettre à penser tout court. C’est reconsidérer concrètement notre place sur terre pour le siècle qui commence. La philosophie ne peut pas ignorer un sujet si sérieux. Callicott est très critique envers la philosophie universitaire, qui passe complètement à côté des enjeux d’une éthique de la terre, tout comme la plupart des institutions et entreprises, qui continuent, selon le modèle de l’âge industriel, d’envisager le milieu naturel comme une réserve de ressources exploitables, malgré tous les discours sur le développement durable. C’est avec cette vision industrielle que Callicott entend rompre. On comprend alors qu’il affirme le caractère proprement révolutionnaire d’une pensée environnementaliste.
« Quand le XXIe siècle sera parvenu à maturité, qu’est-ce qui aura succédé à la philosophie analytique et à la phénoménologie ? J’ai parié ma vie sur la conviction que la philosophie de l’écologie sera considérée par les futurs historiens comme le berceau de l’effort qui, au XXIe siècle, mettra au jour les implications philosophiques des profonds changements de paradigme réalisés par les sciences au XXe siècle ».
Callicott dénonce ce qu’il y a d’intenable à continuer à faire de la philosophie comme si rien ne se passait d’important hors des murs de l’université. En s’enfermant dans des discussions ne faisant appel qu’à la dialectique pure et à l’histoire de la pensée, la philosophie analytique et la phénoménologie ont implicitement accepté de réduire leur discipline à une épistémologie générale ou à une analyse langagière tatillonne. Il se met en place toute une manière de penser qui ressemble fort à une néo-scolastique :
« Le maintien fidèle du statu quo au service de l’ordre établi est une fonction centrale des institutions universitaires. La philosophie académique classique remplit cette fonction en partie par ce que j’appellerais une tactique de diversion : en concentrant les facultés critiques considérables de la philosophie sur des puzzles intellectuels cryptés (comme par exemple les relations référentielles entre mots et objets), éloignés des problèmes communs et pressants du monde réel – des problèmes dont la résolution pourrait entraîner de profonds changements économiques, sociaux et politiques » 2.
L’oubli de la crise écologique dans le discours universitaire n’est pas simplement de la paresse mais une attitude irresponsable. Au lieu d’éveiller les consciences et d’interroger le sens de nos pratiques, comme c’est son rôle, la philosophie laisse filer les problèmes. En retrouvant cette dimension critique de la philosophie, Callicott ne cherche qu’à renouer avec une tradition qui s’est toujours interrogée sur son présent :
« Nous tentons d’appliquer les méthodes traditionnelles de la philosophie – critique et invention conceptuelle – à un nouveau genre de problèmes réels bien définis : appauvrissement biologique, dégradation écologique, changement climatique, auxquels l’humanité est confrontée » 3
« Nous faisons partie du paysage »
Il n’est plus possible de délimiter une frontière nette entre l’homme et son environnement. Les deux sont inextricablement entrelacés. De ce fait, la conduite des hommes engage le mode de vie de toutes les créatures et de l’environnement dans son entier. C’est aussi pour cela que l’éthique environnementaliste peut prétendre au statut de philosophie première car elle s’interroge sur le tout de notre existence. Ce qui ne signifie du reste pas qu’elle aurait à se montrer arrogante, ou dominatrice, bien au contraire. Une des vertus que nous enseigne l’environnementalisme est l’humilité : l’homme n’est plus au-dessus de la nature.
« Pour l’éthique de la terre, nous faisons partie du paysage. C’est le grand enseignement de l’écologie scientifique – science des interrelations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu – que de nous apprendre à voir et à sentir que, depuis la bactérie jusqu’à la « faune charismatique » nous appartenons à la communauté des vivants […] La théorie de l’évolution et l’écologie scientifique favorisent en nous la conscience d’être insérés au sein d’un monde de liens réciproques, et c’est précisément la conscience de cette réalité qui rend légitime, et fondé en raison, le projet d’une extension de l’éthique au-delà des communautés humaines » 4.
En décalquant l’expression de Philippe Descola, qui propose une sociologie des collectifs, on pourrait parler chez Callicott d’une éthique des collectifs -si par collectifs on entend un ensemble intégrant des humains et des non-humains (animaux, plantes, rivière, montagne…) [Voir la postface de Philippe Descola à Éthique de la terre. Voir également les parties IV et V de Par delà nature et culture, Gallimard, 2005. Lire sur ce site [un entretien avec Philippe Descola.[/efn_note].
Les principes de l’éthique environnementale
« Si le progrès moral et le développement civilisé se poursuivent dans le sens que semblent indiquer à la fois un bref aperçu de l’histoire et la simple expérience d’un passé récent, les générations futures censureront l’esclavage banal et universel de la nature, comme nous condamnons aujourd’hui l’esclavage humain, tout aussi banal et universel il y a trois mille ans » 5.
S’inscrivant dans un mouvement global de prise de conscience écologique, la philosophie que met en avant Callicott est aussi un « laboratoire de l’avenir » 6 : elle est une réponse morale aux bouleversements scientifiques du début du XXe siècle, et à la crise actuelle de l’environnement, en vue de définir un mode de vie soutenable. En matière d’éthique environnementale, tout reste à faire : en premier lieu de définir ses fondements. Callicott reprend à son compte un principe énoncé par Aldo Léopold dans Almanach d’un comté des sables :
A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise. « Une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste si ce n’est pas le cas ».
Callicott commente comme suit :
« Selon cette mesure du juste et de l’injuste, non seulement il serait injuste pour un fermier, pour faire plus de bénéfice, d’abattre la forêt sur 75% d’un versant, d’y mettre ses vaches et d’y laisser raviner eaux de pluies, rochers et terre ; mais il serait également injuste pour l’agence fédérale de la pêche et de la vie sauvage, au nom du bien-être individuel de l’animal, de permettre aux populations de cerfs, de lapins, d’ânes sauvages, ou quoi que ce soit, de proliférer sans limite et ainsi de menacer l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique dont ils sont membres. Ainsi, l’éthique de la terre n’a pas seulement un côté ou une dimension historique -elle est tout bonnement holistique » 7.
L’auteur s’attache alors à justifier, d’une part, cette conception holistique de l’éthique et à définir, d’autre part, les difficultés posées par cette recherche des principes.
Les études écologiques montrent que les milieux de vie sont interdépendants les uns des autres. L’industrie humaine et la mondialisation ont accru cette solidarité systémique, par la négative, pourrait-on dire, puisque l’homme a le pouvoir de bouleverser les écosystèmes et le climat à l’échelle de la planète. Nous avons besoin d’une prise de conscience, qui commence par la reconnaissance d’un fait simple : la terre est une communauté biotique 8. Tous les vivants partagent en fait un seul écosystème global. L’approche holistique se fonde sur l’écologie pour définir des règles valables pour la nature en générale, et pour trouver des applications dans chaque cas particulier.
« Tu n’éradiqueras pas, tu ne pas provoqueras pas l’extinction des espèces, tu prendras de grandes précautions en introduisant des espèces exotiques et domestiques dans des écosystèmes locaux, en tirant l’énergie du sol, en la recyclant dans le biote, et en endiguant ou polluant les cours d’eau ; et tu devras faire preuve d’une particulière sollicitude envers les oiseaux prédateurs et les mammifères. Tels sont, brièvement, les préceptes moraux de l’éthique de la terre » 9.
Plus que l’énoncé de règles et recommandations, qui seront toujours soit trop générales, soit trop précises, Callicott nous engage à nous soucier davantage de notre environnement et d’ajouter aux principes moraux que nous connaissons déjà (familiaux, patriotiques etc.) un ensemble de principes proprement écologiques. Ceux-ci ne se substituent pas aux autres mais s’ajoutent, comme un cercle supplémentaire de soucis éthiques qui vient englober les autres dimensions de notre vie :
« Les obligations familiales, en général, passent avant les devoirs envers la nation, et les obligations humanitaires, en général, passent avant les devoirs envers la nature. C’est pourquoi l’éthique de la terre n’est pas draconienne ou fasciste. Elle n’annihile pas la moralité humaine. Cependant, l’éthique de la terre peut, comme c’est le cas avec tout nouveau progrès moral, demander des choix qui affectent, en retour, les besoins des cercles socio-éthiques les plus intimes. Les impôts et le service militaire peuvent entrer en conflit avec certains impératifs familiaux. Si l’éthique de la terre n’annule en aucun cas la moralité humaine, elle peut cependant l’affecter » 10.
Penseur de l’éthique, Callicott a l’intérêt d’être également attaché à définir précisément de quoi est composé notre environnement. Sa philosophie s’appuie sur les sciences, afin de redéfinir aujourd’hui, ce qu’est la Nature, à la lumière de la nouvelle physique née au siècle dernier.
La nature de la Nature
Callicott s’appuie sur un « modèle du circuit énergétique de la nature » 11 : les individus sont une perturbation locale dans un flux d’énergie indistinct. Autrement dit, tous les êtres participent bien d’une même « substance », s’il faut parler comme les philosophies ioniens. On peut, par commodité, parler d’un monisme : toutes les choses sont de même nature.
« Les canaux vivants – les chaînes alimentaires – à travers lesquels circule l’énergie sont composés d’individus végétaux et animaux. Un fait central et fort se trouve au coeur du processus écologique : l’énergie, la monnaie d’échange de l’économie de la nature, passe d’un organisme à un autre, non pas d’une main à une autre comme une pièce de monnaie, mais pour ainsi dire d’un estomac à un autre. Manger et être mangé, vivre et mourir, tel est le refrain de la communauté biotique » 12.
L’approche holistique est bien loin de voir l’harmonie à l’oeuvre de la Nature. Il n’y a chez Callicott aucune idée d’un ensemble créé et organisé par un être divin (discours des partisans de l’Intelligent Design). Le retour d’une philosophie de la Nature n’est pas une occasion de ré-enchanter ce que la modernité avait réduit à un jeu mécanique de forces en interaction. Callicott ne cherche pas à refonder une métaphysique de la nature. Il ne la considère pas avantage comme quelque chose de mystérieux, qui ferait éventuellement l’objet d’une inquiétude religieuses. Elle n’est pas non plus une substance ineffable :
« Dans la pensée classique indienne, toutes les choses sont une parce que toutes les choses sont des manifestations ou des expressions phénoménales et, au bout du compte, illusoires de Brahman […] En écologie contemporaine tout comme en théorie quantique, l’unicité de la nature, au niveau des phénomènes qui retiennent respectivement leur attention, est systémique et (de façon interne) relationnelle. Aucune manifestation mystérieuse d’un être indifférencié. La nature serait plutôt un ensemble différencié et structuré. Les particules et les organismes vivants, dans leur multiplicité, conservent, au final, leurs identités et leurs caractères particuliers -quoique éphémères – à tous les niveaux d’organisation » 13.
L’étude holistique n’a donc rien à voir avec la conception New Age d’un grand tout vivant dans lequel nous devrions aspirer à nous fondre. Si les êtres vivants sont unis les autres aux autres, c’est qu’ils sont dépendants les uns des autres pour leur nourriture. Leurs différenciations ne sont pas illusoires. Le tout ne résorbe pas en lui ses parties : la nature forme un système, mais les animaux n’en continuent pas moins de se dévorer entre eux. Selon cette conception physicaliste et écologique, la nature perd de sa superbe, mais pas de sa richesse. Elle appelle aussi de notre part une prise en compte éclairé de son mode de fonctionnement et des prises de responsabilité sur sa protection.
La recherche sur la nature et sur les principes de l’environnementalisme débouche sur une prise de conscience. Cependant, si la nature n’a rien de sacré, pourquoi chercher à la préserver ? Pourquoi ne pas accorder une préférence égoïste à notre espèce et lui donner le droit de dominer les autres ? Pour soutenir son projet éthique, l’auteur nous propose non seulement une approche holistique de la terre, mais plus encore, il défend une vision écocentriste : l’homme n’est qu’une partie de la nature. Callicott propose une rupture nette avec le paradigme de la modernité, qui était anthropocentriste. Callicott montre qu’il faut dépasser ce modèle et remettre la Nature au centre du monde.

Séquoias géants à Yosemite Park, Californie. Photo NR.
L’introuvable fondement de l’éthique environnementaliste ?
L’homme justifie sa place au centre du monde par la valeur qu’il s’accorde à lui-même, en tant qu’être conscient et raisonnable.
Si l’on veut défendre la position selon laquelle les êtres non-humains ont une valeur en soi, on est donc conduit à chercher un critère permettant d’attribuer une valeur aux animaux et aux plantes. De quel droit peut-on leur accorder une valeur si grande faille qu’il faille les protéger, alors que ces êtres n’ont pas de moyen d’exprimer, par le langage, une raison comparable à celle de l’homme ? Animaux et plantes ne peuvent eux-mêmes exiger une telle reconnaissance, du fait qu’ils ne peuvent se constituer en sujets conscients. Il faut dès lors savoir dans quelles conditions il est possible d’attribuer des propriétés morales à un être, telles qu’elles puissent lui conférer une dignité analogue à celle de l’homme.
Callicott discute de la théorie bio-centrique de Rolston [cf. Holmes Rolston III, Environnemenal Ethics : Duties and Values in the Natural World, Philadelphia, Temple University Press, 1988. Lire [un entretien avec l’auteur sur non-fiction.fr[/efn_note]. La solution de ce dernier est de passer outre le critère de la conscience, c’est-à-dire de penser des sujets, et des intentionnalités, mais sans réflexivité explicite. On évite ainsi les impasses de l’intersubjectivité : on n’attendra pas d’avoir accès à l’intériorité des bêtes pour leur accorder de la valeur.
« En l’absence de tout sujet intentionnel, il ne peut y avoir de valeur. Or, il se peut que certains actes intentionnels, même ceux des sujets hautement évolués capables de prendre conscience d’eux-mêmes, ne soient pas expérimentés comme tels. Un homme qui court après tous les jupons, par exemple, peut ne pas prendre conscience de l’amour qu’il porte à sa femme avant que celle-ci ne le quitte. Ce qui rend si convaincante la façon dont la théorie biocentrique de Rolston établit l’existence de la valeur intrinsèque tient précisément à ce que l’on peut se figurer les organismes non conscients comme des êtres capables de se valoriser eux-mêmes, sans que la possibilité leur soit donnée pour autant de faire l’expérience de l’acte par lequel ils se valorisent eux-mêmes […]
Remarquons quand même qu’en exposant sa position, Rolston a déconstruit le sujet cartésien. Il a établi un continuum, une sorte de pente glissante, conduisant de sujets humains se valorisant eux-mêmes pleinement, aux lémuriens considérés comme des sujets valorisants quasi conscients d’eux-mêmes, puis aux fauvettes, sujets valorisants doués de conscience mais à peine conscients d’elles-mêmes, et enfin au Trillium, qui regroupe des formes de vie plongées dans la plus profonde inconscience. Par étapes progressives, la subjectivité du sujet ne cesse de s’éroder jusqu’à ce que nous atteignions, avec les plantes, le plan des non-sujets capables de s’attribuer une valeur » 14.
La solution biocentrique, malgré ses mérites, ne convainc pas totalement Callicott, car elle est encore trop dépendante d’une vision individualiste de la nature. L’environnementaliste ne se soucie pas tant du bien-être des pucerons, des arbres ou des vers de terre pris individuellement : un garde-forestier ne peut laisser proliférer toutes les espèces du domaine dont il est en charge. De plus, comme l’individu vivant n’existe pas indépendamment d’un écosystème, il serait contradictoire de pratiquer un holisme des milieux, tout en cherchant à fonder une valorisation éthique sur des critères individuants.
« C’est pour cette raison que j’ai personnellement choisi de ne pas essayer de m’inscrire à la suite de Kant et de ceux de ses héritiers qui ont opté en faveur d’une éthique biocentrique, et donc de ne pas reprendre à mon compte le projet qui consiste à faire surgir, comme par magie, la valeur intrinsèque de la capacité des sujets à s’accorder eux-mêmes une valeur et à se rendre compte que d’autres s’en accordent une comme eux. J’ai préféré proposer que nous fondions l’éthique environnementale sur la capacité qui est la nôtre, en tant qu’hommes, d’accorder une valeur aux entités naturelles non humaines pour ce qu’elles sont -indépendamment à la fois des services qu’elles peuvent nous rendre, et de la question de savoir si, oui ou non, elles sont capables de s’accorder une valeur à elles-mêmes » 15.
La vision écocentriste dont Callicott se fait le tenant ne se confond pas avec le bio-centrisme hérité de Kant que soutient Rolston. Celui-ci est obligé de se plier à des « acrobaties théoriques » 16 pour défendre, agnostiquement, un certain caractère sacré de la vie. Callicott ne cherche pas à fonder son propos sur une mystique vitaliste, là où la simple considération de l’existence animale nous montre que les bêtes, loin de se ménager entre elles, passent sans arrêt dans l’estomac l’une de l’autre. De cette réalité, on ne tirera pas un pessimisme à la Schopenhauer, dénonçant la cruauté intrinsèque du vouloir-vivre ; plus simplement, on admettra qu’un modèle bio-centrique n’est pas satisfaisant pour une prise en charge des questions environnementales.
La postmodernité
La question d’un fondement de l’éthique environnementale demeure volontairement ouverte par Callicott. La période actuelle, qu’il qualifie de « postmodernité » amorce une transition vers un nouveau système de valeurs encore à construire. Ce que suggère le propos du livre, c’est peut-être que nous assistons à un élargissement progressif de la conscience environnementale, et donc à la définition progressive de nouvelles responsabilités.
« Les comportements que l’évolution a formés, ainsi que les émotions qui les animent, sont souvent les instruments aveugles et brutaux de la protection de notre valeur sélective globale (inclusive fitness) […] Ils [nos ancêtres] n’avaient pas la sophistication intellectuelle leur permettant d’effectuer un calcul coût-avantage en termes de “valeur sélective” globale […] L’évolution les a dotés de sentiments et d’impulsions altruistes diffus – qui servaient au départ à promouvoir leur propre reproduction génétique, mais qui ont dévié vers des fins sociales plus larges quand les circonstances ont changé » 17.
Callicott, me semble-t-il, suggère de poursuivre cet élargissement de la morale et, plutôt que de chercher un fondement à l’éthique qu’il propose, de saisir celle-ci dans un mouvement qui est constitutif de notre histoire et qu’il nous revient aujourd’hui de poursuivre, en marquant au passage les ruptures nécessaires. : de la communauté clanique aux sociétés intermédiaires, jusqu’à l’humanité et aujourd’hui à la terre dans son entier. Projet qui peut paraître orgueilleux, démesuré et qui en réalité, nous ramène à nos liens de dépendances :
« La science a élargi notre vision du monde. La Terre est une petite planète dans un univers immense et inhospitalier. Ses autres habitants et nous-mêmes sommes réellement, d’un point de vue cosmique, une famille restreinte. De ce même point de vue, nous dépendons effectivement pour notre existence -avec la moindre respiration, le moindre morceau de nourriture – de nos compagnons-voyageurs dans l’odyssée de l’évolution » 18.
Préserver ou conserver l’environnement ?
S’il est nécessaire de modifier le cours de l’activité humaine pour protéger l’environnement, une alternative se pose : soit préserver complètement, c’est-à-dire accepter de sanctuariser certaines parcelles de nature sauvage : ne plus y toucher du tout, maintenir l’intégrité parfaite ; soit conserver, c’est-à-dire intervenir pour maintenir en l’état les milieux naturels, en contribuant à leur stabilité.
L’option préservationniste a été défendue par John Muir, qui attribuait une valeur en soi aux terres non touchés par l’homme. Muir contribua notamment à la sauvegarde de la vallée de Yosemite, qui devint le premier parc naturel des Etats-Unis. John Muir s’opposa aux thèses conservationnistes de Gifford Pinchot, pour qui la nature doit être protégée, mais afin que ses ressources soient mieux exploitées : pâturages utilisés pour élever des moutons etc.
Callicott montre les contradictions des deux options :
– Le préservationnisme pour sa part tombe dans une contradiction assez directe, en postulant qu’il ne faut plus du tout toucher à certains territoires… ce qui suppose également une intervention active et permanente pour ne pas toucher à ces terres. « En pensant protéger une nature vierge de toute présence humaine, nous sommes paradoxalement obligés de la gérer activement et de manière envahissante. Nous sommes donc amenés à envisager une protection de la nature peut-être moins pointilleuse, mais intégrant plus en amont la présence humaine » 19.
– Le conservationnisme de Muir n’est pas satisfaisant non plus, puisqu’on sait que les écosystèmes ne sont jamais stables. Des espèces prolifèrent, puis s’éteignent, des feux dévastent des arbres, permettant à d’autres plantes de prendre leur place. Des maladies se répandent etc. L’écologie nous montre une nature en évolution constante, où le malheur des uns peut faire la prospérité des autres. Conserver en l’état un milieu de vie, c’est artificiellement protéger une sorte de « pureté » dont les vivants n’ont cure. « Paradoxalement, les réserves naturelles doivent être restaurées et activement gérées si l’on veut qu’elles restent un habitat adéquat pour les espèces locales » 20.
Discussion des trois critères de Léopold : beauté, intégrité, stabilité
Le problème n’est pas l’intervention humaine en tant que telle. Quand les premiers Européens sont arrivés sur le continent américain, ils n’ont pas trouvé une nature vierge de toute trace humaine, mais des terres que les Indiens savaient exploiter sans les épuiser. Il n’en est plus rien aujourd’hui :
« Le problème avec les perturbations d’origine anthropiques – comme la foresterie et l’agriculture industrielle, le développement urbain, le chalutage et autres – est qu’elles sont plus fréquentes, plus étendues et d’une occurrence plus régulière que les perturbations naturelles […] Il y a l’élimination à une échelle continentale des grands prédateurs de la communauté biotique ; la substitution ubiquiste d’espèces domestiques aux espèces sauvages ; l’homogénéisation écologique de la planète résultant de la “mise en commun à l’échelle mondiale des flores et des faunes” par l’action des homme ; l’ubiquiste action de “polluer les eaux et de les obstruer par des barrages”. » 21.
La devise d’Aldo Léopold («to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community») n’est donc qu’à moitié satisfaisante : même si tout le monde est d’accord pour préserver la beauté naturelle, les notions d’intégrité et de stabilité sont trompeuses, car elles présupposent que la nature est dans une extériorité complète par rapport à nous : paisible sans l’homme, perturbée, polluée, déséquilibrée dès que nous y touchons.
Nous devons nous méfier, montre Callicott, de l’idée de la nature sauvage (wilderness) et les fantasmes qui y sont associés -tout comme on ne parle plus de « jungle » mais de forêt tropicale. L’auteur avance une série d’arguments :
« L’idée traditionnelle de nature sauvage, apparemment simple, ne résiste pas à l’examen ».
Tout d’abord, le concept perpétue la dichotomie de la métaphysique occidentale prédarwinienne entre l’homme et la nature, bien qu’il en inverse les termes. A tel point, en effet, que l’un des principaux bénéfices psychologiques et spirituels que l’on reconnaît à l’expérience de la nature sauvage est de nous mettre en contact avec une altérité radicale ; et que la préservation de la nature sauvage entend laisser être les non-humains dans leur pleine altérité.
Ensuite, l’idée de nature sauvage est affreusement ethnocentrique. Elle ignore la présence historique et l’impact des populations indigènes sur presque tous les écosystèmes du monde.
Et enfin, elle ignore la quatrième dimension de la nature : le temps. Au cours d’un récent débat, H. Ken Cordell et Patrick C. Reed ont affirmé catégoriquement que “la préservation implique la cessation du changement”. Mais dans les écosystèmes, le changement est aussi naturel qu’inévitable. Il n’est donc ni naturel ni possible de préserver indéfiniment les écosystèmes dans leur état antérieur » 22.
Etant admis qu’on ne peut pas garder la nature en l’état, les termes du problème sont changés : comment intervenir intelligemment dans un écosystème ? Pour préserver quels vivants aux détriments de quels autres ?
Les gardes forestiers du parc de Yosemite déclenchent régulièrement des incendies qui brûlent les plantes et arbres les plus faibles, de manière à permettre la croissance des séquoias géants, qui résistent au feu et croissent mieux grâce aux minéraux contenus dans les cendres.
La gestion des espaces naturels passe par une intervention assumée de l’homme. Il faut alors réfléchir au maintien en bon état des écosystèmes, c’est-à-dire apprendre à nous soucier de leur santé.
La santé des écosystèmes
Même si nous assumons qu’il faille accompagner l’évolution des écosystèmes, comment provoquer des changements qui ne soient pas destructeurs ? Comment conserver un milieu de vie ? Ne peut-on, du reste, imaginer que certaines zones soient laissées à l’écart de toute intervention humaine ?
L’enjeu est pour Callicott d’intervenir sur la nature sans que cela soit synonyme d’exploitation commerciale :
« Permettez-moi ici d’être aussi clair que catégorique : je ne suis pas en train de suggérer que nous ouvrions au développement ce qu’il reste de vie sauvage ; je propose que nous commencions à reconsidérer le développement économique à la lumière de l’écologie. Les activités économiques des hommes devraient au moins être compatibles avec la santé écologique de l’environnement naturel dans lequel elles ont lieu. Idéalement, elles devraient l’enrichir […] L’agriculture industrielle était une cible fréquente des critiques et de l’ironie de Léopold. Et il a peut-être été le premier écologiste à reconnaître clairement et à déplorer l’industrialisation de l’agriculture au cours du XXe siècle, ainsi que la transformation des fermes classiques, aux pratiques relativement bénignes et soutenables, en usines à bouffe insoutenables et destructrices de leur environnement naturel » 23.
Les décisions à prendre en la matière doivent s’appuyer sur des études à plusieurs échelles, du microscopique au macroscopique. Cela suppose une prise en compte de tous les niveaux d’organisation de ces systèmes complexes que sont les milieux de vie et une étude de leurs dynamiques propres :
« L’idée d’un territoire se maintenant lui-même en bonne santé rend mieux compte de l’aspect dynamique des écosystèmes que l’idée conventionnelle de préserver des vignettes de l’Amérique primitive. Et si l’idée d’une santé du territoire remplaçait l’idée conventionnelle de nature sauvage comme paradigme de la protection, alors nous pourrions commencer à envisager des moyens pour réintégrer l’homme dans la nature de manière créative » 24.
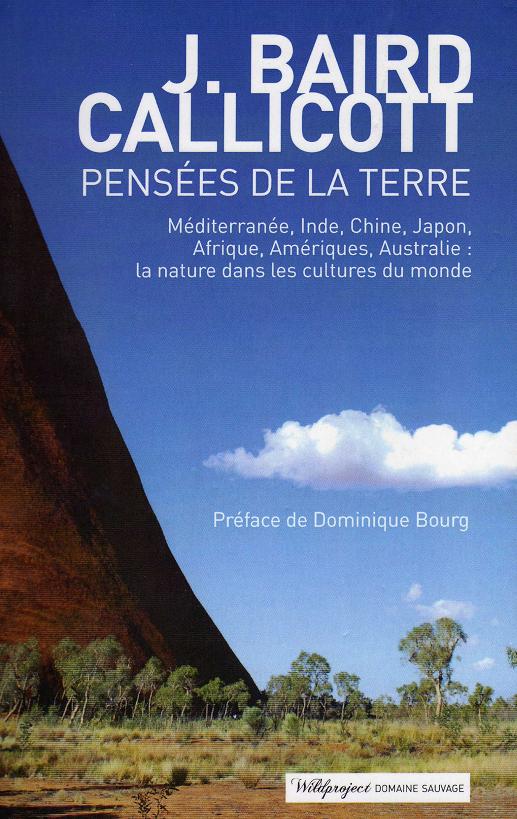
Pensées de la terre
Le volume Pensées de la terre, Calicott offre un panorama très complet des rapports des différentes cultures du monde à leur environnement. La découverte de ces pratiques et de ces mentalités est d’abord de présenter différentes idées qui mériteraient de se répandre. Soit par exemple le peuple San, encore appelé !Kung, habitant le désert du Kalahari 25 : « Ils considèrent l’exceptionnelle diversité de la faune sauvage de leur environnement comme une communauté de sujets -une communauté composée d’êtres animés par la même conscience dont bénéficient les êtres humains […] La vision du monde san met les êtres humains et non humains sur le même plan psychologique et métaphysique, en dépit de l’habitude qu’ils ont d’insulter le gibier. D’un point de vue pratique, les San se considèrent donc comme membres et citoyens de la communauté biotique » 26.
De plus, le contact avec d’autres systèmes de pensée peut suppléer aux insuffisances de notre propre pensée : « Les tentatives pour étendre les éthiques occidentales aux entités naturelles non humaines et à la nature dans son ensemble se sont montrées contre-productives, lorsqu’elles se sont appuyées sur des dualismes moraux tels que “le plaisir est bon et la souffrance mauvaise” ou “la vie est bonne et la mort est mauvaise”. Ajoutez-y l’axiome éthique selon lequel, en tant qu’agents moraux, notre devoir est de maximiser le bien et de minimiser le mal. Puis appliquez ces concepts à la nature. Les approches occidentales classiques, étendues telles quelles à la nature, nous obligeraient à pratiquer une division entre les bonnes et les mauvaises créatures et à condamner l’âme même des processus écologiques – les relations trophiques – comme s’ils étaient mauvais en eux-mêmes, puisque la souffrance et la mort son inhérentes aux processus écologiques. Dans la position hua-yen, qui donne en quelque sorte une tournure bouddhiste à la conception chinoise des opposés, c’est-à-dire polaire et non duelle – le plaisir et la souffrance, la vie et la mort son identiques » 27.
Il pourrait toutefois sembler peu judicieux d’aller chercher très loin des solutions à nos propres problèmes, là où notre tradition nous offre suffisamment de ressources intellectuelles. L’auteur ne propose toutefois pas un catalogue des cultures par goût de l’exotisme : en plus de décrire avec autant d’exhaustivité que possible comment les cultures du monde entier ont pensé le rapport de l’homme à la « Nature » (avec toutes les réserves que l’on peut avoir quant à l’universalité de ce terme 28), Callicott montre comment différents peuples ont su prendre appui sur des traditions parfois millénaires, pour évoluer dans leur pratique, dans le sens d’un plus grand respect de leur environnement -c’est-à-dire aussi en luttant contre ceux qui veulent dévaster leurs territoires au nom du profit :
« Les Kayapos sont également récemment apparus comme les leaders de ces Indiens amazoniens qui résistent à la destruction de la forêt, leur maison. Ils ont réussi à repousser différents groupes qui voulaient s’introduire illégalement sur leur territoire : entre autres des occupants sans titre euro-brésiliens, des spéculateurs fonciers, des chercheurs d’or et des exploitants forestiers » 29.
Nous pouvons prendre appui sur des traditions pour nous changer aujourd’hui ; la tradition, autrement dit, n’est pas l’ennemie du progrès mais bien sa condition. Ce n’est qu’en prenant appui sur un héritage (culturel, religieux) que l’homme peut trouver les ressources morales pour s’affirmer et agir. C’est dire qu’une véritable révolution dans nos moeurs ne passe pas par la rupture violente avec le passé, qui devrait être renvoyé à l’archaïsme. Citons encore l’exemple des différents mouvements menés par les Indiens des hauts-plateaux andins (Bolivie, Pérou), qui ont débuté comme une défense de la Pachamama (la terre-mère), donc comme une expression potentiellement nostalgique d’un refus de la modernité, mais qui se constituent aujourd’hui en critique de l’industrialisation capitaliste à marche forcée : du folklore à l’altermondialisme…
Dans Genèse, Callicott s’intéresse cette fois aux fondements de notre propre culture et montre, par une relecture du premier livre de la Bible, comment nous pouvons y trouver des ressources pour penser notre rapport à la nature : ni séparés d’elle, ni unis à elle, mais en charge d’elle. Callicott met en doute l’idée reçue selon laquelle la tradition judéo-chrétienne a toujours défendu l’idée d’une séparation radicale entre l’homme et la nature, et d’une supériorité du premier sur la seconde.
L’humanité ne disparaît pas dans le paradigme que Callicott voudrait voir émerger.
En particulier, malgré la peur qu’inspire généralement le terme « holisme » (qui demande une vision globale, donc totalisante, donc totalitaire…), il n’y a pas à craindre pour la place de l’humanité ou de « l’individu » . Callicott ne propose pas de revenir aux périodes archaïques où l’homme était dominé par la nature, effrayé par le tonnerre et à la merci de tous les prédateurs. Si l’humanité y perd de son orgueil, c’est peut-être qu’elle comprend mieux à quel point elle est dépendante de son environnement. C’est au contraire la destruction de cet environnement qui atrophie les possibilités de vie humaines, alors que la diversité biologique peut aussi être source d’expériences plus riches et plus variées. Si Callicott, de par son approche holiste, montre ce qui dépasse l’individu, c’est aussi pour lui proposer une relation plus en symbiose avec le monde -symbiose ne voulant pas dire fusion ni disparition, mais relation plus sereine et plus profitable à tous points de vue.

Yosemite Park. Photo NR.
La Nature retrouvée ?
Dans sa postface à Genèse, Catherine Larrère, la spécialiste française de Callicott, écrit que ce dernier renoue avec deux thèmes oubliés depuis longtemps : la Nature et Dieu. A lire Callicott, je n’ai pas eu l’impression que sa pensée constitue un retour si clair à ces deux thèmes. Si l’on peut oser la comparaison avec Rousseau – qui ne retenait du contenu de la religion chrétienne que ce qui pouvait être utile à une constitution civile, on peut dire que Callicott ne retient des pensées de la Nature que celles qui peuvent être utiles pour une éthique environnementale. Son projet se veut somme toute modeste :
« A la place de la théorie de la correspondance entre vérité et réalité, caractéristique du paradigme moderne, on ne trouvera pas, dans le paradigme moderne reconstructeur, une nouvelle théorie de la vérité. Mais une conception pragmatique et évolutive de ce qui est soutenable pourrait prendre sa place » 30.
Callicott cherche à extraire des systèmes religieux leur part d’environnementalisme, puisque tous en contiennent. Pour sa part, il ne spécule guère sur une présence de Dieu dans ou au-dessus de la Nature. Tout au plus décélérait-on, à l’arrière-plan de son propos, un certain sentiment de la totalité cosmique, comparable à celui qu’exprimait Thoreau, dans une incitation à revenir à vie plus simple, dans un juste équilibre entre civilisation et vie sauvage. Encore Callicott ne fonde-t-il nullement son argumentaire sur un sentiment ou une émotion de la nature, mais bien sur les avancées de l’écologie et une critique de l’anthropocentrisme moderne. A vrai dire, il semble soucieux de définir un concept de nature sur lequel croyants et non-croyants puissent s’accorder, indépendamment de leurs convictions religieuses.
Les hommes doivent mettre de côté leurs dogmes et réfléchir, pragmatiquement, à un nouveau rapport à l’environnement. Pour cela, quoi qu’il en coûte à nos convictions, il faut assumer un dépassement du paradigme moderne, « ce rameau jadis vigoureux, mais aujourd’hui desséché » 31.
Comme on l’a vu, engager cette rupture avec la tradition est en même temps une façon de reprendre le fil de cette tradition, qui nous encourage à changer quand la préservation en l’état n’est plus possible. La pensée moderne était elle-même une rupture, consciente et volontaire, avec le système de pensée hérité du Moyen-Âge. L’homme, comme la nature, évolue. Nous avons besoin de repenser un antique et vénérable concept, la Nature, d’une façon inédite. Callicott nous enjoint bien à penser un monde nouveau, et cela commence par une refonte de nos catégories philosophiques, donc un effort de pensée en profondeur, ce que Gregory Bateson appelait une écologie de l’esprit.
- John Baird Callicott, Éthique de la terre ; Pensée de la terre ; Genèse. La Bible et l’écologie, éditions Wildproject, 2009-2010.
- Page 33.
- Page 33.
- Page 16.
- Page 51.
- Page 36.
- Page 63.
- Page 59.
- Page 73.
- Page 77.
- Page 73
- Page 73.
- Page 100.
- Pages 140-141.
- Pages 138-139.
- L’expression est de Catherine Larrère dans la postface de Genèse.
- Pages 184-185
- Page 185.
- Page 222.
- Page 222.
- Page 195.
- Pages 215-216.
- Page 213.
- Pages 223-224.
- Peuple popularisé par le film Les dieux sont tombés sur la tête (1980). Le point d’exclamation dans leur nom correspond à un « clic » imprononçable tel quel pour nous.
- Pensées de la terre, page 273.
- Ibid., page 155.
- Pensons là encore aux quatre ontologies définies Ph. Descola : ni l’animisme, ni le totémisme ni l’analogisme ne conçoivent de discontinuité radicale entre humains et non-humains.
- Ibid., page 225.
- Page 282.
- Page 291.








