Dans son dernier essai, L’homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile 1, Jean-Michel Besnier critique le développement technologique contemporain et l’emprise grandissante du machinisme sur nos vies. Il part du paradoxe suivant : la complexification de nos moyens techniques et de notre organisation sociale engendre en retour une vision simpliste de l’être humain, réduit à une machine parmi d’autres. « Telle est la situation que ce livre voudrait comprendre : l’aberration consistant à déléguer sans limites aux machines le soin de régler nos relations et nos rapports avec le monde ; l’absurdité consistant à se laisser administrer comme de simples choses, par des automates qui n’ont besoin de solliciter en nous que l’élémentaire et l’abstrait » 2.
Témoin de cela pour l’auteur, les agaçants répondeurs téléphoniques de bureaux, qui nous demandent d’appuyer sur une suite de touches pour progresser dans une arborescence prédéfinie afin de catégoriser notre demande et de nous mettre en relation avec un conseiller. Besnier pointe indéniablement des travers flagrants, déjà dénoncés avant lui, de la modernité technologique, mais il ne débouche sur aucune conclusion très claire et ne propose pas de réel contre-modèle à cette « robotisation » de l’existence. La raison principale en est, me semble-t-il, que son analyse nous enferme dans une double impasse : soit nous essayons de développer une pensée plus complexe, afin de nous mettre à la hauteur des progrès techniques, mais dans ce cas, nous nous comporterons comme des machines (dont on perfectionnerait le programme) ; soit nous cherchons la voie de la simplicité dans un monde très compliqué, mais dans ce cas, nous devenons aussi des machines, plus efficaces mais plus binaires. En somme, ça ne va jamais : comme les machines simplifient tout à l’excès mais qu’elles nous compliquent toujours plus la vie, il n’y a pas grand’chose à faire pour échapper à leur domination, sinon se réfugier dans une vague spiritualité rehaussée de sentimentalisme « littéraire ». J’essaierai dans cette recension de préciser les raisons de cette impasse.
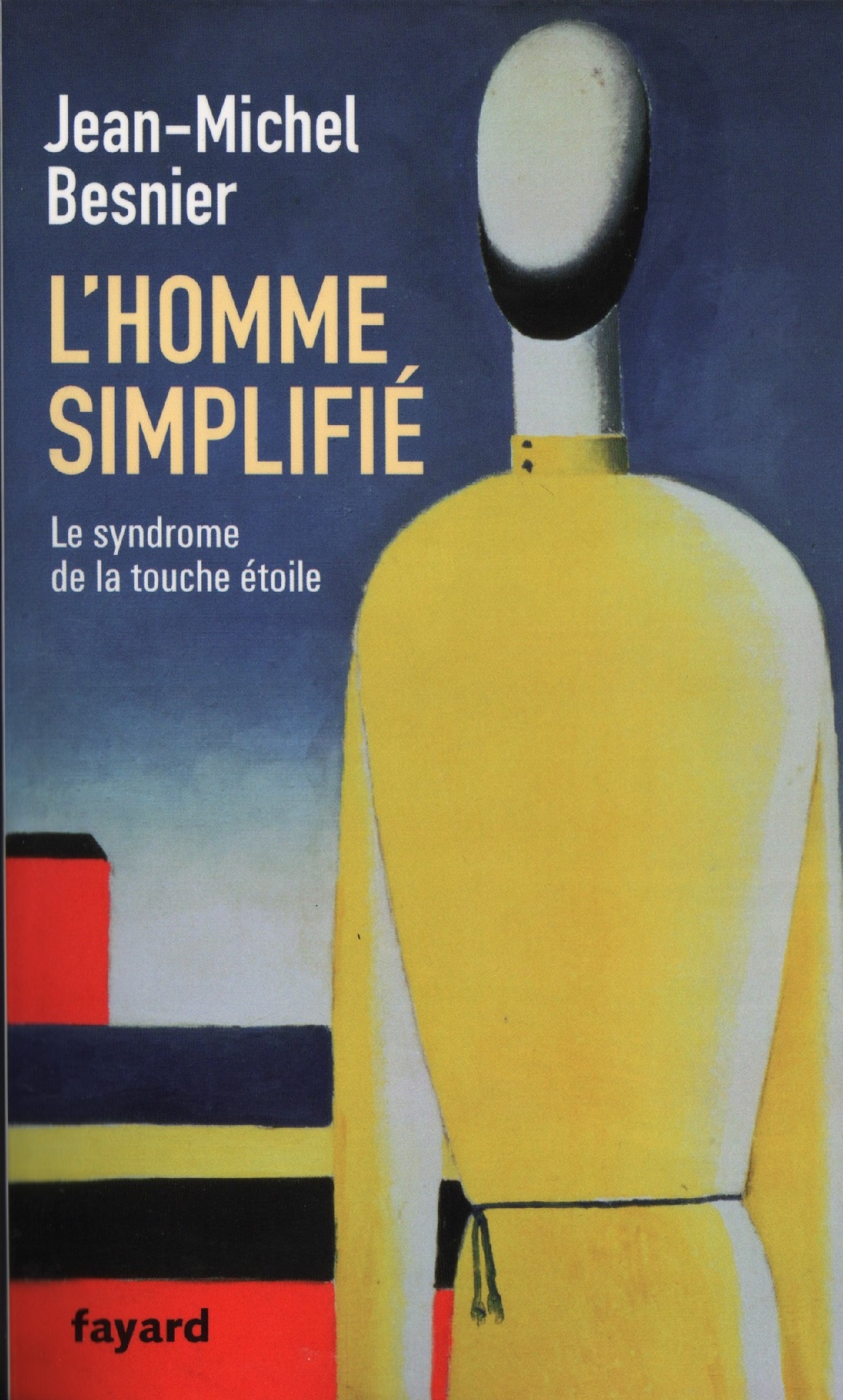 L’homme et ses machines
L’homme et ses machines
Nous avons fait confiance aveuglément à la technique pour nous simplifier la vie mais cela s’est retourné contre nous : à force de vouloir faire toujours plus simple, nous ne supportons plus la complexité. Nous y voyons des obstacles intolérables, qu’un surcroît de moyens techniques devrait lever. Rapidement, le cercle vicieux se referme : nous demandons aux machines de tout faire à notre place et nous leur déléguons de plus en plus de responsabilités. Besnier dénonce la bêtise de ce refus de toute difficulté. L’humanité en l’homme devient même un reliquat indésirable, une part d’imprévisible et de confusion qui perturbe nos cadres rationnels et diminue notre efficacité dans l’action. « Un monde parfait, en somme, que celui qui écarte toute complication de l’esprit des hommes. Mais ne reconnaît-on pas là l’ambition de bien des utopies habitées du souci de réglementer au plus simple ? » 3
Cette croyance à la perfection d’un monde régi par la technique nous égare totalement sur nos capacités et nos limites. La simplification à outrance détruit l’esprit humain et se manifeste par des pathologies parfois très graves : « Vouloir faire le bonheur de ses enfants est naturel et ce bonheur, les parents ne songent pas à le redouter comme une absence de barrière contre l’offensive possible de la maladie, qui a détruit Zorn. Reste que l’histoire de ce jeune Suisse, né dans une famille aisée et pathologiquement pétrie de conformisme bourgeois est singulière mais cependant éloquente pour qui s’interrogerait sur les formes prises par la dépression dans les sociétés modernes. Elle met en effet l’accent sur la dimension la plus redoutable du mal-être contemporain : l’illusion de la perfection que veut entretenir la dynamique de nos progrès et qui rend si pitoyable la réalité de notre impuissance » 4.
A la suite de Jacques Ellul et d’Ivan Illich, Jean-Michel Besnier critique l’omniprésence quotidienne de la technique et ses effets pervers : envahissante, elle ne nous sert plus, elle nous asservit. Elle nous oblige à nous comporter comme des machines : « Supposons que nous intégrions les automatismes qu’elle [la machine] requiert – comme nous le faisons dans le contexte de la conduite automobile -, nous serions alors totalement désinhibés et disposés à suivre aveuglément les instructions qu’elle nous dicte. Nous nous comporterions avec elle comme une autre machine dépourvue de réflexion, seulement capable de s’ajuster à l’embrouillamini des rouages qui menacent, quand nous y pensons, de nous paralyser. C’est cela que cherchent à obtenir nos machines : la désinhibition des comportements, l’immédiateté des réactions, la simplicité de l’interaction » 5.
Je me demande si l’argument est bien formulé. Il faudrait distinguer nettement entre l’utilisation d’une machine et la réduction de l’homme à la machine. Or l’une entraîne-t-elle nécessairement l’autre ? On ne peut nier le caractère abrutissant du travail à la chaîne par exemple. Apprendre à empaqueter des boîtes de conserves dans des cartons demande l’apprentissage de gestes élémentaires, qui seront ensuite répétés indéfiniment, presque automatiquement. Il n’en demeure pas moins qu’il y a chez le travailleur le plus spécialisé un minimum de conscience et d’implication dans son travail, attitude qu’on ne saurait attribuer à la machine. De plus on peut montrer, tout au contraire, qu’apprendre l’utilisation d’une machine ne nous réduit pas du tout à un état machinal, mais sollicite au contraire nos facultés « supérieures » (conscience, intelligence, anticipation…) Un automobiliste reste tout de même un être humain vigilant, attentif à la route et à sa façon de se comporter avec les autres gens sur la route. De plus, je ne crois pas qu’aucune machine exige de nous une déshinbition incontrôlée de nos pulsions, ni qu’elle nous dicte quoi que ce soit, sauf si nous le voulons bien. Ce ne sont pas les machines qui nous asservissent, ce sont plutôt certains détenteurs d’autorité qui exigent de la soumission de la part de leurs subordonnées et qui leur impose des conditions de travail odieuses (pensons au cas d’Amazon). On peut au contraire penser que l’utilisation d’une machine requiert de la part de l’utilisateur un contrôle de ses impulsions, afin de ne pas provoquer une panne ou un accident, et ce d’autant plus que l’outil ou la machine qu’on manipule est dangereuse.
Un bon usage passe par une utilisation réfléchie, pas par l’ « immédiateté des réactions ». Seul un novice ou un irresponsable cède à sa première impulsion et ne prend pas le temps d’apprendre à utiliser la machine. Le travail qui maîtrise parfaitement ses outils et ses machines est au contraire consciencieux. C’est lui au contraire qui a besoin de toute son attention et de sa réflexion. Il n’est donc pas si certain que la civilisation machinique fasse de l’homme une machine parmi d’autres.
Ce dont parle l’auteur s’appliquerait mieux, à tout prendre, aux jeux en ligne par exemple, où ce qui est requis est en effet une vitesse de réaction quasi-instantanée, un engagement total dans la partie, une compréhension parfaite des mécanismes du jeu. Il faut aller vite, être précis et recommencer un nombre indéfini de fois, quitte à s’emballer, à perdre provisoirement conscience des limites, à verser dans l’excès. Mais cela est du domaine du ludique, pas de l’utilisation habituelle d’une machine. Quand un trader se laisser emporter par la frénésie spéculative, il n’est plus rationnel dans son comportement. Il se laisse entraîner dans un jeu dangereux, qui le dépasse, et qui aura des conséquences bien réelles dans le monde, au contraire d’une partie d’Angry Birds ou de Candy Crush…
On pourra donc trouver le constat suivant aussi sévère qu’excessif : « L’intelligence humaine mise au service de la réalisation de machines destinées à la relayer et à la supplanter, tel est le programme qui détermine aujourd’hui les innovations technologiques et qui ressemble parfois à celui d’une autodestruction de l’homme » 6. On peut en effet imaginer un scénario à la Terminator, où le réseau mondial Skynet devient conscient et entreprend d’éliminer physiquement les hommes. Il est vrai qu’on peut exemple s’inquiéter du contrôle de plus en plus efficace sur nos vies réalisés par les programmes informatiques de Google ou de Facebook, qui sont capable de collecter des informations toujours plus détaillées sur notre comportement en ligne, la responsabilité en est toujours, me semble-t-il, humaine. Le plus inquiétant dans Facebook n’est pas tant le ciblage publicitaire mais les ambitions démesurées de Mark Zuckerberg.
La peur que l’homme soit un jour remplacé par des robots appartient elle aussi aux lieux communs de notre époque ; elle sert de sonnette d’alarme sur laquelle on peut tirer à plaisir. « Les robots ont un bien bel avenir devant eux, comme s’ils incarnaient paradoxalement notre ambition à être dessaisis des complications de l’existence. Qu’on puisse projeter sur eux les idéaux d’un posthumain devient de moins en moins surprenant. Ils sont évidemment le produit de procédés techniques fort complexes mais aussi le résultat d’une simplification réussie dans les fonctions qu’ils remplissent et que nous sollicitons. Ils sont dépourvus des complications avec lesquelles nous nous débattons, lorsqu’il faut décider et agir consciemment » 7. Aboutissement extrême de cette logique, les mouvements du post- ou du transhumanisme, qui sont invoqués à plusieurs reprises par l’auteur comme repoussoirs. Ils rechercheraient la fin de l’humanité telle que nous la connaissons, destinée (selon eux) à évoluer vers une forme supérieure de vie, grâce à des hybridations homme/machine de plus en plus poussées. Il est probable que, parmi ceux qui se lanceront dans cette voie, il y aura beaucoup d’apprentis sorciers qui se laisseront grisés par des rêves de toute-puissance et d’immortalité, avant d’obtenir quoi que ce soit de convaincant en terme de progrès.
On peut donc s’accorder avec Jean-Michel Besnier quand il y voit une illusion, qui masquera la réalité de notre impuissance misérable. L’homme relié à la machine, fusionné avec elle, sera-t-il un surhomme en corps et en esprit ou un gringalet pitoyable, entièrement dessaisi de ses forces vitales et intellectuelles ?… Pour le moment, tout ce qu’on peut dire, c’est que les thèses « post-humanistes » ont le charme des positions extrêmes : on peut se faire peur avec, on en voit vite les défauts et on n’est jamais à bout d’arguments pour les réfuter.
Littéraires et scientifiques
Face à une société trop scientifique, la solution de l’auteur serait de rétablir la dignité des humanités, afin de contrebalancer les excès de la rationalité par la « profondeur » de la littérature. Mais pourquoi concéder si vite que les sciences et les technologies ont le monopole de la rationalité d’une part, et d’autre part, qu’elles sont si superficielles ? Si on l’admet, on doit bien concéder que la littérature et les beaux-arts, pour charmants qu’ils soient, sont du côté de la profondeur, mais aussi de l’irrationnel. Il y a là une argumentation des plus douteuses, dans laquelle on s’enferre dès qu’on a accepté l’équivalence entre rationalité et efficacité instrumentale, et entre « poésie et profondeur ». Il est alors inévitable d’en déduire que la littérature, cette brave fille qui a les mains vides mais beaucoup de bons sentiments, peut seule nous sauver. « D’une part, une culture scientifique visant l’explication du monde et prompte à traiter les humains comme des choses inscrites dans des relations quantifiables et causalement déterminées et, d’autre part, une culture littéraire se proposant la compréhension empathique des êtres habitant le monde et soucieuse de leur préserver un horizon universel d’accomplissement. Le consentement à voir disparaître cette dernière culture, chez les décideurs politiques et économiques tout comme parmi un nombre croissant d’usagers des institutions d’enseignement, est révélateur de la relation inversement proportionnelle que l’on établit entre l’efficacité économique et les valeurs spirituelles » 8.
Indéniablement, cette coupure entre les lettres et les sciences est intenable. Artificielle, elle entretient une coupure culturelle entre deux domaines qui n’ont aucune raison d’être séparés, encore moins opposés. Pratiquement parlant, elle entretient même un esprit de rivalité entre les « littéraires » et les « scientifiques » : aux sciences la rationalité, dure et froide certes, mais redoutablement efficace ; aux « humanités » le sublime, la beauté intérieure, la quête de l’ineffable. Il est vrai que si un tel partage du travail intellectuel était fondé, il n’y aurait pas beaucoup à hésiter et l’on pourrait sans grand regret laisser nos volumes de Chateaubriand ou de Proust prendre la poussière au fond de la bibliothèque. Toutefois, je ne suis pas certain que la littérature et la poésie soient essentiellement l’expression de vagues émois personnels. De plus, il faut se rappeler que toute entreprise scientifique, en tant qu’elle mise sur le progrès, a bien pour origine l’idéal d’un accomplissement humain. Ce principe est peut-être perdu de vue aujourd’hui, mais pourrait être retrouvé à même les sciences. Si on acceptait tout à fait la coupure entre deux cultures, et qu’on admettait que le mal-être contemporain provient de là, on se retrouverait alors dans la situation où le littéraire aurait les moyens intellectuels d’exprimer son mal-être, mais personne pour le prendre au sérieux, tandis que le « scientifique », en tant que dominant, pourrait se faire entendre, mais ne saurait pas formuler ce même mal-être qu’il ressent confusément. De sorte qu’à la fin, tout le monde souffre dans son coin. Car le littéraire les maudira, oh oui, il les maudira, ces arrogants « scientifiques » ; il les vouera aux Gémonies (expression qu’ils ne connaissent même pas) ! Il opposera la richesse de sa vie intérieure tourmentée (il lit Dostoïevski) à leur attitude débonnaire de matérialistes satisfaits. Tandis que ces derniers ne verront dans la littérature qu’un bavardage fleuri pour inadaptés sociaux.
Dans son premier roman, Paris au XXème siècle, Jules Verne a mis en scène cette opposition de la façon la plus théâtrale qui soit, en révélant aussi involontairement son côté caricatural : le héros, jeune auteur romantique, est confronté à cette capitale du futur, tout entière tournée vers le progrès machinique. Dans ce monde de progrès technologique incessant, quelle part reste-t-il à la poésie, au rêve ? Bien peu et notre romantique s’en apercevra vite en s’effondrant dans la neige face à cette ville ingrate qui n’a pas su reconnaître son génie.
On aura compris où je veux en finir : nous souffrons de cette division, marquée dès le lycée, entre les littéraires et les scientifiques. Elle est absurde mais je crains que Jean-Michel Besnier ne fasse que la reconduire. Et j’ajouterais : sous une forme très contestable. Cette idée que la poésie est de l’ordre de l’indicible, de l’incommunicable, qu’elle flotte, légère mais immatérielle au-dessus du monde, comme un ange, je crois qu’il faudra la remiser au placard des idées toutes faites, voire la jeter au coin d’un quelconque « dépotoir doxique » (comme dirait Maxence Caron). On ne peut pas accepter sans dommage pour elle que la vieille littérature vienne épaissir d’un nouveau chapitre le catalogue des récriminations contre la technologie. Je crois donc qu’il faudra trouver mieux que l’apologie de l’ineffable pour défendre la littérature, et mieux que la « littérature » ainsi entendue pour sortir de l’aveuglement et la soumission face à la civilisation technologique.
Le salut par l’intériorité
Contre la robotisation de l’homme, Jean-Michel Besnier en fait appel aussi à la spiritualité religieuse, mais là aussi de façon très allusive et vague : Comment résister à la simplification de soi ? « Peut-être en s’exerçant d’abord à l’insolence d’être inaccessible, en faisant réserve de soi… » 9 Comment ne pas devenir une machine ? « L’Occident chrétien avait découvert la subjectivité moderne avec l’exigence de l’introspection, ce dialogue avec soi-même dont saint Augustin, au IVe siècle après J.-C., avait donné le modèle. Nous sommes en train de l’oublier et de perdre, par là même, notre âme » 10. Besnier reprend les analyses de Zygmunt Bauman sur le monde liquide engendré par le capitalisme, fait de flux incessants qui passent à travers et nous échappent. « En tous les cas, il est clair que la représentation d’un monde dans lequel l’être humain pouvait encore vouloir se vivre solitaire, enfermé dans le tribunal de sa conscience, même assujetti à la notion d’un péché originel justifiant le recours à la religion – cette représentation a fait son temps. Dans un monde liquide, la consigne de saint Augustin : “Rentre en toi-même” n’a plus beaucoup de chances d’être observée » 11. Au passage, il ne faudrait pas trop vite rapprocher la méditation augustinienne (évoquée page 17) avec épreuve du dialogue philosophique défendu par H. Arendt (citée page 139) : « Toute pensée, à proprement parler, s’élabore dans la solitude, est un dialogue entre moi et moi-même, mais ce dialogue de deux-en-un ne perd pas le contact avec le monde de mes semblables : ceux-ci sont en effet représentés dans le moi avec lequel je mène le dialogue de la pensée » 12. L’un est une recherche de Dieu en moi, l’autre la réflexion sur la pensée d’un autre que je suis de bout en bout. Quoi qu’il en soit, le recours à l’intériorité augustinienne paraît pour tout dire assez sommaire. Il exprime moins une révolte qu’un désarroi. Il ressemble à un constat d’échec. Il est vrai que le retrait dans la vie spirituelle n’est plus un idéal depuis longtemps. On peut toujours y voir une solution de sortie hors du monde moderne.
Toutefois, il n’est pas certain que le renfermement dans l’intériorité puisse répondre à la menace de deshumanisation technologique. Il se pourrait même que cela ne fasse que soutenir cette situation, dans la mesure où le repli sur soi est lui-même un signe d’échec face à un monde vu comme peu attrayant ou franchement repoussant. Par exemple, la recherche du vide intérieur pour lutter contre le stress, la méditation zen pour retrouver une harmonie personnelle face à une vie au travail où l’on perd de plus en plus le contrôle, peuvent ressembler à des solutions mais sont peut-être des fuites si elles nous enferment dans l’intériorité. Dans cette quête, on ne trouve nulle richesse psychologique, rien qu’un abri provisoire contre les agressions extérieures (c’est le narcissisme pointé par Lasch). Nous ne devrions pas accepter une telle alternative : vivre résigné dans un monde deshumanisé ou se réfugier dans l’ascèse intérieure. 
Geminoïdes japonaises
La réappropriation de l’environnement technologique
Je verrais plutôt une voie de sortie hors de la « robotisation » dans la recherche de moyens d’expressions destinés à lutter contre l’abrutissement provoqué par une langue standardisée, réduite à des formules stéréotypées. Et c’est alors que nous aurions bien besoin de littérature et de poésie, pour apprendre à ne pas nous soumettre et à nous exprimer autrement que dans un sabir tout juste bon pour exprimer des besoins élémentaires, sans parler de la « novlangue » décrite par Orwell.
Toutefois, même sans recourir à la littérature, je crois qu’il est possible de reprendre le contrôle sur nos machines. Je reprends la citation faite plus haut (je souligne) : « Telle est la situation que ce livre voudrait comprendre : l’aberration consistant à déléguer sans limites aux machines le soin de régler nos relations et nos rapports avec le monde ; l’absurdité consistant à se laisser administrer comme de simples choses, par des automates qui n’ont besoin de solliciter en nous que l’élémentaire et l’abstrait » 13. Qui délègue sans limites, qui se laisse administrer ? C’est bien l’usager, l’utilisateur. Il y a donc de sa part sinon une volonté, du moins un renoncement, peut-être une complaisance, une paresse, un désarroi, ou que sais-je encore ?… Mais il y a bien un consentement tacite de sa part. Or, s’il y a là une attitude d’abandon, c’est qu’il y a possibilité de réappropriation. Nous ne devrions pas nous laisser hypnotiser par l’efficacité machinique. En effet, tout ce qu’on demande aux machines, c’est d’être efficaces (pourquoi en fabriquer sinon ?), et de l’être beaucoup plus que l’homme lui-même. Que l’on demande ensuite aux hommes de se comporter comme des machines est une autre question, qui n’est pas entièrement technique, et même sans doute pas essentiellement car il y a là une décision d’ordre anthropologique (l’homme est une machine), voire même métaphysique (le vivant est du mécanique), et enfin politique (l’organisation rationelle du travail).
Toute époque se laisse sans doute fasciner par ses découvertes technologiques et finit par voir la nature et l’homme d’après la forme de ses machines. Parce qu’il y a une dimension créatrice et ludique dans l’art, dans la littérature en particulier, il est indéniable que celle-ci peut (re)donner aux hommes le goût du jeu, de l’invention, qui est après tout une attitude à la racine commune de l’art et des sciences. C’est à nous qu’il appartient d’inventer ou de trouver des utilisations appropriées à nos appareils, afin de ne pas être soumis aux machines, ou à l’idée que nous nous en faisons. Je ne vais évidemment pas discuter de Flaubert avec l’opératrice à l’autre bout du fil, mais il y a des usages intelligents à trouver pour les technologies modernes. On peut discuter philosophie par Skype, débattre du romantisme sur Facebook pourquoi pas, avoir de longs échanges sur la spiritualité par mails, commander des livres intelligents sur Internet (parce qu’ils sont introuvables en librairie)… C’est toujours par un certain consentement qu’on se laissee aller au fatalisme. Le choix de la résolution ou de la résignation est, si l’on veut, tout intérieur… Il ne dépend en tous les cas aucunement de notre environnement technologique. Il est vrai qu’on ne résout rien en affirmant benoîtement que les machines, après tout, ne font que ce qu’on leur demande.
C’est à Michel Puech que je dois d’avoir appris la première loi de Kranzberg : « La technologie n’est ni bonne ni mauvaise et elle n’est pas neutre ». Cela signifie d’une part que la technologie tend à orienter nos comportements, et que nous sommes par là inciter à calquer notre pratique sur celle de la machine. Simenon disait ainsi que les romans qu’il tapait directement à la machine avaient un rythme plus rapide, imposé en quelque sorte par la rapidité de la frappe au clavier, par rapport à la lenteur relative que demande l’écriture à la main. Mais d’autre part, cette « non-neutralité » de la technologie signifie aussi que, si nous en prenons conscience, nous disposons d’une marge de manoeuvre non-nulle pour la faire basculer dans le sens de nos usages. Cela n’a précisément rien d’automatique -preuve que notre rapport aux machines n’est pas condamné à être machinal. On peut toujours faire l’usage le plus bête qui soit du smartphone le plus évolué (envoyer des SMS pleins d’abréviations et de fautes d’orthographes). On peut aussi prendre en main son appareil et se reprendre en main pour ne pas se laisser aller à la paresse. Puisque la machine ne l’exige pas de nous et même nous « incite » à ne pas le faire, cet effort ne peut venir que de nous. C’est pourquoi on peut même choisir d’éteindre son ordinateur et d’écrire un courrier à la main. D’ailleurs, depuis que les mails sont devenus la norme des échanges écrits, les lettres manuscrites que l’on reçoit par la poste ont bien plus de valeur, tant elles sont devenues rares. La voie de sortie est donc dans le fait que l’usage des techniques n’est lui-même pas complètement réductible à des questions techniques.
Le poids du progrès
Je crois que le principal tort des philosophies technophobes est de se méfier autant des machines que de l’homme lui-même. Elles sont foncièrement pessimistes. Elles dénoncent dans l’amour de la technologie une nouvelle idôlatrie, qui nous détourne de la vénération des vrais dieux, du respect des « vraies » vertus. Elles y voient une dégradation de la spiritualité humaine. C’est pourquoi je me demande au fond si toute critique globale de la technologie ne doit pas avoir recours à des arguments religieux, et même s’il est vraiment possible de mener une telle critique si ce n’est pour des motifs essentiellement religieux. Il est vrai que le livre de Jean-Michel Besnier ne permet pas de l’affirmer catégoriquement. En revanche, ceux de Jean Vioulac le laissent nettement penser, dont l’orientation technophobe extrême se réfère explicitement, du moins dans son dernier livre, à une vision religieuse et même apocalyptique de notre modernité [Jean Vioulac, Apocalypse de la vérité, Ad Solem, 2014. Lire [une recension du livre sur ce site.[/efn_note]. Or, je crois qu’une critique de la « Technique » sur ces bases est vouée à l’échec en théorie et qu’elle nous condamne dans la pratique à l’impuissance. Ce que nous devrions avoir en point de mire est moins l’omniprésence de la technologie que nos aveuglements et nos résignations. Nous pouvons aborder la technologie autrement que comme une réalité hostile, opaque, étouffante.
Or, les philosophies religieuses ne laissent finalement aucune chance à l’homme. Pour elles, un usage raisonné des technologies semble inenvisageable. A divers degrés, la technophobie nous condamne à l’échec. Ses partisans dénoncent le caractère tragique des méfaits que l’homme a engendrés en voulant améliorer en existence grâce à la technique. Ils ont décidé par avance de notre échec plus ou moins complet face à un monde qui nous échappe, comme si pour eux, la raison humaine ne triomphait que lorsqu’elle ne rencontre pas de véritables obstacles. On peut à l’inverse penser que c’est grâce à un effort rationnel que nous ne finirons pas gémissants « à demi-écrasés par le poids de nos progrès » 14.
En résumé, la technophobie repose sur quatre principes qui font système :
1) La Technique (avec un grand T) est une puissance indépendante de l’homme
2) La Technique menace la nature spirituelle de l’homme.
3) L’homme a déjà perdu le combat contre la Technique.
4) L’homme ne trouvera son salut qu’en se réfugiant dans une intériorité non-matérielle et non-technique, pure, désintéressée (la « littérature ») etc.
Autrement dit, tout rapport de rejet massif ou d’adhésion aveugle à la « technique » est assimilable à une attitude religieuse et même apocalyptique : damnation ou salut par la technologie. C’est la raison pour laquelle il est difficile de définir une attitude « agnostique » en matière de technologie, ce qui serait pourtant indispensable si nous voulons éviter d’être asservi intellectuellement par ce que nous avons nous-même créé.
- Jean-Michel Besnier. L’Homme simplifié. Le syndrome de la touche étoile, Fayard, 2012.
- Pages 14-15.
- Page 124.
- Page 122.
- Page 27.
- Page 29.
- Page 35.
- Page 106.
- Page 142.
- Page 17.
- Page 136.
- Hannah Arendt, Le Système totalitaire, Seuil, 1972, pages 276-277.
- Pages 14-15.
- « L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle ». Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, chapitre IV, page 338.







