Les intellectuels n’aiment pas le football. Les raisons en sont apparemment assez simples à comprendre. N’est-ce pas un sport idiot, dans lequel, selon la formule consacrée, vingt-deux imbéciles courent après un ballon ? Quelle sorte d’intelligence peut-on espérer d’un footballeur, sachant que c’est quelqu’un qui joue avec les pieds ? Le mépris envers le ballon rond est pour beaucoup d’intellectuels une sorte de rappel d’appartenance au monde des idées. La dénonciation rituelle des beaufs et des hooligans est indispensable pour bien rappeler tout ce qui sépare une tête pensante d’un supporter de Saint-Etienne.
On pourrait même prendre les choses dans l’autre sens, et dire que pour être un intellectuel, il faut ne pas aimer le football. Jorge Luis Borges ne résume-t-il pas tout le mépris qu’on peut avoir pour ce sport lorsqu’il déclare : « le football est universel car la bêtise est universelle » ? L’essai de Jean-Claude Michéa Les intellectuels, le peuple et le ballon rond, paru en 1998, prenait le contrepied de cette attitude « intello » et défendait le foot contre ses détracteurs, en attaquant ces derniers sur leurs raisons inavoués de détester le sport le plus populaire de la planète. Ce livre est réédité cette année, accompagné de trois autres textes, dans un volume intitulé Le plus beau but était une passe 1, dans lequel l’auteur va plus loin, en nous démontrant cette fois qu’il existe une véritable philosophie du football : non seulement parce qu’il est un objet digne d’intérêt pour la philosophie, mais surtout parce qu’il y a une philosophie dans le football lui-même, philosophie que mettent en oeuvre les grands champions et les grandes équipes, et dont discutent sans fin les passionnés du jeu à onze.
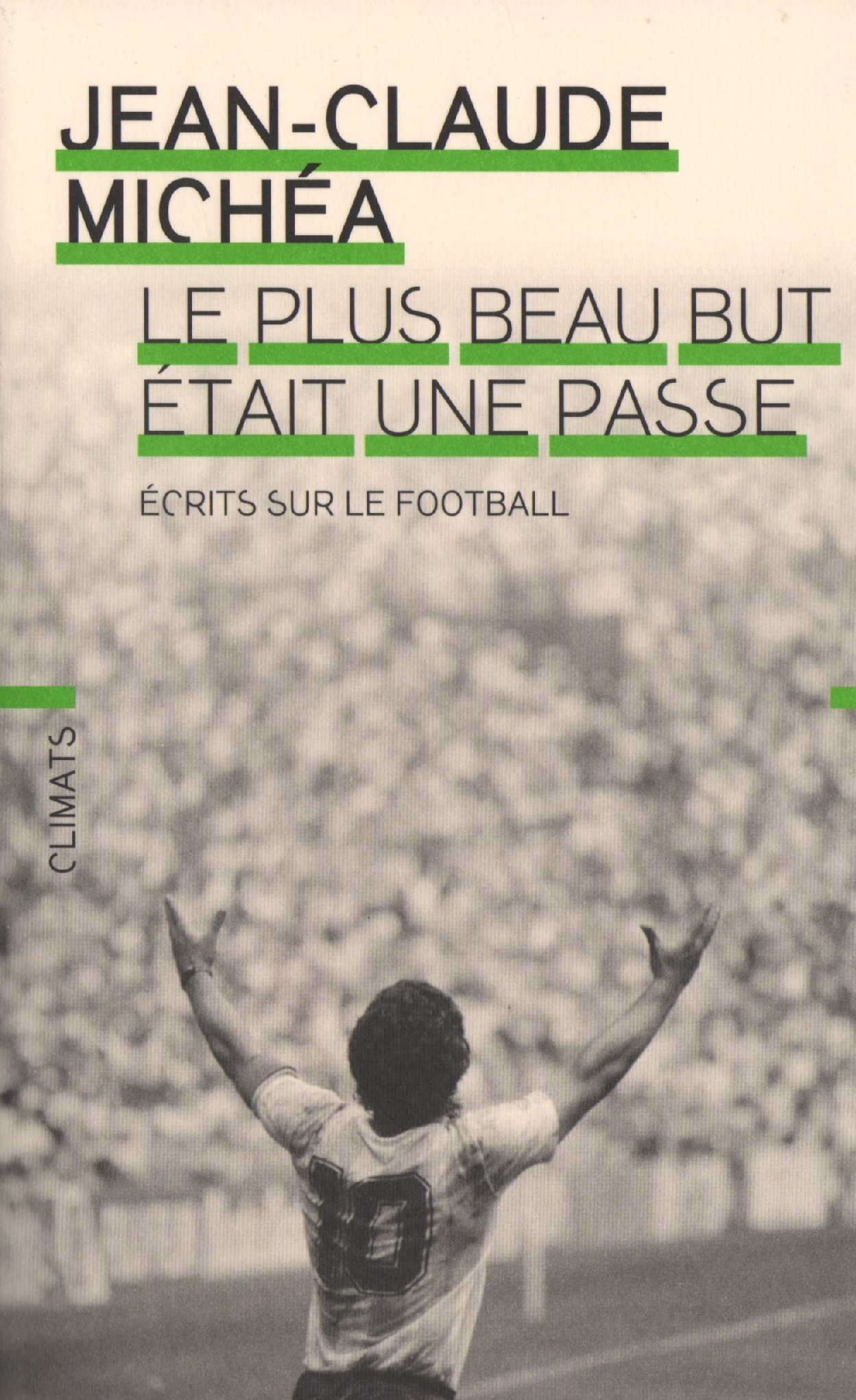
Les intellectuels, le peuple et le ballon-rond
Pourquoi le football est-il particulièrement détesté des intellectuels ? « […] D’autres sports – par exemple le tennis, qui exige une implication du corps au moins équivalente – ne sont pas diabolisés au même degré par les élites pensantes. Deleuze pouvait, sans trop déroger, reconnaître une valeur philosophique à l’art merveilleux de McEnroe. On imagine sans peine qu’un jugement du même ordre sur la technique de Cruyff ou celle de Platini lui eût valu la réprobation consternée de ses admirateurs. L’état de transe négative dans lequel le football a visiblement le don de plonger l’intellectuel moyen exige donc d’être expliqué par une cause plus fondamentale que le simple mépris compensatoire du corps. Et l’hypothèse la plus raisonnable qui, après élimination, se présente à l’esprit, c’est que si les intellectuels, dans leur masse, haïssent le football, c’est évidemment parce que ce dernier incarne le sport populaire par excellence » 2 On notera la remarque mordante (« les intellectuels, dans leur masse »), qui renvoie les contempteurs du football à leur conformisme grégaire, condition généralement attribuée par eux aux habitués des stades.
Michéa montre comment ce sport aux origines aristocratiques a ensuite été repris par les milieux ouvriers, qui sont venus contester sur le terrain la suprématie de la noblesse anglaise. Une véritable lutte des classes sur pelouse. De la démocratisation du football (et même de sa prolétarisation, au sens strict du terme,) date cette méfiance des classes aisées envers ce sport, désormais considéré comme bête et vulgaire. Tout au contraire, Michéa nous montre l’intelligence et la noblesse du football. Bien juger un match, apprécier la technique d’un joueur, comprendre la stratégie d’une équipe, ne sont pas des choses aisées.
Cela demande une connaissance très technique des gestes, des stratégies, des tactiques, c’est-à-dire un sens du jeu qui permet de lire le match, que ce soit comme joueur ou comme spectateur. Mais un tel savoir risque peu d’acquérir ses lettres de noblesse universitaire… car il est beaucoup trop commun (beaucoup trop banal, beaucoup trop répandu). C’est pourquoi, aux yeux des philosophes, il a de fortes chances d’être relégué en deuxième division, bien loin de la « Champions League » (si j’ose dire) des doctrines de Kant, Hegel etc. « Ce que la sagesse des Éclairés pouvait donc, à la rigueur, pardonner au tennis, au ski ou à l’équitation devient ainsi péché mortel quand il s’agit du football, et cela en raison même de la ferveur massive que ce jeu a toujours rencontré dans les classes de mauvaise compagnie » 3. S’il y a un regain d’intérêt pour le football aujourd’hui, s’il fait l’objet de tant d’attention politique, médiatique et économique, ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le jeu lui-même.
En devenant une énorme industrie, le football a été peu à peu assujetti aux règles de l’économie libérale : « […] Le système capitaliste ne peut maintenir son emprise sur les peuples qu’en pliant progressivement à ses lois l’ensemble des institutions, des activités et des manières de vivre qui lui échappaient encore […] Il aurait donc été étonnant qu’un phénomène culturel aussi massif et aussi internationalisé que le football puisse échapper indéfiniment à ce processus de vampirisation. Et, de fait, comme chacun peut le constater aujourd’hui, ce sport est devenu, en quelques décennies, l’un des rouages les plus importants de l’industrie mondiale du divertissement -à la fois source de profits fabuleux et instrument efficace du soft power (puisque c’est ainsi que les théoriciens libéraux de la “gouvernance démocratique mondiale” ont rebaptisé le vieil “opium du peuple”) » 4 Ceci nous explique aussi pourquoi les grands joueurs sont devenus des people, courtisés par les marques, pour leurs capacité à générer d’énormes profits et des retombées commerciales gigantesques. « A partir du moment, en effet, où les stars du football professionnel devenaient des top-models, posant dans les publicités et disposant de revenus aussi indécents que ceux des grands prédateurs du marché mondial, le monde artistique et intellectuel devait forcément finir par les considérer d’un autre œil » 5. Cet intérêt nouveau des classes supérieures pour le football a pour conséquence un embourgeoisement des tribunes. Comme l’explique cet article de Marianne : « [Le] stade de football n’est aujourd’hui plus un lieu de brassage social, mais un entre-soi. A Paris, l’entrée du carré VIP est autant un spectacle que le match de foot, l’équivalent des marches du Festival de Cannes. On vient regarder l’entrée en tribune de Bruel, Sarkozy, Arthur ou Nagui. Et le foot ne suscite plus le rire moqueur des VIP de la planète. Au contraire le « Carré » du PSG est désormais the place to be, l’endroit où il faut être et être vu. C’est le show-biz qui s’affiche aux côtés du sportif transpirant à la sortie du terrain. A Paris, tout politique ou people qui se respecte doit adopter la « Qatar attitude » les soirs de match. »[/efn_note].
Philosophie du football : jeu « socialiste »…
Pour expliquer cette dégradation du football professionnel, Michéa analyse le jeu des grandes équipes de l’histoire, celles qui ont cherché à déployer un football tourné vers l’attaque : « Le « beau jeu », offensif et spectaculaire […] est, en effet, celui dans lequel l’équipe fonctionne comme un collectif solidaire, dans lequel chacun prend plaisir à jouer en fonction des autres et pour les autres. Concrètement, cela signifie que, dans un match, le joueur qui reçoit le ballon ne doit jamais, en théorie, se retrouvé livré à lui-même (contraint, dès lors, de se débarrasser de la balle ou de mettre son équipe en danger en prenant un risque inutile). Il doit toujours, au contraire, voir se dessiner autour de lui un champ de passes virtuelles […] Champ de passes virtuelles (ou de « solutions ») que doit créer en permanence le mouvement collectif de ses partenaires […] Ils [les équipiers] ont donc pour mission permanente de suivre l’action en cherchant à tout moment à occuper les espaces libérés par le mouvement des partenaires et à proposer le plus de solutions possible au porteur du ballon, tout en veillant à chaque instant à anticiper l’éventuelle perte de balle ou les mouvements symétriques de l’équipe adverse. De là cette impression de tourbillon incessant et féérique que donne toujours une équipe portée vers l’offensive et le spectacle et qui maîtrise le mouvement collectif et le jeu de passes correspondant » 6.
Comme l’a montré Sylvain Portier, une telle philosophie du beau jeu, à la fois offensif et créateur, est celle de Zlatan Ibrahimovic : « Quand on pense au surhomme, on s’imagine que la volonté de puissance est destructrice, que c’est un instrument de domination. Or le héros, c’est celui qui vit sa vie pleinement, dans les grands et les petits moments, et qui est heureux de créer. Cette créativité est fondamentale pour Nietzsche. Zlatan, c’est absolument pareil. On se fourvoie sur le sens du mot « zlataner ». On s’imagine que cela veut dire défoncer, dominer, détruire, frapper avec violence. Or, zlataner c’est d’abord créer, épater par ce que je vais produire avec ma puissance créative. Zlatan ne veut pas marquer des buts, il veut surtout être heureux de ses buts, content en les regardant ensuite. »
Au coeur d’un système de rentabilité immédiate et de starification outrancière, Ibrahimovic parviendrait à retrouver la gratuité et le plaisir ludique qui sont l’âme du football. Mais le génie individuel ne peut expliquer à lui seul la réussite des grandes équipes. Pour Michéa, il ne faut jamais oublier ce que les attaquants de légende doivent à leurs coéquipiers. « Si, par exemple, Leo Messi est considéré aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde, c’est aussi parce qu’il sait pouvoir compter à tout moment sur les offrandes millimétrées d’un Xavi ou d’un Iniesta, de même que ces derniers sont en permanence aidés dans leurs décisions de passe par les appels lumineux du premier. On retrouve ici, en somme, l’idée fondamentale du socialisme originel et de la sociologie durkheimienne (Mauss était d’ailleurs lui-même un grand amateur de sports collectifs) selon laquelle c’est lorsqu’un groupe privilégie l’entraide et la solidarité (plutôt que la concurrence et la guerre de tous contre tous) que chacun peut rencontrer les conditions optimales de son propre épanouissement personnel » 7.
… et jeu « libéral »
A l’opposé de cette philosophie du jeu offensif, le football actuel est de plus en plus tourné vers la rentabilité, l’initiative individuelle, le manque d’inventivité, autant de marqueurs, selon Michéa, d’une invasion de la logique libérale. Or, pour bien comprendre cela, il faut déjà connaître très bien le football et son histoire. En effet, c’est celui qui connaît le mieux ce sport qui est le mieux capable d’en comprendre les dérives actuelles. N’importe qui est capable de parler de l’exploitation marchande de ce sport, de voir des ravages de l’argent-roi, dans le prix des transferts de joueur ou les salaires mirobolants des champions. Mais qu’en est-il, techniquement, de l’influence de cette logique commerciale sur le jeu lui-même ? Comment la façon de jouer s’en ressent-elle ? « Les statistiques sont d’ailleurs sans appel : aujourd’hui, une équipe de Ligue 1 ne réalise en moyenne que 200 à 300 passes par match (dont une grande partie sont des passes latérales ou en retrait, signe que l’équipe tourne en rond et ne parvient pas à construire du jeu). Là où le Barça -héritier flamboyant du vieux passing game ouvrier et du « football socialiste » de Gusztáv Sebes – en réussit, en moyenne, entre 800 et 900 par match (dont la plupart sont au sol et orientées vers l’avant). Si certains d’entre vous connaissent le tennis, nous avons là, en somme, l’équivalent footballistique de l’opposition naguère classique entre le jeu mécanique et monotone (bien que fascinant à sa manière) d’un Björn Borg et celui, créatif et spectaculaire, d’un John McEnroe. Ou, en d’autres termes -j’espère que vous me pardonnerez ce raccourci provocateur -, l’opposition entre un jeu libéral et un jeu socialiste » 8.
On le voit, deux philosophies s’opposent à même le jeu : celle qui privilégie la victoire à moindre coût et celle qui veut exploiter toutes les possibilités du sport, quitte à augmenter la prise de risque, mais aussi les occasions de marquer. Dans une logique utilitariste, on pourrait répondre que le but du sport n’est pas de faire du « beau jeu », mais bien de gagner. De sorte qu’il n’y a pas à hésiter entre un beau match perdant et un match sans surprise mais gagnant. Le football généreux devrait donc être remisé au musée, témoin d’une époque révolue, certes altruiste mais un peu naïve, où l’on n’avait pas encore atteint le vrai professionnalisme en la matière. Or, c’est cette logique-là que Michéa entend contester : la question n’est pas de savoir s’il faut tout faire pour gagner, mais de savoir ce qu’on fait pour gagner.
Pour le dire simplement, choisit-on la sécurité, avec une défense resserrée tout le match, en attendant l’occasion de contre, pour envoyer la vedette de l’équipe marquer l’unique but de la rencontre ? Ou bien pratique-t-on un jeu collectif et offensif, pour marquer le maximum de buts ? A l’extrême, quel type de score cherche-t-on ? Le 1-0 ou le 6-5 ?… Il y a bien deux façons de concevoir ce sport : soit en essayant de le jouer le plus intensément possible, soit en visant la rentabilité à moindres risques -ce qui revient à ne plus vraiment jouer, ou en tous les cas à aller contre l’esprit du jeu.
Mais Michéa, en disciple de Debord, ne fait-il pas l’apologie du spectacle, ce Spectacle qui serait caractéristique de l’aliénation consentie du citoyen-consommateur ? Le capitalisme ne réclame-t-il pas de la fête et de la liesse populaire pour engranger des profits ? Ne devrions-nous pas nous méfier d’un football trop spectaculaire ? Pour le fondateur du situationnisme, le Spectacle est un « rapport social médiatisé par des images » 9. Je crois que Michéa montre que si l’on connait bien un sport, on peut avoir un rapport non-aliéné au spectacle qu’il offre. Est aliéné celui qui regarde sans connaître, et ne saisit du football que son aspect le plus superficiel. De sorte que pour bien comprendre l’agrément pris à la rencontre, il faut se mettre à l’écoute des passionnés.
Selon Michéa, les fameuses et interminables discussions pour « refaire le match » participent d’une certaine heuristique ! Refaire le match, c’est à la fois le revivre en le racontant, mais c’est aussi le refaire au sens de le réparer, c’est-à-dire critiquer les différentes erreurs commises pendant la partie (l’entraîneur n’aurait pas dû faire sortir le joueur, l’arbitre aurait dû siffler, l’attaquant auraît dû faire la passe etc.). Or, de tels jugements, bien qu’ils ne portent pas sur des faits, ne sont pas dénués de sens. Nous aurions donc ici une véritable continuité entre le sens commun et la philosophie, à l’opposé de l’assertion bachelardienne selon laquelle « l’opinion, en droit, a toujours tort » 10. L’opinion footballistique ne serait pas si naïve. Il n’y aurait pas de rupture, pas de saut, entre discours ordinaire et discours philosophique. Il y aurait donc possibilité pour une philosophie populaire, qui ne se fonderait pas sur une destruction de l’« opinion ».
Conclusion
Si je ne craignais de confondre les sports, je dirais bien qu’avec le présent volume, Michéa a transformé son essai de 1998. Il expose une véritable philosophie du football, une philosophie tout court, avec toutes les conséquences économiques et politiques qui s’ensuivent sur les échanges humains et les fondements de la sociabilité. Ce nouvel essai s’inscrit donc pleinement dans la continuité des analyses de l’auteur sur la « civilisation libérale » 11
On voit aussi dans ce livre combien la philosophie est pour Michéa la marque d’un tempérament, d’une certaine attitude non seulement intellectuelle mais affective : il y a en effet chez l’auteur, comme chez ses inspirateurs Orwell et Lasch, un mélange paradoxal de pessimisme noir envers les dérives de notre époque et une reconnaissance émerveillé de tout ce qu’il y a encore d’admirable dans le monde -un certain alliage de nostalgie et d’amour du présent. Seule mentalité à même de soutenir une critique sans concession du monde, sans sombrer dans les déplorations stériles sur l’âge d’or perdu : la lucidité sans la résignation.
Appendice : une philosophie populaire est-elle possible ?
Au-delà de l’enracinement de la philosophie dans un tempérament, la question qui se pose est de savoir si l’on peut vraiment parler d’une philosophie du football, ou si l’emploi du terme n’est pas abusif. Dire qu’il y a une philosophie dans ce sport, n’est-ce pas juste une manière de parler ? Tous les entraîneurs ont leur « philosophie » du jeu, certes, mais est-ce vraiment un système de pensée digne de ce nom ? Il y va en fait de la possibilité d’une philosophie populaire. Il ne faut pas entendre par là une philosophie qui serait majoritairement adoptée ou plébiscitée, mais une philosophie dont les concepts seraient en accord avec l’essentiel des représentations communes. Or celles-ci ne sont-elles pas « naïves », « immédiates », « spontanées », donc pré-réflexives ?
Tel était le nerf de la polémique menée par Frédéric Lordon dans son article « Impasse Michéa », qui passait par une critique de la notion orwellienne de décence commune, centrale chez Michéa en ce qu’elle est à la fois le socle des représentations spontanées et un concept fondamental pour sa pensée. « […] qu’est-ce que la common decency ?, demande Lordon. On en cherche en vain une définition tant soit peu consistante. Bien sûr tout est fait pour donner le sentiment d’être immédiatement de plain-pied avec une notion qui semble parler d’évidence – manière de disposer au préaccord dont on sait qu’il est peu questionneur. Or questionner, il le faut bien. Car sinon voilà à quoi on a à faire : « la common decency est le sentiment intuitif des choses qui ne doivent pas se faire. » Mais quelle est cette intuition des « choses qui ne se font pas », d’où sort-elle, et qui l’éprouve ? Visiblement, elle n’est pas, ou plus, la chose du monde la mieux partagée, Michéa d’ailleurs ne le déplore-t-il pas à longueur de pages ? Mais comment un « penchant naturel au bien » peut-il se laisser effacer par l’histoire – puisqu’il est naturel ? Comment la « morale commune » cesse-t-elle d’être commune ? Commune à qui au fait ? Originellement au « peuple », dit-on – qui, s’il est un concept politique à peu près intelligible (et encore, non sans difficultés) est un concept sociologique des plus filandreux –, ou, pour ne rien arranger sous ce rapport, aux « gens ordinaires », « gens de peu », « petites gens » et autres évocations de la sociologie spontanée n’ayant pas d’autre ressource que le « vous voyez bien ce que je veux dire ». Eh bien non, précisément, on ne voit pas bien. »
Confuse, sentimentale, anhistorique, la notion de common decency n’apporterait rien de consistant au philosophe, encore moins au sociologue sérieux, qui, comme ne cesse de le rappeler Bourdieu, a d’abord pour adversaire la « sociologie spontanée » que chacun se fait en observant le monde autour de lui. Mais c’était oublier que pour Michéa, la common decency n’est pas un point de départ mais un aboutissement. En effet, cette attitude trouve son point de départ non dans un vague sentiment moral d’indignation mais bien dans une structure anthropologique fondamentale, celle qui soutient toute pratique d’échange.
Dans une tribune en réponse à ses détracteurs, Michéa écrit : « C’est donc bien, avant tout, dans le but d’assurer enfin un fondement théorique plus solide à ce sens intuitif de l’être-ensemble (ou de l’« association ») qui soutenait toutes les critiques du socialisme originel que j’ai entrepris –il y a bientôt vingt ans– de m’appuyer sur l’œuvre sociologique de Marcel Mauss (dont on oublie trop souvent qu’il était lui-même socialiste) et sur son idée matricielle selon laquelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre constitue effectivement la « trame ultime du lien social ». Structurellement antérieure, de ce point de vue, aux constructions plus tardives du contrat juridique, de l’échange marchand et de l’Etat […] ». S’il peut y avoir une philosophie populaire, ce n’est donc pas tant parce qu’elle s’accorderait avec des représentations et sentiments spontanés (même si cela y participe), que parce qu’elle saisit le fondement anthropologique de la décence commune, à savoir le respect de la triple obligation de donner, recevoir et rendre, qui se traduit ensuite en générosité, gratitude et reconnaissance. Les sentiments moraux sont donc comme des émanations de pratiques et de comportements qui fondent toute société. En les partageant et en les comprenant, le philosophe ne se perd pas dans l’affect, l’intuition immédiate mais trompeuse ; il se place dans la continuité d’un sens commun en prise sur la réalité, notamment en ce qu’il demande conformité des paroles et des actes, soit le respect de certaines règles élémentaires aussi bien logiques que morales.
Or, à moins d’accepter que ces sentiments moraux signalent quelque chose de réel, comment proposer une critique digne de ce nom des méfaits du capitalisme libéral, lequel choque la conscience en mettant à mal les obligations sociales nécessaire à la vie humaine ? La sociologie de Bourdieu et Lordon se signale au contraire par son amoralisme complet. Elle est volontairement dépassionné, froide quand elle soulève le capot et décortique le moteur brûlant des passions… Mais pourquoi moi, dominant, soucieux de maintenir l’ordre social et le confort qu’il m’offre, ne me servirais-je pas de ces théories pour mieux protéger mes privilèges ? Cela serait sans doute contraire à l’esprit de cette sociologie, mais est-ce que cela ne respecterait pas la lettre de ses analyses ? Par exemple, s’il est possible de décrire en terme de mécanisme le développement des passions collectives, qui commencent par l’indignation, puis dégénère en colère et enfin en révolte, pourquoi ne pas étouffer l’indignation dans l’oeuf, en disant que toute indignation repose sur une idée fausse ou une mentalité potentiellement intolérante, voire persécutrice ? Ainsi, j’aurai fait capoter dès le départ la révolte -et renvoyé la « multitude » à sa soumission. Malheureusement, on peut toujours faire un usage cynique d’un discours « purement » scientifique sur l’homme.
Or, si elle n’accorde pas à la conscience morale la capacité à voir clair dans les choses -donc si elle ne reconnaît pas de rationalité au sens commun- que vaut une critique des mécanismes de domination ?…
- Jean-Claude Michéa, Le plus beau but était une passe. Écrits sur le football, Climats, 2014. Le titre reprend une boutade d’Eric Cantona dans le film de Ken Loach, Looking for Eric (2009) : « Mon plus beau but ? C’était une passe ! »
- Page 100.
- Page 101.
- Pages 17-18.
- Page 21.
- Pages 64-65
- Page 65-66.
- Pages 76-77.
- La société du spectacle, 4ème proposition.
- Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique (1938), Vrin, p. 14.
- Voir Jean-Claude Michéa, L’empire du moindre mal : Essai sur la civilisation libérale, Flammarion, Champs, 2010.








