Jacqueline Lichtenstein, auteur d’un ouvrage de référence sur l’analyse philosophique de la couleur1, vient de publier un salutaire essai2 dans lequel elle s’en prend avec raison à tous ces discours philosophiques s’arrogeant le droit de parler de tout et, en particulier de la peinture, sans n’avoir la moindre connaissance théorique ni, et encore moins, pratique de cette dernière. Il n’est pas rare en effet de voir un certain nombre de philosophes s’approprier un domaine pictural sur lequel ils déversent nombre de commentaires sans que ceux-ci ne soient appuyés sur une connaissance sérieuse de l’histoire de l’art ni sur une pratique personnelle et intime de la peinture, comme si donc le commentaire philosophique s’autorisait de lui-même à s’affranchir de toute connaissance positive de l’objet de son discours.
« Je me suis souvent demandé, écrit l’auteur, en vertu de quel privilège un philosophe pouvait se sentir autorisé à parler de la peinture sans posséder en ce domaine aucune compétence ni connaissance. Car il s’agit bien là d’un privilège que la peinture apparemment ne partage avec aucun autre art. Les philosophes qui écrivent sur la musique savent en général de quoi ils parlent ; non seulement ils connaissent l’histoire de la musique mais ce sont aussi des musiciens. Ce ne sont peut-être pas toujours de grands musiciens, mais ils ont tous pratiqué un instrument – que l’on pense à Nietzsche, Schopenhauer, à Adorno ou à Jankélévitch. (…). Pourquoi est-ce si différent dans le cas de la peinture ? Pourquoi la peinture, et elle seule, autorise-t-elle toutes les dérives philosophiques, les interprétations sans contrôle, les analyses purement autoréférentielles ? Comment expliquer que la peinture puisse se prêter si facilement à servir d’objet à un discours philosophique sans objet ? »3 Il est difficile de ne pas souscrire à ce point de vue, qui annonce en même temps une problématique qui recevra une réponse essentiellement historique au cours de l’essai, puisque l’auteur cherchera à montrer que s’est progressivement mise en place une légitimité de l’ignorant à partir, notamment du XVIIIè siècle.
A : La culpabilité kantienne
Philosophiquement, le modèle du discours affranchi de toute réelle connaissance de l’art en général et de la peinture en particulier peut être référé à Kant, discourant de musique en ne connaissant guère que la fanfare de la ville et semblant n’avoir vu que deux ou trois tableaux de sa vie. C’est la raison pour laquelle J. Lichtenstein, dès l’avant-propos, convoque Kant pour pointer sa responsabilité dans cette émergence d’un discours auto-légitimé, incapable de faire l’épreuve de la positivités des faits. C’est pourquoi, selon cette dernière, « la principale responsabilité doit sans doute être attribuée au tournant esthétique pris au XVIIIè siècle, à la suite de Kant, par la réflexion sur l’art, le beau et le goût. L’idée d’autonomie du jugement de goût par rapport au jugement de connaissance et celle d’autonomie de la théorie esthétique par rapport à la pratique artistique sont non seulement à l’origine de la plupart des impasses philosophiques de l’esthétique, mais elles ont contribué à faire de l’esthétique cet asile de l’ignorance auquel elle ressemble malheureusement très souvent. »4
L’argument est assez percutant, et sans doute fort justifié ; s’il existe vraiment une possibilité de penser a priori les conditions d’un accord immanent au sujet au sein duquel imagination et entendement éprouvent leur concorde, alors il devient possible de discourir sur l’esthétique sans que ce discours ne fasse jamais appel à la moindre connaissance, à la moindre positivité, les œuvres elles-mêmes s’effaçant devant l’analyse de la possibilité pour le sujet de réfléchir son propre sentiment de plaisir, sentiment déterminé a priori, sous peine de s’engluer dans une détermination empiriste du jugement de goût. Mais alors, cela soulève deux difficultés, une principielle, et une d’ordre conséquentiel : la première porte sur l’objet du discours ; de quoi l’esthétique peut-elle réellement parler sinon du sujet lui-même, réfléchissant son propre état ou son propre sentiment ? Dans ce cas, si l’esthétique est bel et bien un discours du sujet sur lui-même, elle ne peut plus croiser ni rencontrer d’aucune manière l’art effectif, traçant donc une voie parallèle à celui-ci. Du point de vue des conséquences, cela génère le risque de légitimer le discours d’ignorants qui, évoquant l’esthétique, en déduisent à tort moult conséquences sentencieuses quant aux œuvres d’art, ce que synthétise fort bien J. Lichtenstein en ces termes : « Ce rejet de l’idée même de rationalité esthétique comme mode de connaissance implique une rupture entre l’esthétique et l’artistique (…), dont les conséquences ont été à bien des égards fondamentales. »5
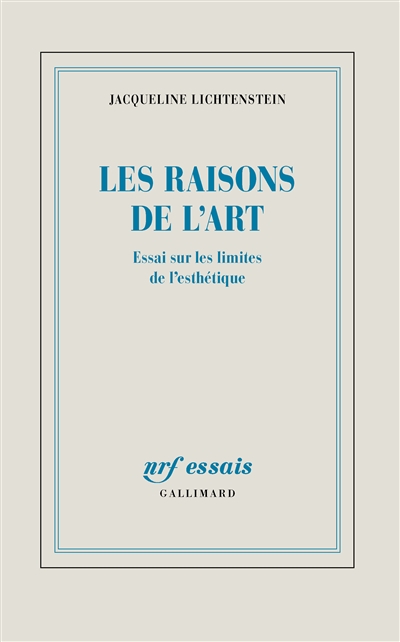
Mais il y a plus : si Kant est celui qui a somme toute introduit une voie de démarcation extrêmement étanche quant aux principes entre l’esthétique et l’analyse artistique tout en générant l’effet pervers de croire parler de celle-ci en n’évoquant que celle-là, il est aussi celui qui a commis une telle confusion, dont le symptôme, fort bien analysé par l’auteur, n’est autre que la critique menée dans la Critique de la faculté de juger de la règle. Dans le célèbre § 33, Kant semble en effet mener une croisade contre la naïveté de ceux croyant qu’il est possible de déterminer empiriquement les règles d’un goût faisant l’objet d’un assentiment universel ; contre une telle croyance, Kant affirme : « Ainsi n’y a-t-il aucun argument démonstratif empirique permettant d’imposer à quelqu’un le jugement de goût. »6 Ce combat de Kant contre ce qu’il pense être le goût classique devient le symptôme de l’ambiguïté de sa démarche : à partir d’une réflexion sur l’esthétique, et sur l’impossibilité d’un accord universel de facto faute de concept, Kant en tire une critique empirique dirigée contre ce qu’il croit être l’histoire de l’art du siècle passé, en particulier contre les classiques français. Mais, rappelle J. Lichtenstein, « ceux qu’on nomme les « classiques » n’ont jamais eu la naïveté de croire que les règles, si nécessaires soient-elles, pouvaient agir sur le goût à la manière de raisons suffisantes. Le fait de concevoir le goût comme une faculté de connaissance – à la différence en effet de Kant – ne les a jamais empêchés de faire la distinction entre le goût comme discernement et le goût comme préférence ou inclination. »7
En d’autres termes, ces règles n’ont jamais eu la valeur contraignante d’une cause et n’ont jamais valeur pour l’artiste de principe a priori puisqu’elles reposent sur des conditions pratiques. « Dans un cas, ce sont des règles pour bien juger, dans l’autre, des règles pour bien faire. Mais ces règles n’ont pas force de loi, ce qui signifie, pour emprunter une distinction élaborée par Rousseau, qu’on n’est jamais contraint d’y obéir, mais seulement obligé. »8
B : La notion de « règle » bien comprise
Cette réfutation de la critique kantienne donne lieu à une mise au point extrêmement fine et informée du sens de la règle dans l’art, mise au point d’autant plus informée que l’auteur a édité les Conférences de l’Académie de peinture9, et a attiré l’attention du public sur l’importance de ces leçons dans la formation du classicisme. La règle se présente ainsi comme un outil pour résoudre une difficulté qui se présente à l’artiste, si bien que la règle est toujours relative au dessein de l’artiste : la règle des trois unités par exemple répond à une nécessité interne : « elle n’est ni un dogme ni une norme, encore moins une contrainte extérieure à laquelle l’artiste serait obligé de se conformer sous peine d’encourir les foudres des censeurs, mais une solution strictement théâtrale à un problème spécifiquement théâtral. »10
Par sa relativité, la règle ne prétend donc jamais vraiment à l’universalité ; mieux encore, il n’y a de règle que par abolition de règles antérieures, redoublant son impossible universalité. « Ainsi, concevoir la règle classique comme une règle arbitraire, imposée par un pouvoir ou légitimée par une convention, relève d’une méconnaissance complète de sa nature comme de sa fonction. On peut dire en ce sens que la critique des règles est toujours une révolte contre des règles qui se sont sclérosées, qui ont perdu leur raison d’être, qui ne répondent plus à aucune nécessité. C’est précisément quand elle devient arbitraire, lorsqu’elle n’est plus qu’une contrainte extérieure, que la règle est mise en cause et disparaît. En art, on ne tue que des règles déjà mortes, qui ne sont plus vivifiées par la nécessité, pour leur en substituer d’autres. »11 D’où l’importance de l’étude empirique des œuvres que sanctuarisent les conférences de l’Académie de peinture. Quand les académiciens proposent une règle, « ce n’est jamais au nom d’un principe théorique, d’une norme ou d’une idée a priori, mais en se fondant sur leur propre expérience artistique et en la justifiant par des exemples empruntés à des prédécesseurs illustres : Titien, Raphaël, Corrège ou Poussin. »12
L’auteur peut ainsi convoquer Racine et la célèbre préface de Bérénice où le plaisir du spectateur se substitue à la règle universelle et conceptuelle que rien ne saurait contester : « La principale règle est de plaire et de toucher, toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. » (cité p. 75) Et il en va de même chez Boileau pour qui « Le secret est d’abord de plaire et de toucher, / Inventez des ressorts qui puissent m’attacher. » (cité p. 75). La notion de plaisir comme relation de l’œuvre avec le sujet devient l’élément déterminant, et ce dès le XVIIè siècle, ainsi que nous avions d’ailleurs modestement tenté de le démontrer dans notre Descartes : admiration et sensibilité13 où nous avions essayé de montrer que Descartes avait théorisé le plaisir- la delectatio – comme premier impératif d’une œuvre d’art à laquelle ne convenait plus aucune règle universelle.
C : La légitimité de l’ignorance
Cette disjonction entre l’esthétique et l’art, rendue possible par l’art, et dont les conséquences paradoxales sont celles d’un discours esthétique s’aventurant imprudemment dans l’art ne peut toutefois être avancée à partir du seul Kant ; l’auteur montre l’importance cruciale des écrits de Du Bos qui, pour la première fois, va introduire le point de vue du spectateur par opposition à celui de l’artiste jugé excessivement technique et informé. La question n’est pas chez lui de savoir comment l’art atteint son but mais qui sont les spectateurs dont le plaisir suffit à prouver que l’art a affectivement atteint son but. Du Bos est ainsi, selon J. Lichtenstein, « le dernier grand théoricien de l’art au sens classique. Mais l’importance accordée dans ses Réflexions au point de vue du spectateur en fait en même temps le premier théoricien de l’art au sens moderne. A ce point de vue du spectateur – qui est aussi le sien, comme le note si justement Voltaire –, Du Bos oppose systématiquement celui des artistes, auquel il reproche d’être d’abord et avant tout un point de vue de praticien. »14

L’auteur précise avec raison qu’il faut se garder d’interpréter l’ignorant du point de vue empirique, celui-ci n’étant jamais qu’un modèle, qui est utilisé à des fins démonstratives, au même titre que l’aveugle né de Diderot ou l’homme à l’état de nature de Rousseau. »15 Toutefois, empirique ou modélisé, l’ignorant a fait son entrée explicite dans l’analyse esthétique des œuvres d’art, et si la possibilité de tenir un discours esthétique sans connaissances artistiques positives n’y est pas étrangère, Du Bos en a tiré les conséquences les plus évidentes. L’auteur cite ainsi le mot de La Curne de Sainte-Palaye qui put affirmer, en 1748 : « Je n’ai aucune connaissance en Architecture, Monsieur ; c’est pourquoi vous ne serez pas surpris que j’en parle avec confiance, bien ou mal. » (cité p. 110) Cela pourrait sembler absurde, mais ce n’est jamais que la conséquence logique d’une situation où l’ignorance, loin d’être honteuse, était brandie en bouclier contre le dogmatisme du jugement. « Cette nouvelle distribution des rôles et des positions qui dépossède l’artiste d’un privilège qu’il avait longtemps exercé dans le champ du discours sur l’art est inséparable de la victoire théorique remportée par cette figure du spectateur ignorant et désintéressé qui apparaît avec Du Bos. Parachevant en quelque sorte la logique de l’argument utilisé par Du Bos, certains vont même jusqu’à faire de l’ignorance une garantie de l’impartialité de leur jugement. »16
D : L’indétermination du « sensible »
Outre ces rappels décisifs, l’ouvrage impressionne aussi par l’analyse qui est menée de la couleur ; l’auteur avait en effet consacré un important ouvrage à cette question il y a 25 ans, attribuant à celle-ci une certaine perspective métaphysique. « Les hiérarchies imposées par le platonisme permirent à la couleur de devenir le lieu privilégié d’un antiplatonisme dans la peinture où s’exprimait en fait l’antiplatonisme de la peinture. »17 Les coloristes touchaient à l’ordre du discours et étaient clairement antiplatoniciens. « Car la couleur, c’est le sensible dans ou plutôt de la peinture, cette composante irréductible de la représentation qui échappe à l’hégémonie du langage, cette expressivité pure d’un visible silencieux qui constitue l’image comme telle. »18 C’est tout à l’honneur de J. Lichtenstein que de reconnaître que sa défense de la couleur, comme lieu de la résistance à la conceptualisation absolue, était fondée sur un dualisme excessivement abstrait au regard de la réalité picturale effective ; « Je n’avais pas su résister, confesse l’auteur, aux sirènes de la métaphysique ni éviter les dangers de la simplification. C’est évidemment le dessin qui avait le plus souffert de cette approche beaucoup trop systématique. Si j’avais pris la peine d’examiner de près les dessins du XVIIè et du XVIIIè siècle, de les regarder attentivement, j’aurais compris que l’art du dessin ne correspondait pas tout à fait à l’image qu’à la suite de Roger de Piles j’avais voulu en donner. Mais c’est seulement en dessinant moi-même que je l’ai vraiment compris. Il fallait n’avoir jamais pris un crayon dans sa main pour faire du dessin cet acte purement intellectuel et désincarné auquel je l’avais réduit, emportée par un désir de défendre le coloris dont je sais aujourd’hui qu’il était aussi en partie idéologique. Comme il faut être philosophe, et ne jamais avoir tenu un pinceau, ne jamais avoir par exemple essayé de peindre un paysage ou une nature morte, pour croire qu’une catégorie aussi vague, aussi générale, et surtout aussi métaphysique que celle de « sensible » peut servir à désigner le mode d’élaboration perceptive infiniment complexe qui est propre à l’activité picturale. (…). C’est en effet la plupart du temps au détriment de l’aisthésis, en négligeant l’analyse des sensations et des processus cognitifs mis en œuvre dans la perception, que le sensible trouve droit de cité dans l’esthétique moderne. »19
Nous citons ce long passage car il nous semble essentiel à double titre dans l’économie même de l’ouvrage : d’abord, il permet de prendre conscience que la distinction radicale entre les dessinateurs et les coloristes n’est jamais qu’un artifice extérieur à la pratique picturale, quand bien même certains peintres peuvent être meilleurs dessinateurs que coloristes et inversement – que l’on songe au mot de Michel-Ange se désolant que Titien ne fût pas meilleur dessinateur pour s’en convaincre. Ensuite, et c’est sans doute le plus essentiel, l’auteur montre combien s’est appauvrie la notion de « sensible », catégorie fourre tout et abstraite, où l’on ne trouve plus ou presque plus d’effectivité picturale, mais seulement un terme vague censé épuiser cela même qui se montre. Il est dommage que l’auteur ne cite pas davantage de philosophes précis pour que le lecteur perçoive la pauvreté même du terme, une fois mis entre des mains qui, jamais, n’ont tenu un pinceau.
Cette incapacité à finalement éprouver ce que peut être le sensible pictural se conjugue à une reprise par l’auteur des analyses consacrées à la couleur, dont elle montre combien il fut difficile de la penser d’un point de vue précisément non pictural, notamment en convoquant les écrits de Goethe. « Tout se passe, écrit J. Lichetnstein, comme s’il voulait ignorer le rôle joué précédemment par la théorie de l’art afin de pouvoir mettre en avant le seul rôle de la théorie scientifique dans l’émancipation de l’art et de l’artiste. »20 Goethe tient ainsi pour évident qu’il n’est de théorie que scientifique et donc que seule la science, et non la peinture, peut rendre raison du coloris, comme si donc la peinture n’avait rien à dire du sens de la couleur.
Le paradoxe que pointe l’auteur prend alors toute son extension que nous aimerions restituer en déviant un peu de la lettre du texte pour le reformuler selon nos propres termes ; jamais autant qu’à l’époque moderne, et jusqu’aux réflexions phénoménologiques d’un Merleau-Ponty ou d’un Michel Henry, on n’a exalté la peinture comme lieu de la révélation du sensible ; mais jamais autant qu’à cette époque, on n’a fait usage d’un terme vague et mal défini pour nommer et penser ce que nous donne la peinture ; et si nous suivons l’auteur jusqu’au bout, cela tient au fait qu’en sous-main, c’est à la science qu’a été réellement confié le soin d’en délivrer le sens authentique, l’indétermination même du terme de « sensible » devenant le symptôme du renoncement du discours philosophique sur l’art à le penser à partir de l’art et ce en dépit des intentions affichées.
E : Philosophie et histoire de l’art
Tirons les conséquences des analyses précédentes ; si vraiment les philosophes discourant de l’art ont en réalité renoncé à en tirer quelque chose, ils ne produisent plus guère qu’un discours de façade, comme s’ils s’étaient résignés à ne plus croiser l’histoire de l’art, conséquence ultime de la scission kantienne entre l’esthétique et l’art. C’est pourquoi l’auteur analyse la célèbre critique adressée par Schapiro à Heidegger au sujet des supposés souliers de Van Goh, en se demandant si une compréhension entre le philosophe et l’historien d’art est tout simplement possible, c’est-à-dire si un objet commun de réflexion peut encore exister. Le nouveau paradoxe que pointe l’auteur est que la seconde critique de Schapiro, concernant la difficulté d’identifier l’objet même qui est peint par Van Goh à partir des indications de Heidegger a beaucoup plus retenu l’attention des philosophes que la première critique – le manque de données précises – alors même que la seconde critique relève beaucoup plus de l’histoire de l’art que de la philosophie stricte ; faut-il alors voir dans ce paradoxe un espoir ou, au contraire, le lieu d’un quiproquo ?
Les reproches qu’adresse l’auteur à Derrida sont peut-être la partie la moins convaincante de l’ouvrage, tant il paraît difficile de dire de lui qu’il fut peu sensible à la peinture, ou encore qu’il sombra dans la tentation de conceptualiser à outrance et sous une forme excessivement généraliste la notion même de peinture. Toutefois, il est vrai que les passages incriminés par l’auteur, de Heidegger en particulier et de manière bien plus probante que pour Derrida, montrent à quel point la peinture ne fait aucunement l’objet d’une analyse sérieuse et informée ; elle apparaît au contraire comme un alibi destiné à confirmer indépendamment de toute concordance effective avec ce qui est peint les théories du philosophe ; au fond, la peinture pourrait être radicalement autre, cela ne changerait pas d’un iota les analyses proposées par le philosophe, qui fait dire à l’œuvre ce qu’il veut y voir et non ce qui s’y montre.
Nous ne pouvons donc que souscrire à la conclusion de l’auteur : « Si l’analyse du mode d’être esthétique d’une œuvre d’art est bien du ressort de la philosophie, qu’en est-il en revanche de son mode d’être artistique ? En quel sens et sous quelle condition celui-ci peut-il aussi être l’objet d’une analyse philosophique ? Si l’on veut bien admettre que la philosophie ait quelque chose de spécifique à dire sur l’art et l’activité artistique, c’est-à-dire quelque chose que l’on ne trouve ni chez les critiques, ni chez les artistes, on voit mal comment elle pourrait dire quelque chose de juste si elle ignore aussi bien l’histoire et la théorie des arts que la réalité des pratiques artistiques. »21
Conclusion
Ce court essai soulève de délicates et précieuses questions sur le statut même de la philosophie : d’où vient la légitimité de son discours ? Les objets dont elle s’empare dictent-ils une connaissance positive, fondant la légitimité du discours philosophique ? Le fondement de la légitimité philosophique peut-il être extérieur à la philosophie ? De manière plus locale, se pose évidemment la question du discours philosophique sur la peinture : peut-il être dogmatique et ne voir dans la peinture que le concept abstrait qu’il s’en fait, ou ne peut-il être légitime qu’à la condition de se construire à partir de la connaissance empirique de l’effectivité picturale ? La réponse de l’auteur à ces délicates questions est à la fois claire et convaincante : une philosophie qui se dispense d’une connaissance précise de ce dont elle parle et qui s’arroge un droit au discours universel se condamne à l’errance et à l’équivocité, dont Heidegger est sans doute un symptôme particulièrement parlant. Ainsi se comprend le premier sous-titre envisagé, essai sur les limites de l’esthétique, lesdites limites étant révélées par l’incapacité de l’esthétique à véritablement cerner l’art tel qu’il est.
Nous pourrions alors prolonger de telles réflexions en interrogeant la réponse traditionnellement entendue alors que se trouvent critiquées les analyses de Heidegger ou de Freud par leurs défenseurs : c’est peut-être faux mais cela n’importe guère car cela donne à penser. Une telle réponse, qui se veut subtile et fine, est pourtant étonnante : qu’y a-t-il à penser si le matériau même qui est censé donner à penser est lui-même invalidé ? Quelle est cette pensée qui se prend elle-même comme fin, méprisant de son ricanement ignorant la notion même de vérité ? Que signifie penser si l’acte même de penser ne se trouve plus subordonné à la recherche de la vérité ? Pis encore : la pensée est-elle encore pensée dès lors qu’elle ne cherche plus à faire l’épreuve du vrai – fût-ce pour n’y jamais parvenir ? Autant de questions que charrient en creux les belles et profondes analyses de J. Lichtenstein.
- cf. Jacqueline Lichtenstein, La couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique, Flammarion, 1989, coll. Champs, 1999
- Jacqueline Lichtenstein, Les raison de l’art. Essai sur les théories de la peinture, Gallimard, coll. NRF essais, 2014
- Les raisons de l’art, op. cit., p. 18
- Ibid., p. 19
- Ibid., p. 52
- Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, § 33, Traduction Alain Renaut, GF, 2000, p. 268
- Les raisons de l’art, op. cit., p. 57
- Ibid., p. 60
- cf. Conférences de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture, ENSBA, 5 tomes de deux volumes chacun, 2007-2013
- Ibid., p. 67
- Ibid., pp. 68-69
- Ibid., p. 72
- cf. Thibaut Gress, Descartes, admiration et sensibilité, PUF, coll. Philosophies, 2013
- Ibid., p. 82
- Ibid., p. 89
- Ibid., p. 109
- La couleur éloquente, op. cit., p. 11
- Ibid., p. 12
- Ibid., p. 21
- Ibid., p. 136
- Ibid., p. 170







