Voici l’ultime partie d’un entretien avec Michel Bitbol qui en contenait déjà deux consultables ici pour la première et là pour la seconde.
III. L’expérience pure : le lieu de résistance du sujet au sein de la tradition objectiviste
AP : Votre proximité avec Varela ou Chalmers sur le fait de la subjectivité, sur le caractère naturel du sujet, son expérience phénoménologique originelle comme objet d’une science remettant en cause le postulat objectiviste des sciences occidentales, est intéressante, car malgré le paradigme dominant du réductionnisme, il y a en son sein et à l’extérieur des individus (comme Chalmers et Varela par exemple) ou des traditions (la tradition phénoménologique ou d’inspiration wittgensteinienne) une résistance. L’heure est-elle venue de faire place à une science du sujet, pas seulement un programme phénoménologique, mais bien une science de l’interaction comme votre projet et celui de Varela en ses termes propres le proposent ? N’y a-t-il pas dans ce projet qui émerge depuis Husserl un problème épistémologique récurrent, que les sciences objectivistes ont réglé pour elles-mêmes mais que les sciences de l’interaction et du sujet pur peinent à formaliser, d’où un projet de naturalisme élargi qui reste porté par des individus (Varela, Chalmers, Bitbol, etc.) ?
MB : Ici, je voudrais introduire ma réponse par deux correctifs.
Le premier correctif est qu’il n’est pas question pour moi d’un retour à quelque sujet individuel, ponctuel, limité. Cela reviendrait à soutenir un « idéalisme subjectif » étroit que même Fichte n’a pas défendu (en dépit de cette étiquette qui lui a été imposée par Schelling, et malgré l’impression suscitée par son usage répété du pronom personnel objet « moi »). Le retour souhaité nous conduit à quelque chose d’infiniment plus originaire que cela, quelque chose qui précède les couches successives de la constitution d’un soi localisé et personnel. Ce « quelque chose », qui ne s’identifie pourtant à aucune « chose », est ce que j’ai tenté d’appeler précédemment, non sans quelque hésitation, « l’expérience pure ».
Comme toute philosophie, celle-ci s’élance de quelque part, mais elle n’est pas très assurée du nom qu’elle donne à son aire d’envol. L’expression « expérience pure » est empruntée à William James, et celle de « conscience pure » pourrait être empruntée à Husserl. Mais ces dénominations, comme n’importe quelle autre qu’on aurait choisi à leur place, peuvent donner lieu à des confusions en raison de leur inscription dans un champ structuraliste d’oppositions et de différences sémantiques. L’expérience est seulement un éprouver, elle n’est pas ce qui est éprouvé; la seule utilisation du mot « expérience » engendre donc une polarité. Une nouvelle séparation se fait jour, là où il s’agissait de revenir en amont de toute différenciation et de toute scission, et l’on retombe dans le balancement dualiste même qui devait être surmonté par le geste réflexif et suspensif de l’épochè. C’est le signe qu’on arrive là à la limite du dicible. Je pourrais donc à cet instant vous chanter les louanges du silence, et peut-être m’approcherais-je ainsi plus près de la vérité espérée qu’en tentant de capturer cette origine, ce point source, ce point d’évidence, dans les rets du langage. Je pourrais aussi m’appuyer sur Wittgenstein pour appeler « conscience-vie-monde » ce vers quoi je gesticule. Conscience-vie-monde : tout cela à la fois, rien de moins que cela, car cela seul semble ne rien laisser en dehors de soi 1
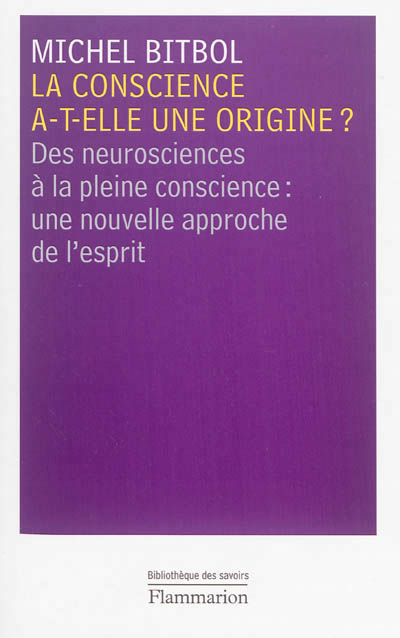
Le deuxième correctif porte sur l’assimilation de la position de Varela à celle de Chalmers. Il faut en effet noter que l’article central que Varela a consacré à la question de la conscience, celui qu’il a intitulé « Neurophenomenology » [F. Varela, « Neurophenomenology: A Methodological remedy to the hard problem », Journal of Consciousness Studies, 3, 330-350, 1996. Une traduction française de cet article sera bientôt disponible dans une anthologie de textes de Francisco Varela, dirigée par Jean-Pierre Dupuy, et publiée aux éditions du Seuil.[/efn_note], a été conçu comme une réplique à Chalmers, comme l’expression d’un important désaccord avec lui. Certes, Varela s’accorde avec Chalmers pour estimer que le problème de l’émergence de l’expérience consciente à partir d’un substrat physique, est « difficile », parce qu’il est d’une tout autre nature que ceux qui sont du ressort des sciences. Il s’accorde en particulier avec lui pour repartir du fait brut, vécu, manifeste, de l’expérience, et pour refuser toute assimilation de celle-ci à l’un des objets ou à l’une des propriétés qu’étudient les sciences physiques ou biologiques. Ces points de convergence peuvent être considérés comme suffisants, vus de l’extérieur (par exemple vus par un réductionniste neurobiologique), pour considérer que Chalmers et Varela soutiennent la même position anti-réductionniste. Mais à partir de là, une divergence profonde se fait jour entre eux. Chalmers2 considère qu’il faut ajouter un « ingrédient supplémentaire » dans notre ontologie naturaliste pour rendre raison de la conscience. Qui plus est, il introduit effectivement cet ingrédient supplémentaire, sous forme de « propriétés fondamentales » non-physiques qui s’ajoutent aux propriétés physiques des dispositifs traitant de l’information, et qui sont reliées à ces dernières par des « lois psycho-physiques ». Varela, en revanche, considère qu’on ne peut pas venir à bout du « problème difficile » de la conscience en se contentant d’agrandir l’ontologie naturaliste afin de lui faire inclure un genre nouveau de propriété des choses. Il faut, selon lui, carrément sortir de cette ontologie (pour ne pas dire de l’ontologie en général) ; il faut aller jusqu’à « modifier la totalité du cadre dans lequel la question est discutée ».
Plus précisément, ce que Varela préconise est de changer d’attitude fondamentale, de susciter en soi une mutation d’être-au-monde, pour remonter jusqu’à la racine existentielle du « problème difficile » formulé par Chalmers. Au lieu de se contenter de jouer avec les pièces d’un puzzle ontologique, il s’agit selon Varela :
1) de réparer notre « aliénation à l’égard de la vie humaine », en réalisant que même les propositions qu’on appelle des « comptes rendus en troisième personne » sont élaborées par des êtres situés dotés d’expérience vécue en première personne ;
2) de réintégrer pleinement cette expérience en première personne, et de l’étudier avec autant de soin méthodologique que les secteurs objectivés de la nature, afin de l’inscrire dans une relation dialectique et productive de « contraintes mutuelles génératives » avec les comptes rendus dits en troisième personne de la physiologie corporelle.

Peut-on à partir de là qualifier le programme varélien de « naturalisme élargi » ? Je pense que oui, mais à condition de souligner le mot « élargi », plutôt que le mot « naturalisme ». Contrairement à Chalmers, Varela ne se contente pas d’enrichir la nature d’une propriété-de-chose supplémentaire, en gardant intacte la définition implicite de la nature comme collection d’objets dotés de prédicats. Au lieu de cela, il fait éclater le cadre conceptuel trop étroit du naturalisme, et l’étend jusqu’à ce qui le conditionne, à savoir l’expérience non objectivable des objets naturels. Sa prescription, pourrait-on dire, consiste à ouvrir la méthode de la recherche à 360 degrés, pour y envelopper non seulement ce qui se trouve devant le foyer de l’attention, mais aussi ce qu’il suppose derrière lui (à savoir l’acte attentif). L’impératif varélien consiste à savoir ne plus envisager la nature comme un grand objet, mais comme une totalité sphérique post-parménidienne : une totalité éprouvante aussi bien qu’éprouvée.
Je me reconnais héritier de cette révolution de la pensée, que je préfère personnellement voir comme une forme de phénoménologie élargie à sa mise en rapport systématique avec des phénomènes naturels, plutôt que comme un naturalisme élargi à l’apparaître : une phéno-cosmologie plutôt qu’une neuro-phénoménologie.
AP : Quelles sont et quelles seraient les règles de cette méthodologie d’une science de la première personne ou plus précisément d’une science réflexive à 360 degrés ?
Peut-on penser son organisation en communauté scientifique avec pour seule visée la connaissance, ne lui manque-t-il pas des applications concrètes, ce qui permettrait de déployer chercheurs, financements, communauté d’intérêt, etc., bref de forger un paradigme solide, voire « dominant »? Voyez-vous l’ébauche ou la réalisation déjà concrète de cela, par exemple dans le soin de maladies mentales ?
Enfin, est-ce à la science d’atteindre la profondeur de l’âme humaine, est-ce à la science d’expliquer que l’approche en troisième personne réduit, que les mesures cérébrales et hormonales n’épuisent pas la réalité ? N’y a-t-il pas l’art, aussi contemporain et hermétique peut-il être, la littérature et la philosophie ? Plus radicalement, une méthodologie scientifique pour dire l’ego, empirique ou transcendantal, ne serait-elle pas elle-même réductionniste, la science manquant par définition la singularité ?
MB : Vous me posez là de belles questions, et vous me lancez de véritables défis.
-Premièrement, que faire, une fois qu’on a transfiguré les présupposés des questions de philosophie de l’esprit, en faisant craquer le vêtement trop étroit du naturalisme ? Ici encore, je peux vous renvoyer à la vision de Francisco Varela, qui avait d’emblée envisagé sa conception en tant que programme de recherche. Ce programme, tel qu’il l’expose dans l’article « Neurophenomenology », consistait en une « (…) tentative de marier la science cognitive contemporaine avec une approche disciplinée de l’expérience humaine ». Un tel mariage était lui-même conditionné par l’émergence d’une « (…) communauté de chercheurs engagés dans ce mode d’enquête » ; une communauté capable de « (créer) de nouvelles normes de preuve ». La communauté en question devait être composée de chercheurs en quelque sorte bilingues, capables de manier alternativement ou parfois simultanément les deux langues de la pensée et les deux postures fondamentales de la recherche : la langue et la posture objectiviste, aussi bien que la langue et la posture phénoménologique ; l’attitude « naturelle-intentionnelle », aussi bien que l’attitude de mise en repos des visées et de retour réflexif. De plus, la nouvelle communauté de recherche devait accomplir une opération de guidage mutuel entre les comptes rendus objectifs des processus physiologiques et les descriptions en première personne des événements mentaux concomitants (ce que Varela appelait, comme je l’ai dit rapidement un peu plus tôt : « établir des contraintes mutuelles génératives »).
Des recherches ont été conduites avec succès, dans le laboratoire de Varela, en utilisant ces méthodes à la fois composites et synergiques. Je pense par exemple à un travail qui mettait en rapport l’expérience vécue et la neurophysiologie de la « rivalité binoculaire » 3, et à un autre travail qui a permis de mettre en évidence des signes neurologiques précurseurs de la crise épileptique à partir d’une étude de l’expérience vécue des patients dans les heures précédant cette crise 4. Ce dernier cas représente une fructueuse application médicale de la neurophénoménologie ; qui plus est, elle concerne une maladie réputée « organique » plutôt que « psychiatrique ».
Beaucoup d’efforts restent toutefois à accomplir pour convaincre les chercheurs de l’utilité d’une telle double discipline, d’une discipline coordonnée de la première personne et de l’objectivité. Plusieurs années sont passées, durant lesquelles le programme de recherche neurophénoménologique est resté en jachère, parce que les neurobiologistes ont eu l’impression de pouvoir se contenter d’un apport phénoménologique minimal fait de réponses par « oui » ou par « non » à des questions élémentaires sur ce que les sujets perçoivent. Mais au fur et à mesure que les neurosciences avancent, leur demande de clarification et de micro-catégorisation expérientielle des processus neuronaux grandit, ce qui confère une nouvelle actualité au programme neurophénoménologique 5
-Deuxièmement, j’entends votre doute : est-ce bien à la science de s’occuper sérieusement de ce qui est vécu en-deçà de ce qui est perceptible et manipulable ? Croire cela, n’est-ce pas prolonger l’œuvre du réductionnisme, en suggérant discrètement que tout ce qui importe dans une vie humaine doit être reconductible d’une manière ou d’une autre à la démarche scientifique, quitte à accroître le champ de celle-ci de façon à lui permettre de toucher jusqu’à ses propres pré-conditions épistémiques et existentielles ? Je dois dire que je partage votre perplexité à ce propos. Après tout, comme l’écrivait Schrödinger, dans une lettre du 25 août 1926 à Wilhelm Wien, « La physique ne se réduit pas à la physique atomique, la science ne se réduit pas à la physique, et la vie ne se réduit pas à la science ». En même temps, si les sciences ignoraient complètement leur présupposé, elles demeureraient tronquées, aveugles à ce qui les conditionne, et elles se heurteraient en permanence à des énigmes ou à des paradoxes qui manifesteraient cette lacune fondamentale à travers leur incapacité constitutive de les surmonter. Le « problème difficile » de l’origine physique de la conscience est l’une de ces énigmes fondationnelles, et il est donc sain qu’un chercheur scientifique comme Francisco Varela l’ait reconnue comme telle, en recommandant d’élargir le périmètre de l’effort de connaître afin de ne plus être piégé dans un fait d’incomplétude inaperçu. Cela ne veut pas dire que la science prétend tout saisir de son propre arrière-plan épistémico-existentiel, bien sûr, mais simplement qu’elle n’est plus exilée de son origine, qu’elle peut apprendre à se maintenir au contact de cette origine sans l’arraisonner, certes, mais sans pour autant l’éviter. L’un des rôles de la philosophie est de sans cesse rappeler le risque de cet exil et de cette incomplétude, à partir de son travail incessant de mise au jour des sources de la connaissance humaine, de déconstruction des préjugés, et de reproblématisation des questions stéréotypées.

AP : Comment comprendre le fossé entre l’explication de la pensée et de l’esprit par ses corrélats neuro-matériels et l’écart avec le fait du sens mais aussi l’expérience pure du sujet – le problème des qualia restant un cas particulier, et peut-être désuet, de l’expérience de s’éprouver sujet ? Est-ce le nerf de l’argument antiréductionnisme ? Ce fossé prétend-il se résorber dans une connaissance à 360 degrés ?
MB : Un « fossé explicatif » sépare en effet ce qu’on appelle le « substrat neuronal », de la conscience supposée être « causée » voire « produite » par lui : si, au-delà de l’évidente corrélation entre la forme des événements vécus et la forme des processus neuronaux, il y a bien une telle relation de causalité ou de production unidirectionnelle (ce qui n’a au demeurant rien de démontré), de quelle nature est cette relation, quels sont les « mécanismes » détaillés de l’hypothétique production, comment saute-t-on le pas entre l’objectif et l’éprouvé ? Cet énoncé du « fossé explicatif » semble clair, mais il se heurte à un écueil assez massif : c’est que l’un de ses bords (le bord vécu) est mal défini, et qu’il se prête de ce fait à toutes sortes de manipulations ayant pour but d’escamoter la difficulté. Quel est exactement ce « je ne sais quoi » qu’aucune explication scientifique ne semble pouvoir capturer dans ses rets ?
La stratégie actuelle du physicalisme consiste : a) à nommer « conscience » le « je ne sais quoi » insaisissable ; et b) à redéfinir la conscience avant d’affronter la question de l’explication. Admettons par exemple que la conscience soit caractérisée comme une fonction de méta-cognition (c’est-à-dire de cognition portant sur les processus cognitifs), ou bien encore comme une fonction d’intégration de l’information, pour reprendre deux définitions populaires chez les physicalistes. Dans les deux cas, il semble qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’on en rende raison par des processus cérébraux. La métacognition peut être rapportée aux processus récursifs des régions encéphaliques, et l’information intégrée peut être mesurée (c’est le fameux paramètre « Phi » de Giulio Tononi) dans l’activité neuro-électrique du cortex cérébral. Mais à supposer même qu’on soit parvenu à ce genre d’explication neurobiologique des fonctions de la conscience, quelque chose, qui ne se ramène ni à la métacognition ni à l’intégration informationnelle, semble rester hors de portée de l’explication. De quoi s’agit-il ? On a envie de dire que cette part inaccessible est ce qui, dans la conscience, excède la fonctionnalité cognitive et relève du pur « éprouvé » ; ou encore, pour emprunter un vocabulaire proposé par Ned Block, que c’est non pas la « conscience d’accès », mais la « conscience phénoménale ». On peut également dire qu’il s’agit de la part non-structurale, non-fonctionnelle, purement qualitative du vécu conscient. Si l’on cède alors à une certaine conception atomiste de l’expérience, on est tenté d’analyser cette part qualitative en autant de « qualia » (ou qualités sensibles) qu’il y a de tonalités (sensitives ou émotionnelles) possibles dans l’expérience vécue. Le problème, c’est qu’à partir du moment où l’on a circonscrit de cette manière le résidu déclaré inexplicable, les physicalistes reviennent à la charge et répliquent à peu près de cette manière : « attention, les qualia ont une structure ; par exemple le quale de rouge exclut les qualia de bleu et de vert, et il est même possible de tracer un triangle de Maxwell des couleurs qui les met en rapport mutuel systématique dans l’espace des vécus possibles. Or, rien n’empêche de rendre compte de ces structures par la neurobiologie rétinienne et encéphalique, et par conséquent vos fameux qualia sont parfaitement arraisonnés sur un mode scientifique ». La théorie de l’information intégrée de Tononi propose en particulier un compte-rendu de la différenciation des qualia en termes de différenciation des schémas d’activation des réseaux neuronaux codant l’information. Une course contre l’ineffabilité est ainsi engagée entre les anti-physicalistes et les physicalistes. Les premiers déclarent : « mais il y a aussi cela, et cela, vous ne pourrez jamais l’expliquer ». Mais à peine le « cela » insaisissable est-il nommé, à peine est-il ainsi inclus dans un réseau de relations entre signifiants, les physicalistes sont en droit de remarquer qu’il est devenu un objet possible pour une science des relations entre phénomènes. Et ainsi de suite, sans que la course semble pouvoir être gagnée par l’anti-physicaliste, qui apparaît comme le poursuivant ou le challenger d’un physicaliste soutenu par l’élan du progrès scientifique. Pourtant, nous savons tous qu’une fois effectué le précieux travail de la science neurobiologique, un « je ne sais quoi » dont il a été question plus haut reste perpétuellement intouché. Le nommer est un piège dont nous venons de reconnaître les ressorts ; mais demeurer évasif, tout en continuant à proclamer dans le vague qu’il y a de l’irréductible, donne libre cours à une accusation de « mystérianisme ».
Alors, il reste encore un geste à accomplir, une volte-face victorieuse à opérer. Pour convaincre les physicalistes de la persistance d’un résidu inarraisonnable, sans pour autant tomber dans l’embûche de sa dénomination, il faut provoquer chez eux une expérience en retour, un saut postural. Il faut leur faire réaliser, au plus immédiat de leur sens intime, que la certitude qu’ils ont de pouvoir rendre raison de la conscience, est elle-même un acte de conscience. Il faut leur faire toucher du doigt que ce qui demeure intouché, c’est rien moins que le fait massif, immense, omniprésent, que tout cela (certitudes ou incertitudes, représentations du cerveau ou arguments critiques, modèles mathématiques ou concepts neurophysiologiques, explications ou dénégations, dénominations ou décisions de se taire) se donne à cet instant même en tant qu’expérience consciente. Ce dont peut rendre raison une science objective, c’est de la connexion légalisable entre les phénomènes (entre n’importe quels phénomènes), c’est-à-dire la liaison régulière entre des contenus partiels d’une conscience possible. Mais ce dont elle ne peut pas rendre raison par construction, c’est du fait brut de la phénoménalité, le fait brut que quelque chose apparaît plutôt que rien. Non pas pour le motif qu’elle serait de quelque manière imparfaite, mais tout simplement parce que ce fait constitue sa présupposition la plus universelle. La science objective a pour méthode de présupposer (de manière absolument tacite) que quelque chose se montre, qu’il y a de l’expérience ; puis d’extraire à partir de cette expérience quelques fragments partageables par tous ; et enfin d’établir des connexions constantes et reproductibles entre ces fragments. Comment pourrait-elle rendre compte de la carrière entière d’apparaître d’où elle a extrait ces pépites d’apparitions ? Peut-il suffire, pour expliquer la carrière d’apparaître, de relier entre elles de manière légale et systématique les pépites d’apparitions ? Cette impossibilité de principe semble aller de soi. Encore faut-il faire pleinement l’expérience du contraste entre la totalité d’apparaître et ses éclats apparaissants, ce que seuls des exercices de « saut postural » ou d’épochè peuvent permettre d’obtenir : précisément le genre de déploiement de l’attention à 360 degrés que j’ai évoqué auparavant.
AP : que pensez-vous des théories sur la culture qui procèdent à l’inverse de vous et naturalisent l’esprit subjectif et sa vie idéelle en hypostasiant l’histoire culturelle ou l’histoire des idées, comme la théorie mémétique, de Dawkins à Dennett, ou les théories naturalistes comme celle de Dan Sperber[sur ce sujet, on pourra lire cet [article et celui-ci.[/efn_note] ? En bref, que faites-vous du geste contraire au vôtre de naturalisation totale, où la culture et l’idéel ont ontologiquement une consistance viable mais mécaniste, et des déterminismes qui expliqueraient l’esprit et ses productions dans une interaction ici purement mécaniste entre l’organisme pratique humain et ses productions théoriques ? Ici, point de sujet pour rendre compte de la vie de l’esprit et des civilisations, l’expérience pure du sujet est une illusion répondant à des besoins – l’esprit est l’intériorisation d’une théorie permettant de prédire les comportements d’autrui et la nature afin d’agir avec plus d’efficace, se développe petit à petit une intériorité subjective comme capacité prédictive.
MB : Le concept de « meme » (ou « mème » en français, tout comme « gene » se traduit par « gène »), proposé par Richard Dawkins et développé par Susan Blackmore, est intéressant en tant que concept opératoire, afin de comprendre de façon simple la dissémination des idées ou des formes de pensée au sein des cultures, voire la dissémination des cultures entières à travers le genre humain. La puissance du concept de « mème » lui vient de sa capacité à emprunter des outils, des concepts, et des méthodes de la théorie de l’évolution. Ainsi, l’un des aspects provocateurs de la théorie des « mèmes » est d’attribuer aux individus un statut ancillaire dans la vie des idées, tout comme ils ont un statut ancillaire dans la vie biologique selon la théorie des « gènes égoïstes » de Dawkins : les individus n’y sont pas tant considérés comme les auteurs des idées, que comme leurs simples réceptacles, ou au maximum comme leurs espaces de stockage dynamique. Cela étant dit, après un bref moment de séduction, je me rends compte de tout ce qui me sépare de la théorie des « mèmes ».
Le trait décisif, nous l’avons vu, est que la mémétique est une théorie de la dissémination d’entités ontologiquement distinctes des individus. Chez Dawkins, les gènes sont considérés comme des entités indépendantes des organismes, et les organismes sont en quelque sorte au service des gènes. De la même façon, nous serions au service des mèmes qui circulent indépendamment de nous. Il s’agit là d’une franche exagération, car on peut difficilement nier qu’il y a un travail des individus sur les mèmes : les individus reçoivent des données culturelles, religieuses, scientifiques, et quelque chose se passe en eux. Loin d’être de simples véhicules, ils réagissent en étant déterminés par un mode d’être typiquement individuel ayant pour principe des besoins, ou bien des idéaux régulateurs, comme la quête de cohérence. Si l’on veut à tout prix préserver le cadre de pensée mémétique, il faut reconnaître que, plus que des réceptacles, les individus sont autant d’éprouvettes dans lesquelles les diverses idées qui leur viennent de nombreuses sources extérieures se combinent, et finissent par réémerger sous une forme mutée, qui parfois est plus apte à emporter la conviction (et donc plus apte à être disséminée) que les idées antérieures. Je vais décrire dans cet esprit une expérience que connaissent bien les philosophes. Quand on recueille, par la lecture ou l’enseignement oral, la substance de différentes doctrines, la première chose qu’on se demande, c’est s’il est possible de surmonter les contradictions entre les doctrines diverses ; s’il est possible d’établir une harmonie, pas seulement intellectuelle entre les propositions doctrinales, mais aussi et surtout existentielle entre les modes d’être qui sous-tendent ces propositions. Or, les modes d’être sont vécus en première personne par des individus humains. L’individu est donc le lieu où se refondent les doctrines dans le feu même de son existence, et non pas un simple lieu de passage. À l’inverse, une doctrine, pour être simplement audible, doit se garder d’être un simple faisceau de structures abstraites ; elle doit éveiller des échos motivants, pour ne pas dire brûlants, dans la vie concrète d’individus humains, qui prendront alors la peine de l’assimiler, de la relayer, ou, mieux, de la faire grandir et mûrir. Ce qui manque dans la théorie de Dawkins, ce n’est pas davantage de finesse dans l’exposé des procédés de réplication et de transmission des mèmes, mais un enracinement dans l’envers des énoncés, des procédés, et des projets d’enseignement : le phénomène d’existence.
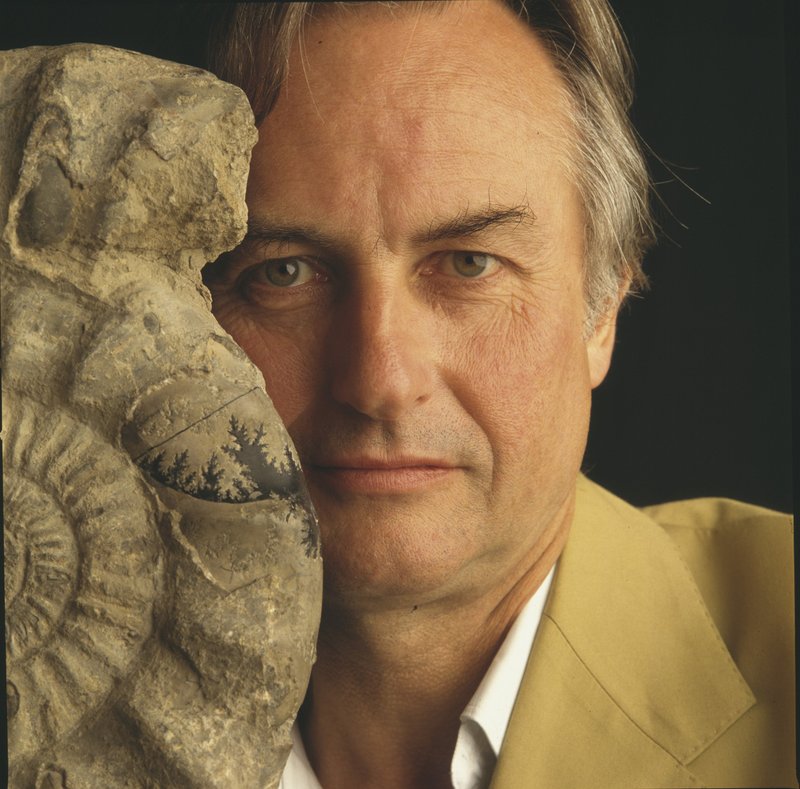
AP : Là aussi ce travail sur les mèmes peut être mécanique, le fruit d’opérations cognitives ; en droit on peut penser que les mèmes qui vont gagner la lutte mémétique répondent à des lois d’interaction entre l’organisme, ses mécanismes cognitifs, la culture déjà déterminée qui est son environnement et les données idéels. La science mémétique mettrait au jour les lois de la combinaison des mèmes et de leur transmission. Les sciences humaines ont là un modèle objectiviste qui est certes en chantier mais un sérieux concurrent à une connaissance en première personne, non ?
MB : Vous me parlez de lois qui détermineraient les idées. Mais, comme je viens de le souligner, la régulation des idées n’est pas indépendante des contraintes internes qui font tendre la vie d’un individu humain pensant et éprouvant vers un acte de donation de sens au monde et à sa place dans le monde. Je pense donc qu’il est vain de vouloir établir les lois des mèmes de façon complètement abstraite et déconnectée de leur versant vécu. Pour reprendre un schéma de pensée schopenhauerien, le mème en tant que représentation renvoie inévitablement à un moment de vouloir-être ; il en est l’expression désinvestie, squelettique, utile à des fins limitées, mais incapable de saisir la poussée des idées à leur source. À cette critique fondamentale, j’en ajoute une autre plus modérée, mais tout aussi importante. La théorie des mèmes relève d’une conception atomiste des idées : chaque mème se fraye un chemin évolutif indépendamment des autres. Mais il ne faut pas perdre de vue que les configurations doctrinales sont globales, et qu’elles ne peuvent de surcroît se maintenir que sous une condition de compatibilité négociée avec la culture entière. En bref, la culture ne peut pas se concevoir comme une simple collection de mèmes, mais seulement comme un système cohérent et polydimensionnel montant aussi haut que les superstructures métaphysiques et descendant aussi bas que les formes de vie tacites. Ce dernier type de critique, notez-le, a déjà été avancé par Stephen Jay Gould contre la théorie des « gènes égoïstes » de Dawkins : selon Gould, la pression de sélection évolutive ne s’exerce pas uniquement au niveau atomique des gènes isolés, mais également aux niveaux émergents de l’individu et de l’espèce. Dawkins ne peut en somme soutenir sa position (aussi bien celle qui concerne les mèmes que celle qui concerne les gènes) que sous un présupposé hautement réductionniste, selon lequel les totalités de la culture, de l’organisme et de l’espèce ne sont rien de plus qu’une combinaison d’entités élémentaires, et que les niveaux émergents n’ont aucune autonomie organisationnelle par rapport à ces dernières.
Il en résulte que je ne pense pas du tout que le modèle des mèmes soit concurrent des approches en première personne ; il est autre chose qu’elles, plus efficace ponctuellement, mais moins signifiant globalement. Comme tout modèle scientifique, celui-ci a de claires limites, et (en raison même de ces limites) d’évidentes capacités prédictives dans un domaine de validité restreint. Ces capacités prédictives, cette efficacité circonscrite, peuvent certes faire illusion quelque temps, et conduire certains penseurs à proclamer (comme ils l’ont fait si souvent) qu’une opérativité même partielle est une preuve de vérité. Mais un jour ou l’autre la lacune originaire de ce modèle ne pourra que se manifester (à la manière de ce qui s’est passé pour le « gouffre explicatif », ou pour le problème du chat de Schrödinger), et cela incitera à nouveau les chercheurs à admettre ce que Dilthey avait clairement vu : que les sciences humaines ne sont complètes qu’à condition d’avoir intégré en elles l’aspect de « compréhension » des phénomènes culturels par participation empathique, aussi bien que l’aspect d’« explication » distanciée de ces mêmes phénomènes ; elles ne sont complètes qu’à condition d’envisager la culture comme elle est vécue et projetée par ceux qui la bâtissent, aussi bien que comme elle est représentée par ceux qui l’étudient.
AP : Oui, le vécu résiste, mais examinons cette résistance. Daniel Dennett me semble le philosophe contemporain qui systématise le mieux l’idée que ledit vécu est une illusion. Ne peut-on pas réduire le vécu et l’expérience pure du sujet à la structure dépouillée de la vie de l’ego empirique et expliquer cet ego comme l’intériorisation d’une théorie de l’esprit. Je m’explique : si l’intériorité du sujet est naturalisée, on peut penser que cette intériorité est le fruit lent de l’histoire humaine où l’organisme humain cherchant à prédire le comportement d’autrui (et bien sûr aussi les mouvements de la nature) afin d’optimiser sa pratique, intériorise une théorie de l’esprit faite de croyances, de buts et de désirs. Cette projection de croyances, de buts et de désirs permet de modéliser les comportements mécaniques des organismes complexes que nous sommes. Génétiquement, nous avons là de quoi rendre compte de l’esprit : dans le temps long de l’histoire humaine, nous avons intériorisé cette théorie prédictive jusqu’à comprendre nos propres comportements ainsi, jusqu’à les compliquer et les produire même en raisonnant nos actions. L’esprit, est-ce plus que cela ? Et pour vous, l’expérience pure du sujet et l’intuition du Soi, est-ce plus que la structure de l’ego empirique que l’on a dépouillée de sa dimension empirique ? Je me trompe peut-être, mais il me semble que la véritable objection à votre projet et à celui de Varela ou de la phénoménologie est précisément ici.
MB : Vos remarques me font sourire. Au bout du compte, et malgré bien des détours et des ruses, Daniel Dennett se débarrasse en effet de la « résistance du vécu » en congédiant le vécu comme une pure et simple illusion. Faut-il prendre cette stratégie au sérieux ? Laissez-moi simplement remarquer ceci : l’illusion n’est elle-même rien d’autre qu’un vécu, le vécu de quelque chose qu’on croit percevoir et qui n’est pas ; comment le vécu en général pourrait-il être une illusion ? Pour accepter la thèse de Dennett comme vraie, il faudrait réaliser le caractère factice du vécu, il faudrait en d’autres termes vivre le vécu comme illusoire, et cela seul suffit à manifester, par un choc d’auto-contradiction, qu’elle est fondamentalement fausse. Il semble donc qu’on joue ici avec les mots, qu’on les fasse intentionnellement tourner à vide, hors de prise de leur seul milieu de développement possible qu’est l’expérience avec ses structures et ses contenus. Je ne m’étendrai pas davantage là-dessus ; pour plus de détails sur la réfutation de la position de Dennett, je vous renvoie à mon dernier livre 6. Ce qui me préoccupe davantage est le procédé par lequel Dennett pense parvenir à convaincre ses nombreux lecteurs d’une conclusion pourtant irrecevable ; irrecevable parce que l’énoncé du caractère illusoire du vécu entre en discordance immédiate, commotionnelle, brutale, avec la condition la plus élémentaire de sa propre compréhension. Or, malheureusement, je crois comprendre ce procédé. Il consiste à maintenir sciemment les lecteurs et les auditeurs dans ce que j’ai appelé l’« exil » de soi ; il consiste à les précipiter vers les productions de la langue, vers les objets visés par les modèles scientifiques, puis à les saisir au moment même où ils commencent à ralentir cette précipitation et où ils relaxent leurs visées, afin de les jeter toujours-encore dans un nouvel acte de saisie d’objet. Autrement dit, le procédé de Dennett, développé à longueur de livres, revient à cultiver la hâte d’avoir, au détriment de l’état d’être. Je peux avoir la connaissance de l’un de mes processus cérébraux, alors que je ne peux qu’être ce vécu qui résiste à l’arraisonnement. Une fois l’être dévalorisé au profit de l’avoir, qualifier le premier d’illusion semble bénin. À ceci près que l’avoir n’est lui-même, au fond, qu’une modalité de l’être, et que la réalisation de ce fait risque de prendre un tour bouleversant. Je crois que nous en sommes précisément là aujourd’hui sur un plan civilisationnel : l’exil devient intolérable, l’avoir restrictif ne satisfait plus entièrement, et les voies les plus baroques (pour ne pas dire les plus confuses ou les plus dangereuses) sont empruntées pour retrouver la présence de l’être, c’est-à-dire l’être en tant que présence, malgré l’intimation de ne surtout pas regarder en arrière qui nous est adressée par tout un système techno-économique.
Cela n’empêche pas, comme vous le signaliez, qu’on puisse naturaliser les structures mentales, et la forme des productions culturelles à des fins d’auto-contrôle. Mais il n’est pas question de se laisser impressionner par le tour de passe-passe qui consiste à ne retenir de l’esprit que les structures naturalisables et contrôlables. Il n’est pas question d’oublier ce qui est structuré, ce qui se tient sans cesse dans l’arrière-plan transparent des structurations et sans quoi les structures ne seraient qu’un maillage vide et mort, à savoir ce que je persiste à nommer (faute de mieux) l’expérience pure : l’expérience mentalement modelée ou culturellement informée. L’expérience pure n’est pas plus, et pas moins, que le sujet, elle est simplement cela sans quoi ni sujet, ni objet, ni catégories, ni formes, ni plus, ni moins n’auraient la moindre consistance. Sans être une chose qu’il y a, elle préconditionne l’il y a.
IV. La philosophie pragmatico-transcendantale a-t-elle en germe des implications pratiques et morales ?
AP : Pouvez-vous unifier vos recherches de philosophe réflexif et votre intérêt pour le bouddhisme et la pratique de la méditation ? Y a-t-il une poursuite dans le domaine de l’action de la pratique réflexive qui vous permette d’unifier votre pensée ? Le Bouddhisme n’est-il pas impliqué par la philosophie qui est la vôtre, même si la systématisation de votre pensée peut advenir ultérieurement ?
MB : Tout d’abord, permettez-moi une mise au point préalable. Lorsque, en réponse à votre question, je vais vous parler du bouddhisme, il ne faudra pas entendre par là un massif religieux et culturel pratiqué en Asie avec ses cultes, ses croyances, et sa grande richesse symbolique. Je connais un peu ces civilisations, j’éprouve pour elles de la sympathie et même de l’admiration, mais je ne partage pas leurs formes dévotionnelles. Le bouddhisme qui retient mon attention est celui de sa pensée la plus profonde, qui, étant critique et déconstructrice 7 fait voler en éclat les croyances communes, et favorise un contact infiniment proche avec la chair du phénomène. Il est celui qui, par le biais de son intimité cultivée avec ce qui se montre, par le biais de son examen soigneux des pulsions et des résistances de la vie vécue, prend à bras le corps la question existentielle. Il est celui qui marie étroitement la recherche de sa vérité déconstructrice avec l’éthique la plus exigeante, puisqu’une fois le bloc de notre propre identité egotique défait en une myriade d’expériences d’identification, se conduire en accord avec l’impératif catégorique devient pour ainsi dire une évidence ; non pas seulement une évidence intellectuelle mais aussi une évidence ressentie. Ce bouddhisme-là se rapproche considérablement de l’esprit (redécouvert par Pierre Hadot) des philosophies de l’antiquité grecque, du scepticisme pyrrhonien au stoïcisme en passant par l’épicurisme ; à ceci près qu’il fait confluer leurs diverses quêtes de la vie bonne et heureuse (l’eudaimonia) dans une pratique disciplinée que l’on peut qualifier (comme le suggérait Alexandra David-Néel) de « psychosomatique ». En définitive, le bouddhisme dont je vais vous parler n’est pas une « foi » de plus, mais, à travers sa philosophie, la plus vigoureuse dissolution de toute « foi » qui ait jamais été tentée dans l’histoire de la pensée humaine, et, à travers sa pratique méditative, un substitut puissant au besoin de la foi ou une transfiguration de son objet en état. Jules Ferry, dont le projet en 1883 consistait à fonder une morale laïque, une morale qui promeuve des valeurs universelles sans imposer un dogme ou une croyance, ne s’y était pas trompé. Son inspiration avouée pour instaurer l’enseignement d’une morale non-confessionnelle, ou « morale positive », lui était venue de l’Indochine bouddhiste : « (Cette morale positive) la voici (…). Elle est pratiquée par deux cents millions d’hommes et depuis vingt-trois siècles » 8. Il n’y a pas à s’étonner après cela que la proposition d’une « secular ethics », d’une éthique universelle indépendante de toute religion, soit venue du Dalaï-Lama 9. Durant l’une des remarquables rencontres Mind & Life entre lui et des chercheurs occidentaux, à laquelle j’ai eu la chance de participer activement en janvier 2013, la principale préoccupation exprimée par le Dalaï-Lama était de passer par-dessus les cadres religieux pour faire éclore une éthique planétaire capable de fédérer les réponses aux défis qu’affronte l’humanité.
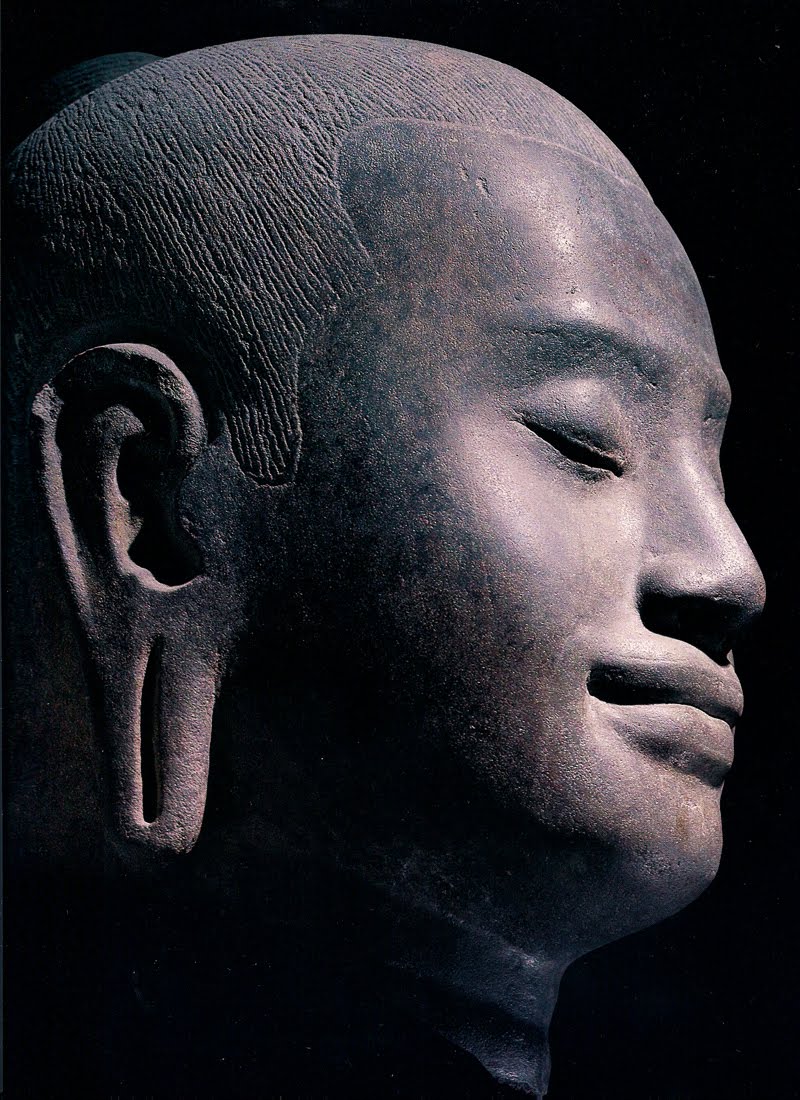
Jayavarman VII
À ce stade, je dois encore faire une seconde mise au point. Ma philosophie de la physique (pas plus que n’importe quelle autre réflexion sérieuse sur la science) n’implique en aucune manière le bouddhisme. Elle est prudente, concrète, minimale, et a priori ouverte à quantité de superstructures métaphysiques, même si elle en rend certaines moins aisément endossables que d’autres, et même si elle pèse fortement du côté d’une neutralisation du jugement métaphysique. Comme je vous l’ai signalé précédemment, je n’ai aucun goût pour un certain syncrétisme contemporain qui cherche coûte que coûte à donner un brevet de respectabilité scientifique à toutes sortes de spéculations visant à « réenchanter le monde », et je souhaite vivement que la philosophie de la physique que j’ai développée ne soit pas récupérée dans ce but. Sa seule affinité claire s’établit avec ce que j’ai appelé « la pensée la plus profonde du bouddhisme », de nature déconstructrice, et elle relève d’une opportunité de synergie culturelle plutôt que d’une très problématique analogie, et moins encore d’une relation d’implication 10.
Voilà une philosophie de la physique qui renonce à courir après les représentations d’une transcendance, et se contente d’habiter le milieu immanent des gestes, des projets, et de l’expérience vécue. Voilà du même coup une philosophie de la physique qui est difficile à concilier avec un certain rêve civilisationnel de passer outre le voile des apparences, et qui, de ce fait, tend à être considérée comme une simple étape d’ajournement provisoire du rêve. Une telle philosophie immanentiste et phénoméniste de la physique suscite un « malaise dans la civilisation », qui est également ressenti comme un malaise individuel chez ceux qui participent de cette civilisation (il suffit de penser à René Thom, selon lequel la théorie quantique est « le scandale intellectuel du siècle » 11). Or, à l’inverse, cette même mise au repos des élans vers une transcendance derrière les phénomènes, trouve une incontestable résonance dans la philosophie éminemment critique en quoi consiste « la pensée la plus profonde du bouddhisme ». Une telle philosophie critique étant du même coup une philosophie de l’existence, et une règle pour parvenir à un mode d’être qui lui soit conforme, elle peut être mise à profit pour résoudre collectivement et individuellement le sentiment de « malaise » dont je parlais. Dans son cadre, le retour à l’immanence dont tout cherche à nous faire sortir, y compris notre pulsion d’agir dans le monde et de le maîtriser à notre profit, n’est plus perçu comme une gêne ou une anomalie, mais comme une composante cruciale d’un mode de vie à la fois éthique et existentiellement clarifié. Dôgen, ce grand penseur Zen japonais du treizième siècle, l’a exprimé avec concision : « Cet univers entier n’a jamais rien de caché (derrière le phénomène) » 12. On s’approche ainsi d’une forme intégrale d’harmonie, allant de la plus profonde tonalité d’être à la plus fine pointe de la recherche scientifique, en passant par l’éthique, qui ne peut que satisfaire le désir d’unité que je ressens depuis longtemps. Une harmonie à 360 degrés !
AP : Du coup vous ne trouvez pas qu’il y a un rapport avec le geste de se désengluer du réalisme naïf dans la pratique bouddhique, avec en somme le geste de l’épokhè ?
MB : Ce que j’ai appelé « un contact infiniment proche avec la chair du phénomène » dans la pratique de la méditation, s’apparente en effet à un travail d’épochè radicale. Il s’agit d’une entreprise de suspension du jugement plus poussée que pratiquement tout ce qui s’est fait dans l’histoire de la phénoménologie. N’oublions pas qu’en phénoménologie husserlienne, l’épochè doit s’arrêter à un certain point, et être convertie en « réduction phénoménologique » ; car c’est seulement à partir de ce point d’arrêt qu’on va se donner un nouveau terrain d’étude, fût-il aussi exceptionnel que celui de l’ego transcendantal, avec ses actes épistémiques saisis à l’état naissant dans la conscience pure. Si l’épochè se poursuit et se radicalise, même le nouveau terrain d’étude se dissout, même l’égologie transcendantale est mise en difficulté, et même la distinction entre transcendance et immanence, dont je me suis servi à titre d’étape provisoire de la pensée, perd de sa consistance. Comme l’écrit Jan Patočka, « l’idée de l’épochè est indépendante de la réduction à l’immanence ». Alors que la réduction exclut de manière déterminée la thèse d’existence de la réalité extérieure, l’épochè fait plus profondément « apparaître une liberté de pensée à l’égard de toute thèse du monde » 13. L’épochè, c’est vraiment une conversion entière de l’être, car elle suspend tout jugement, y compris les jugements réflexifs, y compris les jugements d’existence et d’inexistence, y compris les proto-jugements de la perception, y compris même le jugement sur les jugements. Elle ne s’inscrit pas en faux contre le réalisme (au sens étendu que doit donner à cette qualification doctrinale un phénoménologue conséquent), mais contre la naïveté des pré-jugés qui font obligatoirement du réel un grand objet. Que reste-t-il une fois accomplie cette table rase sans limite ? « Un regard dans ce qui est, indépendamment de toute construction » déclare Patočka 14. Un établissement dans « c’est ainsi », ou dans « Les choses comme elles sont » 15, écrivent les penseurs bouddhistes. Cela, qui ne peut pas être montré, se montre de soi-même 16.
AP Et vous avez alors un projet à terme de philosophie pratique et morale ?
MB : Je ne suis pas sûr du tout d’avoir quelque chose à écrire sur ce sujet. Un livre de Francisco Varela 17 résume à peu de choses près ce que je pense dans le champ de la philosophie pratique. Il y développe le concept d’une « éthique incarnée » ; une éthique qui se passe de prescriptions, parce qu’elle découle naturellement d’une attitude d’ouverture dans l’immanence partagée. La seule chose qui mériterait d’être développée, dans la continuité de cet ouvrage, serait la manière dont s’accomplit la transmission du savoir-être « par l’exemple » de personne à personne, de cœur à cœur. C’est là le vrai mystère de l’éducation, précieux et fragile à la fois.
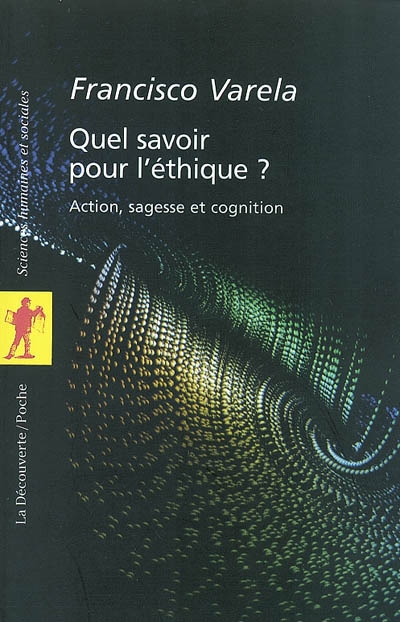
AP : Mais à travers le travail réflexif et à travers la pratique zen, vous avez des concepts qui vont créer d’eux-mêmes une éthique ou une morale. Autrement dit, au sein de votre pensée, il y a en soi de manière déterminée quoique potentiellement une systématisation pratique.
MB : Je ne crois pas que de là puisse émerger une morale. Tout au plus peut-on y associer un être-au-monde implicitement éthique, qui ne se décrète pas mais qui ne cesse de se chercher au risque de se perdre, qui ne s’impose à personne mais qui s’offre comme une hypothèse inarticulée. Une morale, ce sont des règles qui enjoignent de se conduire de telle ou telle manière ; au contraire, un être-au-monde éthique s’ouvre aux aléas de l’erreur parce qu’il n’a pas d’autre repère que celui, silencieux et faillible, du sentiment de l’acte juste. Il est vrai que cette incertitude, ce risque, cette liberté spinoziste « dans les limites de la simple raison », ne sont pas faciles à vivre. Confrontés à une perte de repères, la majorité des êtres humains contemporains se sentent déstabilisés par l’inscrutabilité d’un être-au-monde éthique, et cherchent à assurer leur sécurité intérieure par un retour à telle ou telle hyper-morale contraignante dotée d’un fondement transcendant. Face à cela, je n’ai aucune réponse facile. Je me contente de ressentir de la gratitude à l’égard des « grandes âmes » (c’était le nom qu’on donnait à Gandhi) qui, sachant être et transmettant leur exemple, rendent malgré tout envisageable à long terme un avenir éthique affranchi de la contrainte morale.
AP : Là je parle de ce qui est impliqué déjà dans votre théorie et dans vos intérêts, ce qui en découlerait naturellement. L’éthique est peut-être inscrite malgré vous dans votre pensée, sa mise au jour peut advenir plus tard.
MB : Vous savez, j’ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie : de la médecine, de la physique, et toutes sortes de spécialités philosophiques allant de l’épistémologie à la phénoménologie. Je ne suis pas sûr que j’irai plus loin que cela, en tâchant de mettre au jour une possible implication éthique de mon travail. L’éthique est dans mon horizon, bien sûr, comme elle est dans l’horizon de tout être humain. Elle est aussi involontairement à mon point de départ, parce que, comme toute recherche sincère, celle-ci jaillit d’un désir de mise en accord entre ce qu’on connaît, ce qu’on est, et ce qu’on voudrait être. Je n’en sais guère plus. Mais je comprends bien que votre question va au-delà de l’intention de mon travail ou de la capacité que j’ai à en prendre conscience, parce qu’elle interroge sa possible réception. Alors, pour y répondre, je formerai simplement ce vœu devant vous : que cette quête personnelle soit lue exactement dans l’esprit que vous suggérez, et qu’elle devienne ainsi utile à d’autres pour parvenir à leur propre point d’équilibre éthique. Je forme le vœu que vous ayez raison lorsque vous considérez cette philosophie de la connaissance comme potentiellement éthique, car je serais heureux de léguer ce genre de chose à la génération qui vient, même si je n’en ai pas moi-même compris pleinement l’enjeu.
AP : Il me semble qu’on a affaire un paradoxe proprement contemporain : le sujet conscient et rationnel s’est vu déconstruit et se voit même aujourd’hui réduit à un système cérébral et hormonal, et en même temps la modernité a individué à un degré jamais vu le sujet, même si l’individuation réelle (non pas l’uniformisation culturelle des individus individués simplement économiquement) n’est l’apanage que de quelques grands hommes qui font l’histoire de la littérature et de la philosophie. Comment expliquez-vous que l’époque philosophique actuelle, et même l’épistemè actuelle plus largement, pense autant le renoncement au Sujet – travail accompli par Hume, Nietzsche, et aujourd’hui moult philosophes et neuroscientifiques que Daniel Dennett systématise en quelque sorte -, et en même temps l’affirmation totale de ce Sujet – la modernité se définissant comme son affirmation politique et économique, comme son individualisation achevée, mais aussi littérairement et philosophiquement, ainsi que le montrent les écrits d’un Baudelaire, d’un Rousseau, d’un Proust ou des romans de l’absurde, etc. : on a un hypersujet tout en « sous-sol », individué par une conscience creusée par la modernité, comme l’écrivait Dostoïevski. Comment expliquer les deux ? Quand vous parlez d’effondrement dans les phénomènes, de se tenir dans l’immanence pure, alors on n’est plus sujet, et en même temps ce type d’expérience zen creuse l’intériorité, le surplomb réflexif individue la conscience à un degré plus fort. Comment comprendre le fait que dans certaines théories on détruise complètement le sujet et dans la réflexivité on le rende hypersujet, et comment le comprenez-vous dans votre propre philosophie, qui me semble refléter ce monstre à deux têtes contemporain?
MB : Voilà une autre question magnifique et difficile ! Vous avez parfaitement décrit l’écartèlement, à ceci près que je ne suis pas sûr que le sujet déconstruit et le sujet « valorisé » soient superposables.
Commençons donc par le premier. Vous rapprochez l’une de l’autre la déconstruction philosophique du sujet individuel et la déconstruction neurologique de l’unité de la personne. Depuis Hume, avec sa résolution du sujet en une constellation sensualiste, jusqu’à Nietzsche ou Sartre, avec leur exaltation de la spontanéité face à la nécessité atavique et biographique, bien des philosophes ont en effet contesté que le sujet soit autre chose qu’un nœud dynamique de convergence des expériences, des projets, et des imprévus pulsionnels. De leur côté, les neurobiologistes ont défait le sujet sentant et agissant en une myriade d’agents modulaires représentés par les aires spécialisées du cortex cérébral 18, et on a laissé à un philosophe (encore Dennett) le soin d’asséner le dernier coup en niant l’existence d’un « chef d’orchestre » pour diriger ce concert polyphonique. Cela étant dit, les neurosciences cognitives se détournent progressivement de ce tableau sans nuances, par la voix de leurs représentants les plus emblématiques 19, ce qui suggère qu’elles n’ont pas les moyens d’opter par elles-mêmes entre les deux pôles de l’écartèlement. Par ailleurs, elles demeurent (inévitablement) silencieuses sur ce qui est en jeu dans les critiques philosophiques du sujet : l’expérience en première personne de sa fragmentation alléguée, couplée à l’expérience en première personne de projets et d’idéaux régulateurs ayant pour effet de surmonter cette fragmentation. L’un des seuls penseurs qui ait tenté de jeter un pont solide entre les deux critiques déconstructrices est Francisco Varela 20. Lui tenait d’un côté le fil d’une biologie théorique selon laquelle l’être vivant est fait d’une pluralité d’agents moléculaires ou cellulaires dont les opérations convergent dans un cycle autopoïétique individuant, et de l’autre côté le fil d’une phénoménologie concrète, d’une pratique méditative, apte à exposer au jour de l’expérience les moments fragmentés de la vie mentale sans perdre de vue ses horizons de synthèse. Les deux fils étaient selon lui l’envers l’un de l’autre, sans pouvoir se réduire l’un à l’autre. Car, ainsi qu’on vient de le signaler, l’analyse objective des divers aspects fragmentaires des processus biologiques laisse entièrement de côté le travail voulu et éprouvé d’individuation globale.
Du côté du second versant de l’écartèlement, c’est-à-dire du côté du sujet « exalté », les choses sont peut-être encore plus paradoxales. Car ce qui est valorisé ici n’est pas une vie intérieure mais une fonction économique et sociale. L’individu doit se conduire comme un être autonome, comme un être responsable de ses choix ainsi que de ses succès et de ses échecs, comme un être poursuivant ses propres intérêts égocentrés et contribuant à la vie sociale dans la seule mesure de ces intérêts. Peu importe qu’il « soit » ainsi ou pas, il doit s’efforcer de le devenir. Les théories économiques les plus courantes sont entièrement basées là-dessus. Elles sont basées sur l’hypothèse de choix rationnels, qui consistent pour l’individu à maximiser ses propres profits matériels ou symboliques par des achats (le marché des biens), par des options professionnelles (le marché du travail), et par des conduites (le marché des services). Ayant un effet rétroactif sur l’organisation sociale, ces théories conduisent à accentuer l’insularité des individus dans leur milieu de vie, afin d’assurer la conformité de leurs comportements à ce que l’on pense être les conditions de fonctionnement optimal de la machine économique. L’individu de la théorie économique n’est rien d’autre que la condition exigée par cette même théorie pour être vraie. Ainsi vit-on collectivement dans un climat d’incohérence chronique, entre les croyances nouvelles que produit notre culture, et la norme qu’impose le Leviathan socio-économique dont elle est l’expression ; entre la volatilisation du sujet cohérent par la neurobiologie, et la demande marchande d’instaurer un sujet individuel isolé et « rationnel ». Telle est l’une des bases de ce que Varela appelle le « nihilisme contemporain » : « La situation nihiliste est celle dans laquelle nous savons que nos valeurs les plus chères sont intenables, mais où pourtant nous sommes incapables d’y renoncer » 21. La valeur d’individualisme est considérée comme scientifiquement intenable, et pourtant, non seulement nous la maintenons, mais nous l’intensifions de manière inégalée dans l’histoire en faisant peser sur les êtres humains une injonction de « choisir leur vie » parfois trop lourde à porter 22. Telle est la conséquence d’une pression constante vers le perfectionnement de la « main invisible » d’Adam Smith.
Comment surmonter dans ces conditions le grand écart de ce que vous appelez notre « monstre à deux têtes » civilisationnel ? Je passerai sur la tendance actuelle à privilégier une « neuroéconomie », qui prend acte de l’éclatement du sujet biologique en pulsions désirantes contradictoires, et qui cherche à augmenter encore par ce biais l’impact du système économique sur les ultimes lambeaux de la personne. Au lieu de cela, je ferai signe vers deux stratégies plus humanistes de réduction du « grand écart » : par le haut de l’unité projetée, et par le bas de l’unité habitée.
Tout d’abord, par le haut. Comme je l’ai signalé précédemment, il n’est pas « intrinsèquement vrai » que nos sociétés se réduisent à une collection d’individus poursuivant des intérêts exclusivement égoïstes. L’atomisation individualiste est à la fois une hypothèse de la théorie économique, et une rétroaction de cette hypothèse sur la société, à travers le genre de politique que mènent les dirigeants qui l’ont adoptée. Ce que la société croit être rétroagit sur ce qu’elle est, et sur ce que deviennent ses constituants. Il est donc en principe envisageable de revenir sur la fragmentation sociale et l’isolement individuel par le haut d’idéaux de cohésion sociale et de politiques conformes à ce genre d’idéaux. Il faudrait pour cela que l’action politique démocratique sache à nouveau susciter un rêve collectif mobilisateur, ce qu’elle a actuellement renoncé à faire (à quelques heureuses exceptions près, comme Mandela et Obama), par une réaction compréhensible contre les folles mythologies totalitaires du vingtième siècle.
Par le bas, ensuite. Plus bas que la « conscience creusée par la modernité », plus bas encore que le sous-sol de l’anti-héros des « Carnets » de Dostoïevski, il est possible de trouver une nappe phréatique d’eau calme et partagée : celle que j’ai appelée, faute de mieux, l’expérience pure à la fois pré-individuelle et pré-sociale. Ce niveau dernier est singulier, sans être particulier. Il n’est plus celui d’un sujet personnel, et il s’accorde donc sans difficulté avec la déconstruction à la fois philosophique et neurobiologique du sujet. Il ressemble moins encore à un individu atomique, mais il détient en lui toutes les potentialités nécessaires pour se constituer en sujet individuel, afin de satisfaire à des demandes sociales, tout autant qu’à l’inverse il passerait aisément outre la norme d’atomisation individuelle si un nouveau paradigme social émergeait.
J’ajoute à cela qu’il n’est pas impensable que l’accès à ces eaux profondes d’expérience ait un effet positif en retour sur les normes sociales, ce qui reviendrait à promouvoir l’unification haute des sociétés par un emprunt à l’unité fondationnelle de l’existence humaine.
Peut-être pourrions-nous terminer l’entretien sur cette note d’unité, qui était aussi notre point de départ ?
- M. Bitbol, Physique et philosophie de l’esprit, Flammarion, 2000 ; M. Bitbol, La conscience a-t-elle une origine ? Flammarion, 2014
- on peut consulter la recension de L’esprit conscient à cette [adresse.
- D. Cosmelli, O. David, J.P. Lachaux, J. Martinerie, L. Garnero, B. Renault, F. Varela, « Waves of consciousness: ongoing cortical patterns during binocular rivalry », Neuroimage, 23, 128-40, 2004
- M. Le Van Quyen, C. Petitmengin, « Neuronal dynamics and conscious experience: an example of reciprocal causation before epileptic seizures », Phenomenology and the Cognitive Sciences 1, 169-180, 2004
- J.-P. Lachaux, « If No Control, Then What? Making sense of neural noise in human brain mapping experiments using first-person reports », Journal of Consciousness Studies, 18: 162 – 166, 2011 ; C. Petitmengin, J.P. Lachaux, « Microcognitive Sciences: bridging experiential and neuronal microdynamics ». Frontiers in Human Neuroscience, 7:617. doi: 10.3389/fnhum.2013.00617, 2013
- M. Bitbol, La conscience a-t-elle une origine ?, Flammarion, 2014
- Cette philosophie critique et déconstructrice, dont le geste fondamental consiste à renvoyer dos à dos toutes les thèses sur le monde, en faisant voir leur caractère antinomique, s’appelle la « voie du milieu » (Madhyamaka en Sanskrit). Le principal penseur de cette école est Nāgārjuna, philosophe et sage indien du IIe-IIIe siècle. (voir Nāgārjuna, Stances du milieu par excellence, Gallimard, 2002)
- P. Chevallier, La séparation de l’église et de l’école : Jules Ferry et Léon XIII, Fayard, 1981
- Dalaï-Lama, Beyond Religion, Ethics for a Whole World, Mariner Books, 2012
- M. Bitbol, «Dépayser la pensée scientifique», in: T. Marchaisse (ed.), Dépayser la pensée (dialogues hétérotopiques avec François Jullien sur son usage philosophique de la Chine), Les empêcheurs de penser en rond, 2003 ; M. Bitbol, « L’unité organique des opérateurs de connaissance : La mécanique quantique, Kant, et le madhyamaka », in : M. Cazenave (ed.), De la science à la philosophie : Y a-t-il une unité de la connaissance, Albin Michel, 2005 ; M. Bitbol, De l’intérieur du monde, op. cit.
- R. Thom, Prédire n’est pas expliquer, Flammarion, 1993, p. 86
- Dôgen, Shôbôgenzô 3 (traduction et présentation de Y. Orimo), Sully, 2007, p. 38 ; voir M. Bitbol, « La théorie quantique et la surface des choses », in : Y. Orimo (ed.), Dôgen, Shôbôgenzô volume 5, Sully, 2011
- J. Patočka, Papiers phénoménologiques, Jérôme Millon, 1995, p. 163, 187
- Ibid., p. 195
- H. Clerc, Les Choses comme elles sont, Une initiation au bouddhisme ordinaire, Gallimard, 2011
- L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6.522
- F. Varela, Quel savoir pour l’éthique, La Découverte, 1996
- J. Fodor, Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology, MIT Press, 1983
- J. Fodor, The Mind Doesn’t Work That Way : The Scope and Limits of Computational Biology, Bradford Books, 2001
- F. Varela, « Organism: A Meshwork of Selfless Selves », In: Organism and the Origins of Self, Boston Studies in the Philosophy of Science, Volume 129, 1991
- F. Varela, E. Thompson & E. Rosch, L’inscription corporelle de l’esprit, Seuil, 1993, p. 183
- A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, Odile Jacob, 2000








