Longtemps professeur à l’Université Paris-X Nanterre, François Laruelle est à l’origine d’une œuvre difficile et abondante, riche de plus d’une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels Le Principe de minorité, Une biographie de l’homme ordinaire, Les Philosophies de la différence, En tant qu’Un. La « non-philosophie » expliquée aux philosophes, Principes de la non-philosophie, Le Christ futur, une leçon d’hérésie, Introduction aux sciences génériques, Philosophie non-standard : générique, quantique, philo-fiction, et plus récemment Christo-fiction, sur lequel nous nous attarderons plus longuement. Sa reconnaissance internationale est de plus en plus forte, comme en atteste le colloque La philosophie non-standard de François Laruelle, qui s’est tenu à Cerisy en septembre 20141, et qui a rassemblé des chercheurs venant de différentes disciplines et de différents pays, de Russie aux Etats-Unis en passant par Taiwan.
Si cette redécouverte récente de l’œuvre de François Laruelle est en particulier due à la vitalité du courant appelé (quelle que soit la justesse de cette expression) le réalisme spéculatif, aux perspectives et préoccupations duquel François Laruelle est indirectement associé, il faut cependant examiner dans sa singularité cette pensée qui, avec le terme risqué de non-philosophie, tente de mettre en place un nouvel usage de la philosophie et de ce que Laruelle caractérise comme le matériau philosophique. Dans un articlé publié en 20032, Ray Brassier qualifie François Laruelle comme le plus important philosophe inconnu européen, en ce qu’il développe non une thèse originale sur l’un ou l’autre des objets classiques de la philosophie, mais une manière de penser et de s’approprier la philosophie.
Selon la formulation proposée pour l’annonce du colloque de Cerisy3, la non-philosophie ou « philosophie non-standard » développe une nouvelle théorie et une pratique de l’acte philosophique, hors de ses normes traditionnelles d’auto-modélisation. Elle fait travailler ensemble à titre de variables conjugables une structure philosophique traditionnelle comme la structure transcendantale et un noyau de pensée tiré de la physique quantique. Il ne s’agit cependant pas d’une philosophie de la science mais d’une association à part égale de la philosophie et de la science actuelle.
Je remercie François Laruelle de sa disponibilité et sa générosité lors de l’entretien qu’il m’a accordé.
Actu-Philosophia : Je pense que je ne surprendrai personne en disant que vous êtes un auteur très difficile. Pour préciser, il me semble que votre œuvre combine deux difficultés. La première – la plus immédiate – est celle de sa terminologie et de la manière dont la pensée est déployée. La seconde – qui est peut-être plus importante encore – est de comprendre ce que la non-philosophie implique en terme de posture, de disposition, ce à quoi elle appelle en tant que suspension de la philosophie.
François Laruelle : Je reconnais évidemment la difficulté de la lecture, à cause de la terminologie, de la densité conceptuelle, d’un type de discursivité souvent très rapide, brûlant certaines étapes. Je reconnais aussi la difficulté de l’axiomatique, surtout au début de mes recherches, puisque je me suis depuis éloigné de cette forme. Cette difficulté, je l’assume, mais elle vient de la richesse du matériau traité, c’est-à-dire de la multiplicité des philosophies sous-jacentes, des références muettes. En effet je fais peu de références académiques, comme si je n’avais pas de culture philosophique alors que je me meus dans cette culture. Mais pas dans ses objets dans lesquels les thèmes sont fixés et normés. Pour prendre une image venant de la physique, le mouvement de l’onde se fait dans l’eau, mais ce n’est pas nécessairement le mouvement de l’eau. De la même façon, ma manière de penser est plutôt de l’ordre du flux, je traverse les objets classiques de la philosophie sans me fixer sur eux. Ce qui m’intéresse, c’est le mouvement de la pensée, la flèche ou le vecteur. Ces objets servent de supports locaux et provisoires, ce qui fait toute la difficulté du style à tous les plans. Il y a de grands thèmes dans mon évolution, mais traversés par un unique flux oscillant. Autrefois, je divisais ma production en stades (I, II, III, IV, V), mais j’y ai renoncé parce que j’en serais peut-être au VIIIe et cette succession n’aurait plus vraiment de sens. J’y ai renoncé, et je parlerais à présent plutôt de vagues qui se recouvrent les unes les autres. Des vagues qui se dirigent vers le même problème et traversent (se font à travers) une matière hétérogène. Cela rend ce qui est pensé difficile pour toute approche de type académique.
AP : Je me permets tout de suite une petite demande de précision à propos de cette idée de matériau, de traiter les philosophies, au sens classique, comme des matériaux pour la philosophie non-standard. Votre projet, écrivez-vous, est de « (…) ne pas détruire la philosophie, mais changer notre rapport à elle et multiplier ses usages : préparer une pragmatique non-philosophique de la philosophie4 » Vous est-il possible de revenir sur ce que vous entendez par une telle réappropriation (même si le terme réappropriation n’est sans doute pas adéquat) ?
FL : Je pratique en gros le même type de geste, de modélisation avec différents matériaux. Le but est leur mise en accès. Je veux dire : je ne cherche pas à détailler le matériau philosophique, mais à le penser autrement. On pourrait dire en reprenant une formule de Deleuze et de Foucault, à accepter que la philosophie soit un vaste théâtre, elle n’est plus accessible pour moi qu’à travers certains usages – à travers leur geste même. Pour moi c’est toujours le geste ou la posture qui est intéressant. Evidement, je suis passé par un certain nombre de matériaux, mais l’essentiel était justement de passer – d’assurer le passage. D’ou une certaine réduction du matériau à l’état de symptôme, dont la racine reste plus ou moins secrète, même si elle peut être révélée par un ensemble de mises en formes des matériaux. La science ou la mystique sont autant de symptômes ou d’effets qui renvoient de façon variée aux gestes de la pensée. Ainsi, la pensée que je développe varie, parce que les matériaux à travers lesquels elle se déploie, en variant, la font varier. Il n’y a pas d’essence de la non-philosophie qui serait absolument et définitivement définissable, si ce n’est justement comme ondulatoire, ses matériaux rétroagissent sur la formulation de l’acte de penser qu’elle propose chaque fois.
AP : Pour revenir encore sur cette idée de mise en accès du matériau philosophique, qui me semble essentielle pour comprendre votre travail : il me semble que c’est ce qui interdit toute confusion de la non-philosophie avec une déconstruction radicalisée. Alors que la déconstruction interroge et désassemble les éléments de la syntaxe par laquelle la philosophie se déploie, la non-philosophie y ouvre de nouveaux usages. Elle a d’abord valeur performative. Il s’agit, si je vous comprends bien, de suspendre la disposition philosophique, ou quelque chose de la disposition philosophique, ce que vous appelez sa suffisance. De ne plus être pris dans la philosophie afin de comprendre autrement le philosopher.
FL : La philosophie est une structure relativement stable mais objet d’un ou de multiples usages. Il n’y a pas de vérité philosophique absolument en soi. La manière dont je la traite présuppose une structure, une multiplicité de rapports à celle-ci, validant l’usage que j’en fais. La philosophie en général a tendance à refuser qu’on en use. Elle ne veut justement pas être une posture ou une disposition. J’appelle cette attitude le Principe de suffisance philosophique : sa façon de s’auto-donner une autorité qui bloque l’accès à l’usage de son propre discours. Il s’agit en quelque sorte de concentrer le « mal » ou « l’insuffisance » de la philosophie dans sa suffisance. En particulier, en refusant qu’elle vise une vérité immuable.
La philosophie ne pose pas de vérité, même si la vérité fait partie de ses objets. Il y a un rapport pragmatique complexe à sa pratique dont il faut tenir compte. Ce rapport est structuré par un arrière plan déjà philosophique mais aussi scientifique, par exemple aristotélicien ou bien newtonien, auquel je substitue une formalisation maintenant quantique. Il s’agit alors d’en développer un autre usage plus novateur, défaisant ces rapports, ces structures à travers lesquels elle se constitue comme norme et paradigme de l’existence. La transformation des usages de la philosophie ne doit pas se faire uniquement de l’intérieur de celle-ci comme c’est encore la tradition, même dans la « critique » qui n’ébranle pas suffisamment l’appareil du passé, mais se faire en lien étroit avec la science et ses catégories s novatrices et « prometteuses ». J’ai une vision quasi-messianique mais adoucie de la science, en particulier de la physique. Seule la conjugaison des postures scientifique et philosophique permet de se déprendre de la suffisance philosophique. C‘est pourquoi je ramène les critiques de la philosophie produites par celle-ci en son sein et à sa stérilité de cercle ou de pétition. Elle produit beaucoup de nouvelles catégories comme l’Autre (plutôt que l’Être) pour se déconstruire tout en en ayant un usage qui demeure encerclé de philosophie. Prétendre que la philosophie puisse elle-même se délimiter par ses objets ou ses effets, comme aussi s’auto-engendrer, c’est bien encore de la suffisance. La modernité est une version auto-critique de l’auto-engendrement. Une telle délimitation exige le concours « occasionnel » d’une extériorité non-philosophique comme celle de la science – non pas de la science seule et pas de n’importe laquelle, ce qui serait du positivisme et en fin de compte à nouveau classiquement de la philosophie. Il s’agit plutôt de développer une façon de conjuguer la science à la philosophie pour donner accès à ce qui, mais en dernière instance seulement reste encore une philosophie. D’une certaine manière, la non-philosophie est encore de la philosophie : mais une philosophie qui ne cherche plus à s’auto-engendrer, à se sacraliser. Une philosophie dont on puisse du coup se servir.
AP : Qui ne s’immunise pas contre son usage… D’où, pour rebondir sur la question de la science, votre appel fréquent, surtout dans les premières œuvres, à l’expérience de pensée du scientifique – à adopter son propre point de vue et non plus seulement celui de la philosophie mais les deux en rapport complexe de concurrence réglée et structurée par une formalisation immanente. Dans Philosophie et non-philosophie5, vous parlez de la science comme d’une pensée « opaque », « irréfléchie » – « une sorte de comportement théorique ». La science, dites-vous, n’a pas besoin de fondement philosophique, mesure que le positivisme et le scientisme, qui sont encore des doctrines ultimement philosophiques, ne prennent pas de la façon même s’ils ont à chercher à se calquer sur la science sans l’habiter. La science, finalement, n’est pas la solution à la question du réel, mais le meilleur outil, le meilleur exercice spirituel ou « expérience de pensée » pour se dégager, en acte, de la disposition philosophique.

FL : J’ai eu tendance à penser à une époque que la science a une manière d’approcher le réel plus directe que la philosophie. J’insistais alors sur l’opacité de la pensée scientifique : sur sa dimension pragmatique et formelle, relativement indépendante de la réflexivité. Je mettais en avant, comme vous dites, son aspect de comportement théorique. Maintenant, je serais plus nuancé sur cette idée, qu’il faudrait préciser et affiner, mais je garde la notion d’un philosophème irréfléchi.
AP : On pourrait dire que la science met en jeu une autre forme de distance, pas réflexive, mais stratégique.
FL : Pas seulement mais ce serait plutôt cela. D’ou ma référence non-positiviste à la mécanique quantique, mais je suppose qu’on aura l’occasion d’y revenir.
AP : Maintenant que le cadre général est posé, peut-être pouvons-nous passer à votre itinéraire ou à votre parcours. Et peut-être d’abord à la façon dont, aux prises avec les problématiques de l’époque et avec le legs de l’histoire de la philosophie, vous avez été amené au geste non-philosophique. On pourra aussi évoquer les relations ou débats que vous avez pu avoir avec d’autres auteurs contemporains, avec Deleuze et Derrida en particulier.
FL : J’ai commencé en effet par un grand travail sur les philosophes contemporains, à partir du quadrangle : Nietzsche/Deleuze, Heidegger/Derrida. A ces quatre noms, on peut ajouter celui de Levinas, que j’ai travaillé moins directement, mais qui a eu une très grande influence sur moi en me donnant l’exemple d’une possibilité de se détacher de l’autorité du logos philosophique.
En étudiant les différentes tensions de ce quadrangle, j’ai réalisé qu’il manquait quelque chose à la philosophie : il lui manquait une pensée spécifique de l’Un. L’enjeu était alors la tension entre une pensée de l’Être et une pensée de l’Autre. Il fallait encore accomplir une véritable méditation de l’Un, investir le problème de l’Un, ce que j’ai commencé à faire avec Le principe de minorité6 surtout Une Biographie de l’homme ordinaire7 : questionner le problème de l’Un et de sa position.
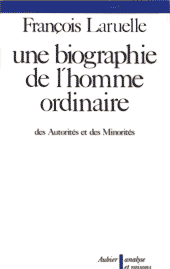
AP : Justement à ce sujet. Vous vous confrontez à cette question d’une façon singulière, différente d’auteurs comme Michel Henry, par exemple. Vous ne cherchez pas à développer une hénologie, vous ne cherchez pas à dévoiler ou à décrire la structure de l’Un, votre pensée n’est pas une pensée « de » l’Un, une appréhension par la pensée de l’impensabilité de l’Un ni même de l’impensabilité comme signe ou ouverture vers l’Un, mais plutôt ce que vous appelez une pensée « selon » l’Un. Dans votre entretien avec Jean-Didier Wagneur, dans En tant qu’Un, vous dites que votre projet a été d’ « (…) atteindre l’individualité la plus radicale, la plus ultime, en me servant des moyens traditionnels de la philosophie (Nietzsche) », de « penser l’individu », mais dans la Biographie de l’homme ordinaire, de « (…) supposer l’individu déjà donné, et ne pas le chercher. ».
FL : Oui, j’ai précisément eu un échange à ce sujet avec Michel Henry dans les années 80. J’ai essayé de lui dire : vous vous battez avec l’Un. Supposons au contraire que je ne me batte pas avec l’Un mais que j’en tire les conséquences : admettons l’Un, qu’est-ce que ça implique pour la pensée, et pour la philosophie en particulier ?
AP : Il y a peut être alors dans la façon dont la pensée se construit au moins, un certain air de famille avec les philosophies classiques allemandes, Fichte en particulier. Sur la façon dont l’absolu n’est plus quelque chose qu’il faut comprendre ou pénétrer : mais une fonction dans l’économie du déploiement d’un système. Qu’est-ce qui m’appelle à poser l’absolu – qu’impose à ma pensée d’assumer l’absoluité de l’absolu ?
FL : Oui. J’ai d’ailleurs esquissé une discussion avec Fichte dans Les principes de la non-philosophie. Je suis un grand lecteur de la thèse de Philonenko sur Fichte (La liberté humaine dans la philosophie de Fichte).
AP : D’ailleurs, chez Fichte, il y a toujours à réécrire une nouvelle doctrine de la science. La philosophie ne s’accomplit et ne se dépasse pas comme chez Hegel. Tout au plus maitrise-t-elle son propre usage. Je ne peux pas m’empêcher de penser à l’importance de Fichte chez un auteur sur lequel j’ai beaucoup travaillé, Marc Richir, et la façon dont il construit sa propre phénoménologie à partir d’une démarche en zigzag, où les différentes dimensions sont dégagées les unes par rapport aux autres, dans le geste de la pensée qui les distingue et les pose pour penser à partir d’elles. Je trouve qu’il y a une certaine manière commune de faire usage de la conceptualité philosophique. D’autant plus que Marc Richir a d’abord été physicien, et qu’il invoque aussi la démarche de la mécanique quantique – en particulier, la façon dont elle joue avec des quantités virtuelles – comme inspiration de sa philosophie.
FL : Je trouve la référence à la physique plus féconde que la référence aux mathématiques. Les mathématiques ont depuis toujours à voir avec l’autorité philosophique, alors que la physique renvoie à des stratégies de pensée, à des gestes d’interprétation comme le fait la quantique. Ce qui m’éloigne quelqu’un comme Alain Badiou, c’est son fondamentalisme mathématique qui va de pair avec un fondamentalisme philosophique. Les mathématiques sont au service d’une stratégie de domination, d’une reconquête de la maitrise par la philosophie. Au bout du compte, chez Badiou, la philosophie est totalement ré-instituée – ré-instituée avec de nouveaux objets, mais avec des usages et des fonctions inchangés. Cela donne un très bel édifice, mais ce n’est vraiment pas une philosophie dont on peut user, elle est trop inspirée par la volonté de domination.
AP : Nous avons évoqué Michel Henry, vous venez de parler d’Alain Badiou, auquel vous avez consacré un livre (Anti-Badiou. Sur l’introduction du maoïsme dans la philosophie. Éditions Kimé, 2011). Serait-il possible de revenir à vos débats avec les philosophies et les philosophes de la différence – avec Deleuze et Derrida, en particulier ?
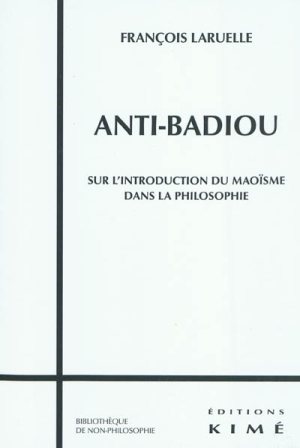
FL : L’Un, je l’ai en effet dressé contre la différence et contre les philosophies de la différence, en particulier de Deleuze et Derrida, – la différence qui allait devenir un nouvel absolu philosophique se substituant à l’Être. Je précise cependant que j’ai bien connu Deleuze pour qui j’ai toujours eu beaucoup d’admiration. Il a vraiment un génie philosophique admirable, en particulier un génie de la formule, de la densité et de la…danse. J’ai encore mieux connu Derrida, et aussi un peu Levinas dont j’ai été le jeune collègue, à qui j’ai consacré un ouvrage collectif, Textes pour Emmanuel Levinas, qui comportait des textes de Derrida, Lyotard, Ricoeur, Dufrenne, Jabès, Blanchot. Comme je le disais tout à l’heure, Levinas n’est pas un philosophe de l’Autre. La philosophie de l’Autre, c’est Derrida. Levinas parle d’autrui ; et bien plus que Derrida il remet en cause l’autorité philosophique.
AP : Le dialogue a-t-il pu se nouer avec Deleuze et Derrida ?
FL : Deleuze m’a consacré deux notes dans Qu’est-ce que la philosophie ?, qui sont fausses, Deleuze a sa manière géniale à lui de tordre les références, il lit ma tentative comme un retour au spinozisme du Dieu-Un. 8
J’ai cherché à répondre dans une intervention au Collège de Philosophie puis dans l’ouvrage collectif La non-philosophie des contemporains et à faire valoir la différence entre la philosophie paradigmatique de Spinoza et la non-philosophie que Deleuze s’approprie aussi sur un mode plus timide, un peu comme Merleau-Ponty. J’ai proposé aussi une réponse plus approfondie avec Les philosophies de la différence9.
Dans Le déclin de l’écriture (Paris, Flammarion, 1977), je me suis expliqué avec Derrida. Le livre est suivi d’entretiens avec lui, avec Jean-Luc Nancy, Sara Kofman, Philippe Lacoue-Labarthe, entretiens qui sont assez durs comme toujours avec des disciples. Le dialogue avec Derrida a été en général difficile et tendu. Lors d’une séance de confrontation au Collège international de Philosophie, il m’a accusé d’être dans le polemos. Comme j’avais cherché à montrer ce qu’il restait à mon goût de trop philosophique dans la déconstruction, Derrida m’a dit : « on se croirait à Chicago, vous vous emparez de mon arme et vous la retournez contre moi ». Disons que pour retourner un révolver contre son possesseur, il faut une certaine présence d’esprit et une incontestable habileté…
AP : Et Lacan ? Peut-être – je ne sais pas si vous serez d’accord, mais là où je vois le plus de parenté avec votre pensée, c’est chez Lacan, dans sa façon d’user de la philosophie en la symptômatisant. En ce qui me concerne, c’est à travers Lacan que j’ai eu l’impression de vous comprendre, mais c’est peut-être aussi dû au travail de Didier Moulinier et à son livre De la psychanalyse a la non-philosophie : Lacan et Laruelle (Kimé, 1998).
FL : Lacan, oui, mais c’est une influence plus indirecte. Il y a un certain nombre de thèses ou de façons de se positionner lacaniennes qui m’ont influencé. En revanche, je ne suis pas du tout un lecteur systématique de Lacan. Cette « influence » est plus diffuse.
AP : Il y a la façon d’aborder la « question » du réel, ou peut-être pour la philosophie d’être fatalement amenée à « cloner » le réel.
FL : Cloner, oui. J’ai proposé toute une théorie de ce que j’appelle le clonage transcendantal dans Les Principes de la non-philosophie. Mais je n’ai pas une pensée du réel seulement négative ou soustractive. On pourrait dire aussi que ce que j’ai cherché à penser, c’est le donné sans donation.
AP : Je me permets simplement d’ajouter ici que certains philosophes refusent cette terminologie du donné. Pour Jocelyn Benoist, le réel est alors ce qu’on a, avec quoi on a à faire et se débattre, pas ce qui nous serait donné et à quoi il faudrait avoir accès.
Une dimension importante de votre œuvre a été de montrer l’importance des dualités qui structurent la philosophie, et la logique même qui les sous-tend. Vous vous êtes expliqué à ce sujet assez souvent (déjà dans l’entretien de 1990 avec Jean-Didier Wagneur, publié dans En tant qu’Un, dans lequel vous faites une réponse extrêmement approfondie et éclairante à ce sujet). Je ne vous demanderai pas de reprendre toutes vos explications à ce sujet…
FL : C’est un thème essentiel. J’ai voulu analyser la philosophie comme utilisation et dégagement de dualités. Par exemple, la dualité de la philosophie transcendantale, dualité de l’expérience et de l’a priori. Ou bien les dualités de la psychanalyse, et, avec Deleuze, la tentative de penser la psychanalyse de manière non oedipienne. A chaque fois, ma thèse est que la philosophie a besoin de trois termes pour articuler ses dualités. La philosophie est une maison à deux étages, le second pouvant servir de mirador indépendant ou pas. On a un rez-de-chaussée, un premier étage et un mirador qui donne le point de vue de l’unification et de la totalité du paysage. Depuis Kant, ce mirador est le transcendantal, la panopticon en est le concentré étalé. A cette logique, j’oppose une logique inspirée de la mécanique quantique, fonctionnant avec des superpositions plutôt que des synthèses. En mécanique quantique, deux états peuvent être superposés, ce qui engendre un nouvel état du même type. La superposition joue comme un transcendantal étalé qui résorbe continuellement sa transcendance et conduit à un état nouveau – à une immanence, pas à une instance nouvelle de synthèse.
AP : Justement, il semble que la référence à la mécanique quantique marque une évolution dans la façon dont vous envisagez et présentez la non-philosophie. Dans un premier temps, le choix d’une exposition axiomatique qualifiée de transcendantale exploitait une dimension du formalisme, celle qui fascinait déjà Lacan : le formalisme force la pensée et nous amène à penser sans comprendre. L’axiomatique coupe court à la réflexivité. Avec l’idée de philosophie non-standard, il semble qu’on soit passé de la phase de symptômatisation à celle de développement de nouveaux usages.
FL : J’ai d’abord développé la non-philosophie de manière axiomatique, qui est comme vous le suggérez un modèle anti-herméneutique. L’axiome force la pensée – la question de ce qui force la pensée est très importante chez Deleuze, et aussi pour Derrida ou Lacan. Maintenant, mon modèle est quantique mais simplifié et qualitatif : on est dans la conceptualité, ce n’est plus l’axiome mais la superposition et la non-commutativité. Il faut d’abord poser un état indéterminé constitué de potentialités ou de virtualités. Après sélection par un système de disjonctions et de fentes, on arrive à la concrétisation d’une des potentialités ou à sa réalisation aléatoire.
AP : Là intervient l’importance de la dimension fictionnelle. Ouvrir la philosophie à de nouveaux usages, c’est la rendre capable d’inventer – d’inventer quelque chose à partir de sa pratique. Le thème de la fiction est présent depuis longtemps dans votre travail.
FL : Je m’intéresse beaucoup à la fiction comme vecteur de la vérité. Je parle depuis très longtemps de fiction, mais de manière plus récente, je parle de modélisation ou encore de posture fictionnante. Je cherche des manières de résister à l’appropriation par la suffisance philosophique qui, j’ai oublié de le préciser tellement pour moi c’est évident, déborde tout à fait ce que l’on entend par « la philosophie ».
AP : On en arrive au dernier jeu de questions concernant vos dernières réflexions consacrées à la question de la messianité et du messianisme. Il semblerait qu’après une période de critique formelle – qu’on pourrait dire désenchantée – vous êtes revenu à quelque chose, sinon à une confiance en la philosophie, du moins à une espérance.
FL : Une espérance, peut-être. Je n’ose pas dire une espérance-fiction ! Je ne suis plus chrétien depuis longtemps et encore moins ce qu’on pourrait appeler un croyant, à la rigueur un « penseur chrétien » me gêne moins car le christianisme et ses postures de résistance qui résonnent en moi, ont toujours constitué une sorte de milieu, un ensemble de variations à partir duquel j’ai été amené à construire ma pensée. En particulier, la question du messianisme est agissante depuis longtemps, un peu comme une sorte de musique, comme un leitmotiv. Le messianisme est la définition même de l’homme. Ce que j’ai appelé l’homme ordinaire, c’est l’homme dépouillé de ses attributs philosophiques, pour lequel, s’il lui reste quelque chose comme une essence, c’est bien la messianité. Tout homme est un événement christique avec son potentiel de renversements et de bouleversements.
AP : Vous savez que le thème du messianisme est très présent dans la philosophie contemporaine, en particulier chez Derrida. Comment vous positionneriez-vous par rapport au messianisme déconstructeur ?
FL : Chez Derrida, il me semble que la structure messianique, est très judaïque, on pourrait dire très abstraite. C’est un messianisme de la forme : quelque chose peut-il advenir ?
AP : La formule utilisée par J. Caputo lors du débat entre Derrida et Marion pour qualifier le messianisme derridien était : Quand viendras-tu ? Vous abordez ce thème dans Christo-fiction10
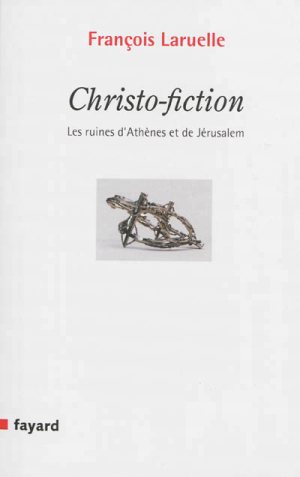
FL : Ma compréhension du messianisme est orientée vers l’invention et la découverte dans ce qu’elles ont de génériquement humain, pas seulement vers la venue de l’Autre homme. Nous sommes tous des Christs, ce messianisme n’est ni le vide de l’attente judaïque ni l’effectivité pleine ou la « présence réelle » du christianisme, c’est un messianisme pour lequel attente et espérance doivent accepter l’ignorance qui tisse l’aléatoire. Nous sommes sûrs, les humains, d’être la venue pour la première fois du messie tout en ignorant le jour et l’heure de cette priorité.
AP : Vous retrouvez presque le sérail de la métaphysique française, de Bergson en particulier.
FL : Je m’intéresse à un messianisme pour lequel la création est l’objet de l’attente et l’attente elle-même comme œuvre. La non-philosophie est devenue plus positive, comme la pensée de Nietzsche qui a dû passer par la phase très critique d’Humain trop humain, qui est vraiment une réduction totale de la philosophie par la physique et la physiologie, une attaque frontale contre la religion. On ne peut pas se passer d’actes philosophiques, fussent-ils « à la traîne ». L’essentiel est donc de mettre la philosophie « à l’œuvre » plutôt qu’ « en œuvre ».
- http://www.ccic-cerisy.asso.fr/laruelle14.html
- http://www.radicalphilosophy.com/article/axiomatic-heresy
- http://www.ccic-cerisy.asso.fr/laruelle14.html
- F. Laruelle, En tant qu’Un, p. 29.
- François Laruelle, Philosophie et non-philosophie, Mardaga, 1989
- François Laruelle, Le principe de minorité, Aubier, 1981
- François Laruelle, Une biographie de l’homme ordinaire. Des autorités et des minrorités, PUF, 1985
- « François Laruelle poursuit une des tentatives les plus intéressantes de la philosophie contemporaine : il évoque l’Un-Tout qu’il qualifie de « non-philosophique » et, bizarrement, de scientifique, sur lequel s’enracine la « décision philosophique ». Cet Un-Tout est proche de Spinoza. », G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, p. 43 ; « François Laruelle propose de la non-philosophie une compréhension comme « réel » (de) la science, au-delà de l’objet de connaissance (…). Mais on ne voit pas pourquoi ce réel de la science n’est pas aussi bien non-science. », ibid. p. 206.
- François Laruelle, Les philosophies de la différence, PUF, 1986
- François Laruelle, Christo-fiction, Fayard, 2014








