Dans sa préface expressément rédigée pour la version française de l’ouvrage 1 (d’ailleurs augmentée de plusieurs chapitres pour l’occasion), Donatella Di Cesare réclame que ce livre ne soit « jugé qu’après avoir été véritablement lu jusqu’à la fin. » Nous nous sommes pliés à cette exigence légitime ; ce même si l’auteur semble proposer elle-même des conclusions dès son introduction.
Nous avons même ajouté une exigence assez rare, à laquelle semble toutefois s’être astreinte Donatella Di Cesare elle-même, qui consiste à avoir lu les Cahiers noirs publiés jusqu’à la fin, en cherchant autant que possible de croiser cette lecture désormais indispensable avec celle des Traités impubliés (les tomes 65, 66, 67, 69, 70, 73 et 90 de la Gesamtausgabe). Ils ne semblent pas si nombreux que cela à s’être acquittés de cet indispensable effort, se pressant toutefois pour proposer leurs communications à des colloques. Di Cesare continue ensuite de poser ses conditions et prévient : elle souhaite ne pas recourir au manichéisme auquel Heidegger lui-même s’abandonne pourtant dans les années trente et quarante. Selon elle, les études heideggeriennes souffriraient des « positions binaires ». L’argument est bien connu, manié assez tôt par exemple par Derrida : il consiste à rejeter d’une part les interprétations apologétiques de Fédier ou Von Hermann, et celles critiques de Farias et Faye d’autre part. Il conviendra d’éprouver la légitimité et la pertinence de ce positionnement normand qui cherche toujours à sauver l’antisémitisme et l’archinazisme heideggerien en en relativisant la noirceur, en tâchant d’en célébrer encore le génie. Le souhait de sauvegarder les « apports » de Heidegger pour « la philosophie » tourne rapidement à l’injonction : « Celui qui philosophe supporte la complexité et habite le clair-obscur de la réflexion. » (p.7) De la même façon que Peter Trawny n’hésitait pas à recourir ces derniers mois à l’intimidation, Di Cesare suggère qui quiconque rejetterait la teneur et la visée de « la » « pensée » heideggerienne montrerait par-là qu’il n’est pas capable d’« endurance de la pensée » : genre d’argument soutenu par François Fédier. N’est-il pas possible d’entrer de plain-pied dans les complexes montages ontologico-historiaux de Martin Heidegger tout en maintenant sa vigilance critique, voire une défiance légitime ?
Cette préface annonce la couleur : Di Cesare souhaite suspendre ce recul salutaire qu’un Adorno ou un Faye pouvaient nous offrir : tout effort de déconstruction et de révélation de l’archi-nazisme est décrété simple « adieu à Heidegger » (ibid.), car la publication des Cahiers ferait « voler en éclats les schémas à travers lesquels Heidegger a été jusqu’alors interprété » : et pourquoi ne pas plutôt admettre qu’Emmanuel Faye avait une longueur d’avance en terme de discernement, lui qui dans son ouvrage de 2005 exposait déjà largement l’ampleur du désastre ? Non, surtout pas : il s’agirait plutôt se de mettre, une fois de plus, à l’écoute de « la voix de l’être. » Pourquoi pas. Il ne s’agit pas d’arrêter de lire Heidegger, plutôt de suspecter plus que jamais les visées cachées de ses écrits. Et Di Cesare, qu’elle le veuille ou non, apporte tout de même de l’eau au moulin de cette suspicion.
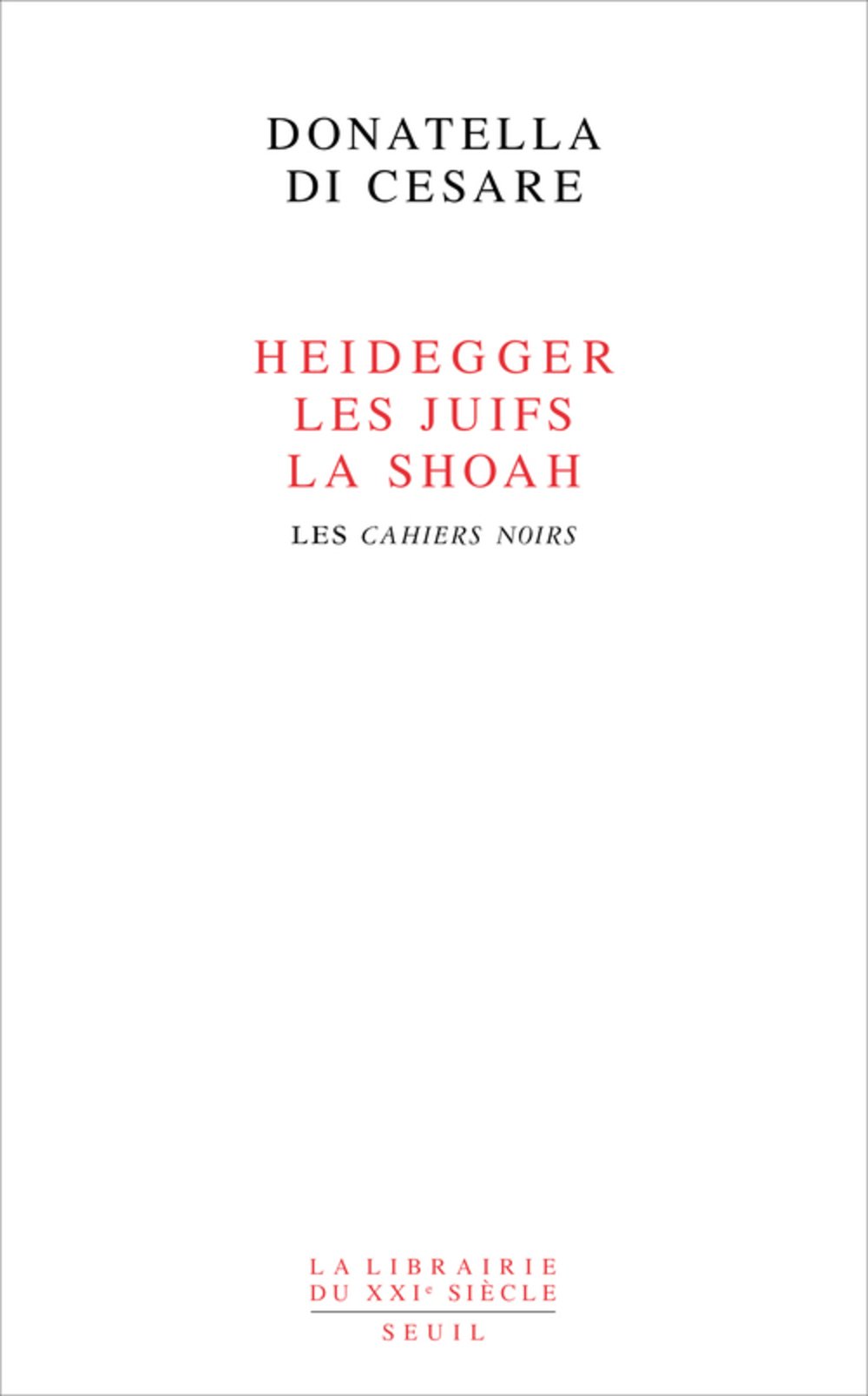
Chassez le naturel heideggerien, il revient au galop.
Donatella Di Cesare, qui a été vice-présidente de la Heidegger-Gesellschaft il y a encore peu de temps, peine visiblement à se départir de réflexes inculqués par la lecture de son maître, ce qui peut certes constituer un atout pour rentrer convenablement dans les méandres de ses spéculations, mais peut surtout rendre impossible un recul suffisant pour une démarche véritablement critique, même sans polémique. Le premier chapitre commence par une exergue de l’auteur dont Heidegger a dit à Beaufret qu’il constituait un « Fremdkörper » au sein de l’histoire de la philosophie : Spinoza. « Le repentir n’est pas une vertu ». Les millions de victimes du nazisme et Paul Celan apprécieront, qui n’auraient pas dû se croire en droit d’attendre quelque mot d’excuse de la part de celui qui, dans les années d’immédiate après-guerre, préférait de toute façon continuer de fulminer contre la conspiration mondiale de ceux animés par l’« esprit de vengeance » et le « pharisaïsme ».
À partir de là, Di Cesare s’en prend exactement sur le même mode que le Heidegger de 1945-49 aux « journalistes » et au « on », n’ayant pas l’air de saisir qui tirerait, aux yeux du penseur, les ficelles de ces manipulations médiatiques. Ce qu’elle a en ligne de mire, c’est l’effet médiatique entourant l’« affaire Heidegger », celui-là même qui permettra quelques ventes de son propre ouvrage dans les semaines à venir. Pourquoi ne pas plutôt se demander si celui qui flétrissait Das Man dès Sein und Zeit n’a pas cherché, sous couvert de la mépriser, à manipuler la « publicité » dont il se doutait qu’elle ne manquerait pas de diffuser durablement ses « pensées », afin qu’elles puissent abreuver les haines antisémites des siècles suivants ? Du reste, l’auteur s’adonne elle aussi pour le moins à un exercice « journalistique » couru, consistant à multiplier les rappels concernant cette fameuse « affaire Heidegger », généalogie dont nous pouvions facilement nous passer, soit parce que nous connaîtrions déjà bien les éléments du dossier, soit parce que Dominique Janicaud avait déjà en grande partie effectué cet effort. Il paraît franchement superflu ici, surtout parce qu’il est fort insuffisamment réévalué à la mesure de ce que nous trouvons désormais dans les Cahiers noirs. Cela aurait peut-être été utile, que de disqualifier une bonne fois pour toute certaines interprétations datées, obsolètes, voire franchement fausses et maintenant hors de propos. Mais Di Cesare commence ce qu’elle fera durablement dans son essai : proposer « pour rappel » des éléments qui n’apportent rien puisqu’ils ne sont pas vraiment analysés. Cette tendance deviendra plus grave, nous le verrons, lorsque des passages clés des Cahiers noirs seront tout bonnement survolés, ne permettant pas d’expliciter et de justifier suffisamment son emploi de l’expression « antisémitisme métaphysique ». Ainsi de cet extrait qui ne donne lieu qu’à quelques questions bien trop générales comme « quel rapport peut-il y avoir entre la Seinsfrage, la question par excellence de la philosophie, et la Judenfrage » ?
Voici l’extrait en question : « La question concernant le rôle du judaïsme mondial n’est pas une question raciale, mais plutôt la question métaphysique sur cette espèce d’humanité qui, étant absolument libre de tout lien, peut faire du déracinement de tout étant hors de l’être sa propre « tâche » dans l’histoire du monde. » Outre que la traduction euphémisante est sujette à caution, il apparaît surtout que ce passage ne sera pas étudié dans ce qu’il pourrait justement avoir de « métaphysique », alors même l’auteur entend bien souligner cette caractéristique de l’antisémitisme heideggerien. En l’occurrence, c’est en vain que le lecteur attendra l’analyse nécessaire de l’expression « absolument libre de tout lien », à laquelle il faudra bien faire un sort pour comprendre où Heidegger veut en venir. Malheureusement, l’auteur y reviendra à la page 116 de son ouvrage, recitant le passage, mais en ne l’expliquant toujours pas, se contentant de le remettre en perspective. Les lecteur attend désormais, et c’est légitime, un démantèlement complet de la métapolitique heideggerienne : cela passe entre autres par une analyse des divers schémas idéalistes que le penseur reconduit discrètement pour justifier son rejet du premier commencement judéo-chrétien et de son appendice qu’est la modernité.
« La »« pensée » antisémite de Heidegger serait une « philosophie ».
Contrairement à Emmanuel Faye dont elle tient – et elle fera ainsi pour de nombreux collègues – à reléguer les travaux précurseurs à l’arrière-plan, Di Cesare tient à faire du nazisme tel que l’entendait Heidegger une affaire de premier plan pour la philosophie (en cela, les collègues en question la suivent beaucoup moins). D’ailleurs, paradoxe : cela ne consacre-t-il pas la thèse soutenue par Faye d’une Introduction du nazisme dans la philosophie ? Et si Heidegger n’y arrive pas par lui-même, le voici ainsi secondé de quelques admirateurs de ses écrits qui comme notre auteur, souhaitent absolument faire de ses montages haineux une « question philosophique » (p.22) ce qui mettrait « directement en cause les philosophes et la philosophie » : rien de moins, Messieurs Jankélévitch, Cavaillès, Bergson, Cassirer, Semprun : vous voilà tous mis en cause par Donatella Di Cesare ! Ce n’est pas Heidegger qu’il faudrait en priorité soupçonner, mais toute la tradition philosophique occidentale ! N’y-a-t-il pas là un pâle décalque de ce que tentait l’interprété lui-même, lorsqu’il affirme par exemple que cela fait bien longtemps que la bombe atomique a explosé, « depuis Descartes » ? Dans quelle mesure la question du mal devrait mettre sur la sellette la philosophie entière, tout en intégrant cette « question » (qui est en réalité une accusation et un argument dilatoire) et « la » « pensée » à la philosophie elle-même ? Ce, alors même que Heidegger affirme très souvent, dans les Cahiers noirs et ailleurs, la nécessité de mettre fin à la philosophie ? Il la voit en effet inapte à la préparation du nouveau commencement, dont la transition n’est à ses yeux rendue possible que par la mission confiée par le destin au national-socialisme, lequel est voué à mener à ses ultimes extrémités supposées l’Occident enjuivé.
Di Cesare écrit : « Les Cahiers noirs ressemblent au journal de bord d’un naufrage qui travers la nuit du monde ; la lumière lointaine d’un nouveau commencement en est le guide. » (p.24) Il faudrait surtout se demander si plutôt que naufragé, Heidegger ne s’était pas constitué corsaire, cherchant plutôt à saborder activement le paquebot de la métaphysique occidentale, qu’il n’est visiblement pas le seul à vouloir arraisonner et couler en espérant que la noyade générale apporterait des lendemains qui chantent. Du reste, quelqu’un serait-il capable de nous dire de quoi il retournerait avec ce « nouveau commencement » ? C’est douteux ; ne reste en vérité que la transition, le passage tant désiré. Et celui-ci, nous le savons désormais, c’est le comble de la technique, à savoir : l’extermination des Juifs. Di Cesare ne voit pourtant dans les réticences de hideux moralistes face à une pensée justifiant les charniers qu’un « prétexte d’en finir une fois pour toutes avec Heidegger. » (p.27.) Cela dit, peut-être a-t-elle raison sur ce dernier point : nous n’en avons pas fini, d’exposer la faillite générale de « la » « pensée » et de ses admirateurs, souhaitant coûte que coûte « jeter leur regard dans l’abîme », selon le mot de Nietzsche. En espérant que l’abîme regarde en eux ? Quels en seraient les « apports » pour la philosophie ? « Se libérer de Heidegger signifierait également se débarrasser des questions difficiles qu’il a soulevées, revenir au paysage de la modernité éclairé par les Lumières, rasséréné par la fois dans le progrès, par la confiance illimitée dans le progrès » (p.28) : c’est en effet une bien sombre perspective qui est rappelée ici ! Préférons donc des montages historiaux délirants justifiant le pire des génocides, cela donne bien plus à penser. Et c’est bien cela l’essentiel, n’est-ce pas ? « Penser l’estre » ! Ou penser l’avènement de l’évènement qui fera rupture avec l’affreuse démocratie impérialiste. Au moins, en tout cas, pour la fameuse French et Italian theory de Derrida et Agamben, Schürmann et Vattimo, Nancy et Di Cesare, si desireuses de mêler concepts et radicalité politique. Question : comme Belhaj Kacem l’avait commencé avec son Après Badiou, y’a-t-il de même un droit d’inventaire de ces pensées post-modernes de la radicalité, souvent inspirées pêle-mêle de Benjamin et Taubes, Schmitt et Heidegger ?
Heidegger simple appendice de la philosophie occidentale, antisémite en son tréfonds
Remarquons quelques éléments intéressants de l’ouvrage de Donatella Di Cesare, qui n’est bon que lorsqu’il s’engage vraiment, ou fait mine de s’engager, plutôt que de se proposer comme le Saint Graal une position médiane entre les thuriféraires et les procureurs. Des passages comme celui-ci à la page 33 peuvent susciter notre admiration momentanée : « La tentative de découper l’oeuvre en morceaux et d’en légitimer un usage partiel est la façon aujourd’hui la plus en vogue pour apprivoiser Heidegger et en faire un usage phénoménologique inoffensif. » Ceci est très vrai, même si nous pourrions nous amuser des termes employés : « apprivoiser » le penseur qui a le plus tâché de séparer le Dasein de l’« animal rationnel », cela ne manque pas de sel. Quand à le rendre « inoffensif » : Di Cesare mesure-t-elle vraiment ce que pourrait donner le caractère pleinement « offensif » de « la » « pensée » dans les années à venir ? Se souvient-elle qu’elle est elle-même entourée de gardes du corps ? Ce caractère d’Angriff de la pensée heideggerienne est en tout cas bien saisi par diverses extrêmes-droites de l’Europe actuelle. S’agit-il de « rationaliser » cette violence ? Di Cesare se demande « à partir de quelle position extra-historique pourrait-on prononcer » une telle exclusion.
Rappelons tout d’abord que Heidegger lui-même n’hésite pas à manier, généralement pour fustiger, ce concept d’« anhistorique » ; d’autre part, il existe des fragments des Cahiers noirs où il se demande si le sens de l’histoire n’est pas la dilution dans la pure et simple « Wahnsinn », sorte de folie furieuse meurtrière dont on peut légitimement se demander si nous sommes tenus de l’apparenter à la raison, entendu que le terme ne désigne certes pas que la ratio calculante qui l’obsède, et grâce à laquelle les Juifs seraient censés exceller dans le calcul, si on le suit. De là, chacun déduit d’où pro-viendraient toutes les violences et le caractère « offensif »- non pas de « la » « pensée » en priorité – mais de toute philosophie : cette violence ne serait pas si exceptionnelle, aurait des antécédents.
Toute une seconde partie en effet, intitulée « philosophie et haine des juifs », court de la page 39 à la page 97, entend mener à bien un souhait intime formulé par de nombreux épigones, en particulier Jean-Luc Nancy, d’une dilution de l’antisémitisme spécifique de Martin Heidegger dans une tradition occidentale : l’opération commençait à vrai dire dès la page 16, où Di Cesare se hâtait de rappeler l’existence de l’antisémitisme de Frege (qu’elle met de façon anachronique en lien avec le nazisme alors que celui-ci envisage certes un « troisième Reich de la logique » -mais emploie cette expression en 1918, donc bien avant qu’Hitler ne se fasse connaître !) Elle continuera même à la page 119 de l’ouvrage, où Di Cesare rappellera des abus de Max Weber et Husserl bien connus (Derrida l’avait déjà fait) à propos des « nègres » et des Tziganes. Loin de nier l’existence navrante de tous les précédents douteux ou discriminants chez Kant, Hegel ou Nietzsche, nous ne pouvons que constater qu’il s’agit désormais d’un réflexe conditionné : voyez, Heidegger n’est pas le seul. François Rastier a déjà bien répondu à cet argument holiste : il y a loin de notations antisémites isolées, au soutien actif à un projet d’extermination… Du reste, dans les trois cas, cela amènerait beaucoup de discussions, même dans le dernier cas, chez l’auteur de L’Antéchrist. Un supposé « philosophe » a-t-il à ce point systématisé son antisémitisme, si bien qu’il constituerait l’aboutissement et la visée possible de sa pensée ? Cette hypothèse paraît certes peu acceptable pour ceux qui ont travaillé toute leur carrière sur la pensée de l’être ; partant, qu’ont-il à dire à ce sujet qu’ils souhaitent tant escamoter mais qui pourrait bien se trouver sous la plume de Heidegger : quel rapport entre la Seinsfrage et la Judenfrage ?
L’ouvrage de Di Cesare a le mérite de ne pas transiger sur la seule question qui compte après la publication des carnets, qui n’est pas tant celle de l’être – que celle de cet antisémitisme qui épouse la méditation de la différence ontologique. Nous n’y trouvons cependant guère d’éléments qui permettraient d’envisager ce problème à partir de la question du mal, qui aurait permis de nombreux approndissements et éclaircissements.
Une occasion manquée d’exposer l’inanité des élucubrations heideggeriennes
Le principal problème du présent essai, c’est qu’il s’adonne bien trop souvent à la simple paraphrase : ne faisons pas mine d’être étonnés, c’est quasiment une constante dans les dizaines de gloses qui sont publiées chaque année. Bien souvent le propos accompagne le « dict » heideggerien – et prend la « dictée. » On accorde ainsi à Heidegger les relais conceptuels qu’il recherche, sans le recul critique indispensable pour ne pas se laisser happer par les fictions mystificatrices et auto-mystificatrices qui ont pu être fabriquées après-guerre : ainsi de la fameuse « Kehre » ; comme tant d’autres, Di Cesare la prend encore au sérieux. Si « tournant » il y a dans la pensée heideggerienne du milieu des années trente, c’est uniquement lorsqu’il commence à décréter que le mouvement nazi pour lequel il a tant de tendresse serait lui-même « enjuivé ». Cela amène Di Cesare à ventriloquer Heidegger en affirmant que « l’horizon ultime des Cahiers noirs est donc la question de l’être » (p.99.) Il commence pourtant à devenir connu que l’horizon serait bien plutôt un changement d’époque déposant violemment le premier commencement judéo-chrétien, et n’hésitant pas, pour y arriver, à recourir à une nouvelle forme de manichéisme ontologico-historial incriminant les Juifs de tous les maux passés et présents. De plus, les lettres à Kurt Bauch changent la donne, notamment celle qui exhibe, comme un grotesque aveu, l’équation Seyn = Vaterland. Le seul enjeu qui motive Heidegger, c’est la domination de l’Allemagne – aux deux sens du génitif d’ailleurs : qu’elle se laisse dominer par la souveraineté de l’enjuivement initial, ou qu’elle doive se donner les moyens archi-nazis de relever « le défi de technique », autre mot-couvert auquel il faudra faire un sort.
Plutôt que d’affronter les méandres ésotériques des traités des années de guerre, Di Cesare s’adonne une fois de plus au « journalisme » des considérations biographiques, et comme à l’accoutumée, c’est la relation à Arendt qui est explicitée, pour de faibles gains spéculatifs (pp.102-111.) Ayant publié chez Klostermann, Di Cesare aurait pourtant tout loisir -entendre par-là : aucune limite en terme de droits de citations- pour multiplier les révélations de textes des Cahiers noirs permettant d’aiguiser notre compréhension de l’antisémitisme heideggerien. Plus tôt le public français sera familiarisé à ceux-ci, plus vite pourra se dissiper le mensonge stipulant que seuls quatorze passages explicites s’en prendraient aux Juifs. Mettons au crédit de l’auteur sa reconnaissance d’une dissémination et d’une dissimulation d’attaques haineuses sous de multiples termes, incomplètement rapportés à la page 113. « La représentation que Heidegger se fait du Juif doit être déchiffrée au sein de ce réseau spéculatif plus étendu » : nous pouvons contresigner cette affirmation qui donne du sens à de très nombreux passages qui sont sans cela incompréhensibles, surtout si nous cherchons à les relier entre eux. Les passages suivantes d’interprétation sont satisfaisants, car ils établissent plus clairement que les essais de Trawny le rôle négatif du judaïsme aux yeux de Heidegger : les juifs sont ceux qui incitent à ne s’affairer qu’au sein de l’étant, intensifiant alors l’oubli de l’être. Ceci vaut condamnation – et si on cesse d’euphémiser : appel à l’anéantissement contre ce qui fait barrage.
Di Cesare tient tellement à se montrer impartiale et objective qu’elle empile ensuite les citations calamiteuses où Heidegger accuse les Juifs et la modernité de mille maux, tout en décrétant que seule l’Allemagne pourra sauver l’Occident. Il serait pourtant temps de comprendre que par ce refus de juger, l’interprète se laisse encore docilement utiliser par Heidegger comme une « mule » permettant de transporter ses concepts explosifs voués aux génocides de demain. Le souhait de voir coûte que coûte de la philosophie dans ces longs appels au meurtre déguisés en méditation hespérique incite à se mettre à l’écoute de ces Diktats qui n’appellent au fond aucun commentaire, juste cette paraphrase à laquelle se consacre passsionément Di Cesare.
Polémologie et exclusion
À l’importante page 121 de Heidegger, les Juifs, la Shoah, Donatella Di Cesare entend proposer une analyse qui, si elle est éminemment discutable, a au moins le mérite d’être intéressante. Elle y affirme que plutôt que de recourir au paradigme, très travaillé par Agamben, de l’exclusion (ou sacerisation), Martin Heidegger se proposerait plutôt une vision gigantomachique du rapport au judaïsme, une course en vue de la souveraineté mondiale s’engageant entre le nazisme qu’il appelle de ses voeux et les tenants du premier commencement métaphysique. Nous n’avons pas ici l’espace pour contribuer comme il le faudrait à cette question passionnante ; contentons-nous de suggérer qu’il nous semble au contraire que les deux modèles peuvent tout à fait coexister dans sa topologie délirante de l’être. Mais ce motif polémologique a ceci d’intéressant qu’il consacre l’hypothèse déjà proposée par un précurseur déjà cité, Belhaj Kacem, qui estimait à la lecture des Beiträge (par le filtre de Schürmann), que c’est le motif de l’élection et une mimétologie inavouable à l’endroit du peuple du Père, qui motiverait la méditation heideggerienne.
Nous ne savons malheureusement que trop que des considérations hâtives sur sa proximité avec le monde juif peuvent alors être tentées, comme ce fut le cas l’année dernière lors du colloque à la BNF. La question du rapport de Heidegger au judaïsme, qui comme cela avait déjà été entrevu, doit nous laisser circonspect, tant il repose avant tout sur une forme exceptionnelle de forclusion. Di Cesare repère bien que le Juif figure pour lui la fin, et l’Allemand le commencement à venir ; reste à savoir comment il cherche à justifier cela, et c’est plus ou moins bien rapporté, la faute à un manque d’attention aux problématiques du mal et de l’insurrection (Aufstand), indissociables du rôle qu’il fait jouer à la subjectivité et au subjectivisme dans l’histoire de l’être. De même, l’auteur voit bien que pour le « penseur », rien ne serait pire que la perpétuation de cette fin sans fin de l’histoire – celle du premier commencement. Mais jamais elle ne rentre dans le détail, lisible par exemple dans le premier tome du Nietzsche, permettant de comprendre en quoi il est fatal qu’il y ait un « éternel retour » de la « volonté de volonté. » Autrement dit, Di Cesare ne fait que rapporter ce qui est écrit dans les Cahiers noirs, sans mettre les fragments en lien avec ce qui était déjà connu de Heidegger, et passait pour de la « philosophie » en un sens tout à fait académique. Il s’agit pourtant plus que jamais de désamorcer ce caractère systématique, ou en tout cas relativement cohérent de cette pensée de l’« ajointement » prenant en chasse tout ce qui est décrété « désajointé. » Les pages sur les diatribes à l’endroit de l’« intellectualisme » (pp.128-136) auraient elles-aussi gagné à thématiser plus profondément les motifs redondants qui poussent Heidegger, dès les années vingt, à exhiber des formes d’anti-intellectualisme qu’Adorno et Benjamin avaient très vite repéré, le premier y voyant par excellence un leitmotiv des personnalités autoritaires.
Ces pages d’interprétations sont toutefois de bonne facture : elles font partie de celles qui permettent de ne guère se faire d’illusion sur le rapport que cherchait à entretenir le penseur à « la philosophie », qu’il réduisait bien souvent à cet intellectualisme honni car jugé dépassé. Di Cesare, plutôt que d’en tirer les conséquences qui s’imposent, préfère ressortir les interprétations de Derrida sur le Geist les pages suivantes, là-aussi pour de faibles apports.
Souveraineté nouvelle de l’estre ou machination éternelle de l’étant
Son désir ardent de trouver une position médiane sauvant Heidegger la pousse à ratifier l’interprétation la plus commode concernant l’important terme Machenschaft : de la même façon que les orthodoxes ou le biographe Guillaume Payen 2 elle entend privilégier l’abord superficiel n’y voyant qu’une affaire de technique et de fabrication, lors même que le terme signifie « manigance, magouille, machination. » Un texte des Beiträge lui donne certes raison, mais combien des Cahiers noirs lui donnent tort, suggérant qu’un complot international est ourdi « à l’abri » grâce aux positions acquises par la métaphysique au fil des siècles ?
Les analyses menées autour de la page 140 de l’essai de Di Cesare atteignent un niveau spéculatif qui commence à être suffisamment élevé pour envisager correctement les montages démentiels de la topologie heideggerienne. Reste que pour nous demeure en question de savoir si le judaïsme tel que l’envisage le penseur archinazi n’est qu’une simple machination (Machenschaft) de l’étant venant se greffer sur la « surpuissance du commencement » grec – de nombreux textes corroborent en effet cette version-, ou s’il n’en est pas de très nombreux autres également où Heidegger envisagerait une Herrschaft de l’initial judéo-chrétien lui-même. Ne cherche-t-il pas à capter la toute-puissance fantasmée du judaïsme, comme par exemple dans ce passage de Concepts fondamentaux où il envisage « ces dominations du monde sciemment planifiées pour des millénaires » où se joue « la volonté de puissance à son comble » ? Ce texte sera à rapprocher des considérations sur le prophétisme, mais semble surtout donner de l’eau au moulin à l’hypothèse de Belhaj Kacem envisagée plus haut, d’une mimétologie inavouable de la pensée heideggerienne. Di Cesare ne privilégie pas cette voie-là, mais son approche peut à bon droit être soutenue dans un débat, textes à l’appui : les lignes qui suivent sont parmi les plus originales et consistantes de son ouvrage. Gageons que chacun saura y voir un appel à la lecture renouvelée des textes permettant de trancher.
Dans tous les cas, l’hostilité au judaïsme n’est pas à remettre en cause : soit il s’agit d’une domination sur l’initial, soit d’une domination de l’initial, et il faut à chaque fois y mettre fin. Nous voilà en apparence bien loin des considérations raciales du régime nazi, mais il n’en est rien : ces approches « destinales » les recoupent tout à fait et se proposent le même objectif éliminationniste, voire négationniste, puisqu’il s’agit de se proposer une abominable tabula rasa d’un règne, qu’il soit initial ou secondaire ; comme chez Blanchot, seule la rupture radicale prévaut, et tout ce qui perdure et se durcit dans l’insurrection ne mérite que mépris. Di Cesare le note, Heidegger refuse les apparences d’un « antisémitisme tapageur » (p.148), et se propose sa propre version de la raison pour laquelle il faudrait éradiquer la juiverie et son influence.
Est-ce à dire qu’il faut mettre en accusation toute la philosophie parce qu’un supposé « philosophe » utilise les ressources spéculatives et conceptuelles de celle-ci pour justifier destinalement le génocide ? Gardons-nous bien de prendre son refus – simplement apparent- du concept de race pour une preuve de la grandeur de « la » « pensée ». Il est tout à fait possible de montrer qu’il donne ses lettres de noblesse à ce pseudo-concept en l’intégrant de façon détournée dans l’histoire de l’être.
Heidegger raciste malgré tout
Dans un petit chapitre intitulé « race et rang » (p.154), Di Cesare se demande : « Doit-on alors penser que le racisme est pour Heidegger métaphysique et que c’est là la raison pour laquelle il prend ses distances à propos du principe « racial » ? » « Métaphysique » n’est pas le mot : Heidegger accuse par ailleurs explicitement les Juifs d’avoir vécu « plus que quiconque de par le principe de la race », ce qui est très probablement la raison centrale de ses critiques à l’endroit du national-socialisme, qu’il voit comme la version ultime de l’enjuivement occidental -version cependant destinée, qui tel un boomerang historial est censé revenir dans la figure de la volonté de puissance qui l’a lancé en amont… Mais Di Cesare n’envisage pas vraiment cette hypothèse qui s’impose, et à la suite de Derrida, entreprend de se concentrer sur les textes où Heidegger critique le biologisme et place « race » entre guillemets : rien de nouveau sous le soleil, à cet égard. Pourquoi ne pas préférer se concentrer sur la nouveauté de l’absence de guillemets ? Après tout, chacun sait qu’il était ami intime avec Eugen Fischer, et surtout qu’il intégrait comme une « nécessité » (si ce n’est comme la nécessité par excellence – le boomerang) le « pensée raciale », destinée historialement. Certes, elle appartiendrait à l’histoire de la métaphysique, mais permettrait par son intensification la « transition » vers l’autre commencement. Là encore, l’auteur se contente de tracer à gros traits un lien énigmatique entre « race » et « subjectivité » (p.155) sans jamais étudier ce que signifie ce dernier terme sous la plume du professeur de Fribourg : elle consigne bien que pour Heidegger, la race n’est pas une affaire biologique mais métaphysique -autrement dit, son affaire- mais n’explicite jamais cette portée métaphysique. Ce manquement est central et pose vraiment problème.
Toutefois, saluons de bonnes prises en compte, comme lorsqu’elle affirme qu’ effectivement, « il ne met pas véritablement en question la « race » (p.156) en éloignant le concept du darwinisme pour l’amener dans les parages bien flous de la notion de « rang », par laquelle il rejoint sans difficulté les préoccupations hiérarchiques nazies. Il en est de même lorsqu’il intègre la question du « sang » à ses approches des tonalités affectives : Di Cesare voit bien que Heidegger ne critique pas tant le nazisme qu’il lui reproche de ne pas être à son écoute : « ils répondent au judaïsme sur le même plan, dans un élan qui reste donc vain » ; mais « Heidegger partage avec eux plus d’un mythe, en déplaçant l’argument sur le plan ontologique. Il ne s’agit pas là d’amoindrir la « question », mais au contraire de l’approfondir et de l’exacerber. » (p.159) Voilà qui est fort juste, mais n’appelle pas tant des conclusions que des éclaircissements plus en profondeur, pour ne plus se laisser mystifier par les montages heideggeriens et leurs allures « philosphiques » plus que douteuses. Nous ne faisons à la lecture de l’ouvrage de Di Cesare que découvrir en quoi consiste le rapport de la pensée de l’être à la race : les lignes rédigées n’apportent au fond que quelques jalons supplémentaires aux travaux de Jeffrey Barash et d’Emmanuel Faye.
Pousser l’ennemi à l’anéantissement : encore de la philosophie ?
Les deux parties suivantes portent sur le rapport du penseur de Messkirch à Husserl et à Jünger ; elles n’apportent pas non plus de grandes révélations pour qui a parcouru seul les Cahiers noirs et le tome 90 portant sur l’auteur du Travailleur. C’est la suivante, qui porte sur la relation conflictuelle à Carl Schmitt (pp.186-206), qui est plus importante dans l’économie de ce livre, puisqu’elle cherche à montrer que certains textes importants de Heidegger portant sur le Feind, l’ennemi, seraient surtout des réponses véhémentes aux propositions politiques du juriste, qu’il estimait insuffisantes. Il n’en demeure pas moins que l’ennemi en question demeure le Juif (Di Cesare l’admet page 208) pour les deux auteurs, malgré leur lutte pour le leadership spirituel du nazisme. Les pages consacrées à cette petite conflictualité sont intéressantes mais si elles ne portent que sur les modalités différentes d’antisémitisme, et les reproches que chaque enragé s’adressait vertement par cours et traités interposés. Il est toutefois dommage que l’auteur profite des apparences un peu moins défavorables pour Heidegger par rapport à Schmitt, pour réactiver des interprétations déridéennes sur le Polémos héraclitéen suggérant qu’il serait en quelque sorte plus raisonnable que le juriste, moins agressif. Cela l’amène (p.213) à citer un passage un passage clé du tome 96 des Cahiers noirs sans y apercevoir du tout le caractère stratégique. Heidegger consigne en effet dans son carnet : « Être-vainqueur ne signifie pas seulement sortir victorieux d’une bataille ; le vainqueur pourrait être également celui qui est perdant parce qu’il s’est consacré exclusivement à l’objectif et à la tactique de l’ennemi, et il le fera encore plus dans le futur. »
Di Cesare remarque tout de même que ce ne sont pas là les paroles d’un pacifiste. Mais elle ne s’appesantit pas sur cette dimension tactique : Heidegger laisse entendre que les victimes des massacres affermiraient encore davantage leur emprise sur leurs propres bourreaux ; du reste, il laisse entendre lui-même que si les Allemands perdent la seconde guerre mondiale, cela pourrait être fécond pour le futur, en vue du prochain combat. Ces considérations paranoïaques amènent certes l’interprète à thématiser le « complot juif mondial » au chapitre suivant, mais la traduction de « Weltjudentum » par « judaïsme mondial », proposée par Monod et Christ est sauvegardée sans nouvelles justifications, lors même que des Goebbels pouvaient vociférer ce terme en évoquant bien plutôt une « juiverie internationale », crapule planétaire vouée à l’extermination. Di Cesare voulant décidément gagner sur tous les tableaux, elle s’en prend pourtant à la tentative grotesque de Pascal David d’aborder Judentum de façon neutre, comme dans le cas de Christentum, sans aucune référence au contexte génocidaire de l’époque.
Suivent néanmoins des pages de bonne facture, car sans concession, sur le rapport déliré de Heidegger à ce complot mondial et invisible, abrité, contre lequel il entreprend de lutter avec les moyens de sa pensée de l’être, censée désabriter les fraudeurs déracinés. Le caractère par trop « descriptif » de nombreuses analyses est ici moins tangible, le propos étant corroboré par diverses suggestions d’interprétation satisfaisantes et mettant en perspective les thèses sur le bolchévisme ou l’américanisme, issus de la même « machination » juive mondiale.
Nous pouvons tout de même faire une pause pour nous étonner du caractère non-philosophique de tout ce baratin (Heidegger parlant même d’un « bolchévisme anglais »…), mais imperturbable, Di Cesare continue ses paraphrases : la narration de l’« estre » impose sa dictée à la chercheuse italienne qui s’interdit tout écart. La logorhée heideggerienne est pourtant effarante, comme dans le chapitre suivante où elle considère le Juif « im-monde », sans monde comme la pierre, le minéral, lui qui « pétrifie l’être. » Les motifs génocidaires s’enchaînent, mais l’auteur continue de voir en Heidegger un « philosophe. » Elle aperçoit pourtant que « la résonance ésotérique et l’aura mystique de Seinsgeschichtlich amortissent et atténuent la brutalité du geste discriminatoire » (p.240.) Ne devrait-on pas considérer au contraire qu’elle l’aggrave, lui conférant justement du prestige philosophique ? La professeur de La Sapienza préfère s’attarder une fois de plus sur un des réflexes post-moderne par excellence : à la suite de Lyotard ou Derrida, déplorer que Heidegger « rechute dans la métaphysique » (p.243), laquelle est accusée de tous les maux. Il devrait pourtant paraître clair qu’il souhait détruire celle-ci, mais Di Cesare estime qu’il cherche à produire une « métaphysique du Juif » ; ne serait-il pas plus pertinent d’admettre qu’il cherche surtout à le raturer comme appartenant à un passé à anéantir ou à passer à l’auto-anéantissement ? Bien sûr, le Juif est ce qui empêche le passage à l’autre commencement – mais n’est-ce pas là la seule affaire de Heidegger ? Avait-il un autre objectif que son extermination ? L’auteur le présente comme quelqu’un qui s’intéresserait à la figure du Juif au même titre qu’un Taubes ou un Poliakov : il y a fort à parier qu’elle projette ce qu’elle espère sur Heidegger, qui n’en avait probablement cure, lui qui n’espérait guère que pousser les Juifs vers la disparition : le néant.
Peut-on appréhender « la » « pensée » avec Heidegger, contre Heidegger ?
La quatrième et dernière partie de l’ouvrage, intitulée Après Auschwitz, tente de faire le point sur les diverses auto-justifications, plus ou moins mystificatrices et déjà connues que Heidegger a proposé de 1945 à 1976. Mais c’est surtout la publication de l’essentiel tome 97 qui justifie la lecture de cette partie, car chacun peut y voir que la fameuse thèse du « silence de Heidegger » sur la Shoah a fait long feu. Les lecteurs non germanophones pourront découvrir des extraits ahurissants dans lesquels, loin de faire amende honorable, il aggrave encore son cas, persiflant d’ailleurs plus que jamais. Contre qui ou quoi ? Nous serions tentés de dire : contre le « monde » entier, mais il ne tenait guère cela pour un « monde » ; plus précisément, le monde journaliste de la publicité est la cible de sa passable acrimonie, lui qui se croit persécuté par le pharisaïsme des Alliés et des traîtres à l’Allemagne. Di Cesare préfère d’abord mettre en valeur les textes bien connus sur l’industrialisation de la mort, n’hésitant pas à affirmer qu’Adorno, dans la Dialectique négative, soutiendrait un argumentaire proche de celui de Heidegger dans les conférences de Brême de 1949. Nous avons ici l’exemple typique du genre de confusion que cherche à produire l’interprète, mêlant sans sourciller l’idéologue des bourreaux et la philosophie de la vie mutilée. Ce devrait être un prochain travail que de chercher au contraire à exposer la distance inconciliable entre Fribourg et Francfort, nous n’en avons pas l’espace ici.
Contentons-nous du paradoxe suivant : Di Cesare continue à chercher à « sauver » Heidegger pour la philosophie, et est pourtant prête à rédiger ceci par ailleurs : « Ce renvoi à la pensée est ambivalent : d’un côté, Heidegger peut faire comme s’il revendique une réflexion sur l’extermination, mais d’un autre, tout se passe comme si celui qui n’en suivait pas la trace se rendait incapable de saisir le phénomène dans sa profondeur. » (p.268.) Mais Di Cesare ne procède-t-elle pas exactement de la même manière lorsqu’elle décrète à la suite de Trawny et Nancy qu’il faut absolument sauvegarder la pensée heideggerienne au sein de la philosophie pour comprendre la Shoah ?
Si pour Heidegger « rien d’autre ne compte que l’aliénation du Dasein à l’égard de l’être » (ibid.), doit-il en être forcément de même pour nous ? Y-a-t-il ne serait-ce qu’un droit à bien prendre en compte ces positions archinazies tout en les congédiant ? Sera-on en permanence accusé de ne pas avoir compris « la » « pensée » si nous estimons qu’elle n’a plus grand chose à voir avec de la philosophie à proprement parler ? L’usine à concept et à spéculation qu’est la méditation de l’être empêche les philosophes de métiers de prendre le recul qui s’impose face à toutes ces justifications subreptices des « massacres ontologiques » (expression de l’auteur.) Si bien que Di Cesare, nous l’avons vu, semble avoir une herméneutique heideggerienne de Heidegger tout à fait problématique : cette rémanence semble d’autant plus suspecte lorsqu’elle affirme que « Si la question juive est métaphysique, la solution l’est aussi. » (p.269) Il faudrait bien s’entendre sur ce que signifie ce terme de métaphysique, en n’escamotant surtout pas le fait que le penseur allemand désire ardemment la liquider. Or, l’auteur n’affirme qu’à demi-mots que Heidegger souhaite pousser la métaphysique juive jusqu’à ses ultimes retranchements nazis pour précipiter sa ruine : cela n’est guère thématisé, et cela devrait être l’objet d’une autre livre.
Sont en revanche évoqués au passage les conditions heideggeriennes pour un négationnisme ontologique, l’anéantissement devant favoriser l’oubli de ce premier commencement qui n’a eu de cesse de se perpétuer. « Les métaphores innombrables, apparemment inoffensives, souvent formulées par les philosophes sont pris à la lettre dans la solution finale » (p.270) : ainsi de l’anéantissement, qu’il serait bien naïf de prendre comme Guillaume Payen pour un simple concept philosophique à l’heure de son émergence où avait lieu la Shoah par balles. Combien de chercheurs français, tels Christian Sommer qui se porte apparemment candidat, vont encore se constituer volontaires pour maintenir les euphémismes spéculatifs et ésotériques de la pensée meurtrière ? Et décréter par-là que « la » « pensée » n’aurait rien à voir avec les exactions épouvantables ? Les concepts sont-ils franchement des voiles pudiques ? Ils révèlent au contraire d’une part la grande désinvolture qui se donne de grands airs spéculatifs, et d’autre part l’éclatante hypocrisie à l’oeuvre dans cette pensée de l’« estre » et autour d’elle.
L’enseignante à Rome n’échappe pas à la tendance dilatoire : « En ce sens, comme l’a soutenu Lacoue-Labarthe, « dans l’Apocalypse d’Auschwitz ce n’est ni plus ni moins que l’Occident, en son essence, qui s’est révélé. ». Ceci pour citer juste après Sloterdijk, selon qui « il faut certes se garder d’un geste, trop souvent répété, qui décharge (…) les responsabilités des catastrophes éthico-poltiiques du vingtième siècle sur la « métaphysique occidentale » (p. 271.) En ce cas, qui a raison entre les deux, pour Di Cesare ? Plutôt Lacoue, apparemment, puisqu’elle entend bien révéler toute la compromission en profondeur de l’Occident chrétien avec ce qui ne paraît flagrant qu’avec la Shoah. Tout l’Occident ? Mais alors, un Primo Lévi, redevient-il un « oriental » ? (Di Cesare n’hésite pas à comparer sa vision de la mort dans les camps aux fameux et hideux passages sur « meurent-ils ? » prononcés en 1949 à Brême…) Qui excède cet Occident ? Derrida ? Di Cesare ? Pourquoi ânonner ou remettre le couvert, avec cet argument rebattu de l’école de Strasbourg ? Les Cahiers noirs devraient peut-être nous inciter à prendre nos distances avec les herméneutiques inspirées du suspect lui-même – entendu que nous n’aurions plus de honte à avoir à estimer que Heidegger s’était joué de nous en faisant éditer les Cahiers noirs en dernier. In cauda venenum : Lacoue-Labarthe aurait pu davantage s’en douter, et prendre plus précautionneusement ses distances avec les accusations générales de l’Occident.
Las. En 2016, toujours cette ritournelle heideggerienne – pour comprendre Heidegger lui-même. C’est dire l’inventivité à laquelle donne lieu l’attitude simplement épigonale, qui, telle la « volonté de volonté » supposée de la subjectivité dégénérée, finit par revenir éternellement. À la différence de taille que nous écrivons ceci sans y croire une seconde, à l’heure où il convient de se demander si Di Cesare ne prend pas quelque peu au sérieux par exemple l’accusation lancée par Heidegger à l’encontre de Marx, de ralentir l’accomplissement-dépassement de la séquence hégélienne de la métaphysique. À force de s’interdire tout jugement, les collusions de celui-ci avec les délires spéculatifs deviennent inévitables. Appliqués et scolaires, les paraphraseurs semblent avaliser ce qui les stupéfait tant, qu’ils n’arrivent même plus à se donner les ressources critiques qui s’imposent plus que jamais. Par la suite, Di Cesare ne fait ainsi que rejoindre la « répétition » opérée par Belhaj Kacem, qui avait déjà affirmé, après une lecture précoce des Beiträge, que le Juif fut anéanti parce qu’il « porte avec lui le vide désertique, le néant du nihilisme technique » (p.287) : il était à l’époque encore trop tôt pour imaginer que Heidegger hasarderait même l’hypothèse d’un auto-anéantissement de ceux portés à se consumer eux-mêmes.
Plutôt que de soutenir mordicus l’argumentaire révisionniste qui éclate aux yeux de tous (ceux qui savent lire l’allemand) dans le tome 97, il serait temps que les héritiers de la post-modernité cessent de prendre ombrage sitôt qu’on leur suggère que Schürmann ou Lacoue-Labarthe et Nancy se seraient laissés abuser en accordant bien trop à Heidegger.
Conclusion : un plaidoyer de plus en faveur d’une « philosophie » des charniers
Donatella Di Cesare a beau s’estimer intransigeante envers l’antisémitisme heideggerien, il n’en demeure pas moins qu’elle entend sauvegarder le caractère supposé philosophique de celui-ci, en l’inscrivant notamment dans toute la tradition occidentale. Descartes, Montaigne ou Spinoza sont donc embrigadés au même titre que Diderot ou Bergson dans ce procès, de déploiement subreptice d’un antisémitisme chrétien généralisé, aux effets tardifs meurtriers. Bref, elle ne fait que répéter l’interprétation déjà heideggerienne de Lacoue-Labarthe, la saupoudrant du goût de jour, les Cahiers noirs, lesquels appellent à notre sens, au contraire, une large remise en cause des positionnements de la post-modernité se plaçant dans le sillage du maître de Todtnauberg.
Par ailleurs, elle invitait à se garder tout sectarisme en matière d’interprétation et de tout manichéisme facile (seul Heidegger aurait ce droit, visiblement), alors pourquoi ne se réfère-t-elle à aucune des recherches d’Emmanuel Faye, Sidonie Kellerer ou François Rastier dont elle est redevable ? Par leur intransigeance, ils ont permis d’exhiber falsifications, euphémismes, stratégies diverses d’atténuation et d’auto-mystifications,qui auraient eu leur place dans ce travail. À moins qu’à mots couverts là-aussi, quelques emprunts plus ou moins discrets aient eu lieu, permettant de produire un livre-compilation voué à paraître complet sur la question (ce qu’il n’est pas, loin de là). Toutefois, admettons que ce caractère « compilateur » est rendu quasiment inévitable par la dissémination des textes-clés heideggeriens, noyés sous de banals éléments de cours ou d’apparents efforts phénoménologiques. Dommage toutefois que l’herméneutique déployée ne soit pas en mesure d’expliciter sur quoi repose la pensée du mal de Heidegger, entendu que celle de l’être n’est qu’une couverture. La faible intensité spéculative de l’essai est toutefois supplée par une propension à plaquer des considérations extrinsèques aux Cahiers noirs, comme des comparaisons plus ou moins légitimes avec des éléments d’eschatologie. Tentation bien compréhensible mais dont on peut interroger le succès.
Si nous devions recommander la lecture de cet essai, ce ne serait certes pas pour son originalité, dans la mesure où la position décrite ici est à peu de choses près la même que celles de Nancy et Trawny, et même de l’historien Payen, encore que Di Cesare ne recourt pas à l’euphémisme lorsqu’il est question d’anéantissement. Il faut plutôt lire ce livre pour avoir accès en français -non traduit par Fédier- d’extraits de textes accablants, et pour en avoir une première interprétation ; chacun peut aussi se renseigner sur les nouvelles façons de « sauver » le penseur du troisième Reich tout en admettant la criminalité de ses visées.,Comme le dit François Rastier, « la séquence dénégation, euphémisation, banalisation, réaffirmation est en train de s’accomplir sous nos yeux en répétant la progression mise en œuvre par Heidegger lui-même après la guerre. » Donatella Di Cesare, elle, se proposait dès sa préface un projet ambitieux, qui, s’il avait été mené à bien , eût été salutaire : « Sans adopter une attitude polémique, j’ai choisi plutôt que de les arrondir et les polir, d’aiguiser les angles de réflexion philosophique et historique » (p.7) Pas sûr que ce souhait ait trouvé un accomplissement. Encore un effort, philosophes fascinés par « la » « pensée » ! Plutôt que d’aiguiser involontairement les couteaux conceptuels et spéculatifs qui permettront d’égorger les Untermenschen de demain, pourquoi ne pas plutôt vous donner les moyens de vous départir de ces métapolitiques déguisées en philosophies, qui devraient vous paraître proprement ridicules dans leur sérieux-même, sitôt que vous aurez découvert leurs ressort fins ou grossiers ? Qui aura l’audace d’exposer une bonne fois pour toute le caractère nocif et superflu de « la » « pensée » métapolitique ? Après tout, puisque la post-modernité est censée avoir des ressources : pourrait-elle se passer de tous ces montages d’allure philosophique justifiant le génocide des Juifs d’Europe ?







