Dans son dernier livre, le sociologue américain brosse le portrait d’élites de plus en plus coupées du peuple et montre que cette rupture s’inscrit dans un déclin général de la démocratie.
Christopher Lasch, historien et sociologue de formation marxiste, proche à ses
débuts de l’école de Francfort, est l’auteur d’une oeuvre profondément originale, marquée par le courant du populisme américain.
Si son propos concerne les Etats-Unis d’Amérique, on verra qu’il peut aisément être étendu au monde occidental en général. Jean-Claude Michéa, dans ses différentes préfaces aux rééditions récentes de Lasch, a bien montré comment appliquer ces analyses à la situation française [Notamment dans « Pour en finir avec le XXIème siècle », préface à La culture du narcissisme, de Christopher Lasch, Flammarion-Champs, 2006. Voir [un compte-rendu du livre sur ce site[/efn_note]. Michéa, tenant d’un socialisme populiste, aux antipodes du mythe de la modernité défendue par la gauche « Libération-Inrockuptibles », montre l’autosatisfaction sans borne affichée par la gauche libérale. La confiance dans un progrès cumulatif de l’histoire empêche de voir les dérives et les échecs de ce projet. Il y a là une idole que Michéa, qui s’appuie sur Lasch, mais aussi sur George Orwell, s’emploie à déboulonner. Méprisante envers le passé en général, aveuglée par ce mythe du Progrès, la gauche sert désormais de paravent aux mesures économiques les plus dures ; autrement dit, le libéralisme culturel soutient et permet de faire passer plus en douceur le libéralisme économique.
C’est bien aux douloureuses contradictions du progressisme que s’attaque Christopher Lasch. La révolte des élites 1 est son dernier livre, achevé seulement quelques jours avant sa mort. En rejetant dans l’obscurantisme tout ce qui meurtrit la bonne image de l’homme et fait obstacle à ses désirs, le monde contemporain entretient l’homme dans une névrose infantile, dont la moindre illusion n’est pas d’ignorer le tragique de l’existence.
S’il mène une critique radicale des valeurs progressistes, Lasch ne se fait pas pour autantle porte-parole de récriminations nostalgiques. L’historien américain nous rappelle qu’une gauche qui n’est plus capable d’un retour critique sur elle-même vire simplement à l’idéologie et s’aveugle sur ses propres échecs.
L’arrière-plan du livre apparaît sinon religieux, du moins empreint d’une grande inquiétude quant au destin de l’homme contemporain, déculpabilisé et pris en charge par des institutions bienveillantes. Lasch décrit une société entièrement sécularisée, oublieuse de l’inquiétude fondamentale que portait la religion qui a inspiré la démocratie américaine. Je voudrais montrer que c’est un certain pharisaïsme laïc qui est la cible de La révolte des élites.
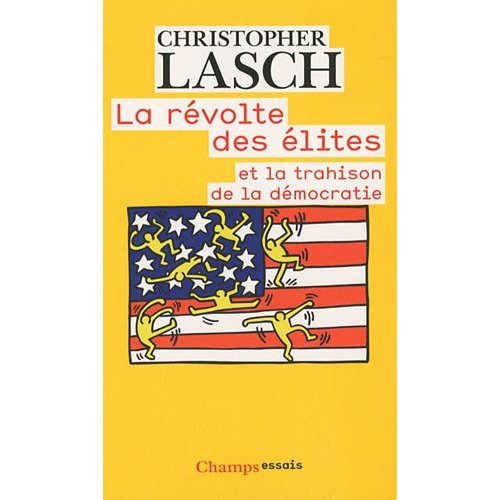
Malaise dans la démocratie
Le point de départ du livre est le constat d’un « malaise dans la démocratie », dont les différents chapitres vont détailler les origines et les conséquences. Lasch montre comment le déclin de la vie démocratique affecte l’ensemble de la culture américaine. La cause en est principalement une coupure de plus en plus prononcée entre le peuple et les élites. Cette coupure est aussi bien intellectuelle que matérielle : le développement des grandes propriétés de production, la croissance des grandes villes, la sectorisation accrue de l’économie, la mondialisation des échanges, tout ceci contribue à isoler les membres de cette nomenklature des citoyens ordinaires.
Lasch pointe une « révolte des élites », qui n’a fait que grandir depuis un siècle -révolte qui n’aboutit pas à une insurrection, puisqu’elle provient d’un petit groupe de privilégiés, mais à un repli sur soi, loin des gens ordinaires : « Naguère, c’était la « révolte des masses » qui était considérée comme la menace contre l’ordre social et la tradition civilisatrice de la culture occidentale. De nos jours, cependant, la menace principale semble provenir de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie sociale et non pas des masses » 2. Il n’y a pas en la matière à faire de distinction entre privé et public, entre grands administrateurs d’états et chefs d’entreprises, entre professeurs d’universités et directeurs de journaux. « Aujourd’hui, ce sont toutefois les élites – ceux qui contrôlent les flux internationaux d’argent et d’informations, qui président aux fondations philanthropiques et aux institutions d’enseignement supérieur, gèrent les instruments de la production culturelle et fixent ainsi les termes du débat public – qui ont perdu foi dans les valeurs de l’Occident, ou ce qu’il en reste » 3. L’organisation politique convient de moins en moins aux classes populaires, dont le mode de vie se trouve bouleversé par les changements qu’imposent en permanence une élite avide de changements et d’accroissement de ses profits. Ces élites ne voient plus tellement de raison de participer à une société démocratique : « Rien de ceci n’est de bon augure pour la démocratie, mais le pronostic devient encore plus sombre si nous considérons la détérioration du débat public. La démocratie demande un échange vigoureux d’idées et d’opinions. Comme la propriété, les idées doivent être distribuées aussi largement que possible. Pourtant, bon nombre des gens de bien, selon l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes, ont toujours été sceptiques quant à la capacité des citoyens ordinaires à saisir des problèmes complexes et à produire des jugements critiques. De leur point de vue, le débat démocratique ne dégénère que trop aisément en une foire d’empoigne où il est rare que la voix de la raison se fasse entendre » 4.
Signe de cette coupure, le développement des préjugés envers ceux qui sont hors de cette “caste”. La séparation culturelle est aussi géographique. Ainsi de l’opposition entre élites de la côte est des États-Unis et rednecks du Middle West : « Les Américains du milieu, dans l’idée que s’en font ceux qui fabriquent l’opinion cultivée, sont désespérément minables, ringards et provinciaux, ils sont peu au fait des évolutions du goût ou des modes intellectuelles, ils sont obnubilés par la littérature de gare, les romans d’amour ou d’action, et abrutis par une surdose de télévision » 5.
Déclin de l’idéal populiste
L’infatuation des plus privilégiés les amènent à présenter en modèle civique l’ascension sociale vers l’upper middle class : la démocratie devient dans les faits une méritocratie. Lasch montre que c’est là une trahison de l’idéal américain, une compréhension pervertie du sens de la démocratie : « Toutefois, ce qui nous occupe ici, c’est la nature de l’idéal proprement dit, sur laquelle on se méprend si facilement. Cet idéal n’était rien moins qu’une société sans classe, au sens où il ne s’agissait pas seulement de l’absence de privilège héréditaire et de distinctions de rang reconnues par la loi, mais de refus de tolérer la séparation du savoir et du travail. Le concept de classe laborieuse était inacceptable pour les Américains, parce qu’il ne sous-entendait pas seulement l’institutionnalisation du salariat mais l’abandon de ce qui, pour beaucoup d’entre eux, constituait la promesse centrale de la vie en Amérique : la démocratisation de l’intelligence » 6.
La division prononcée, puis l’opposition nette, entre “manuels” et “intellectuels” est un frein à la démocratie : les intellectuels tendent à ignorer les réalités matérielles auxquels sont confrontés la plupart des hommes ; et les “classes laborieuses” sont exclues du débat d’idées, considérées comme illégitimes pour y participer. Penser que l’ascension sociale est le but et le sens de la démocratie, c’est se faire de celle-ci une idée amoindrie. De plus, c’est croire que la vie sociale doit encourager l’égalité des chances ; or, c’est encore un préjugé de classe, puisque c’est simplement considérer que le peuple est un vivier où peuvent se renouveler les élites : « Historiquement, il est clair que le concept de mobilité sociale n’a été formulé que lorsqu’il est devenu impossible de nier l’existence d’une classe salariée dégradée, dont les membres étaient liés à vie à cette condition -autrement dit, lorsque la possibilité d’une société sans classes a été abandonnée de façon décisive […] De hauts degrés de mobilité ne sont en aucune façon incompatibles avec un système de stratification concentrant pouvoir et privilège entre les mains d’une élite dirigeante. De fait, la circulation des élites renforce le principe de hiérarchie, car elle fournit aux élites des talents neufs et légitime leur domination comme étant fonction du mérite plutôt que de la naissance » 7.
Moins rigide qu’une stricte aristocratie, la méritocratie reste une parodie de démocratie [Pour une critique plus proprement philosophique de la méritocratie, voir le livre d’Yves Michaud, Qu’est-ce que le mérite ?, Gallimard, 2011. Lire [le compte-rendu du livre sur ce site.[/efn_note] . Un tel régime ne devrait pas d’abord encourager le désir d’ascension sociale mais le développement des vertus indispensables au citoyen : autonomie, responsabilité, esprit d’initiative, entraide etc. Ce n’est que sur la décadence de ces valeurs que l’aspiration méritocratique peut croître :
« La sagesse conventionnelle, commune à la gauche aussi bien qu’à la droite, veut que nous vivions dans une société inters-dépendante, dans laquelle la vertu d’autonomie et de confiance en soi est devenue tout aussi anachronique que la production artisanale. La tradition populiste, telle que je la comprends du moins, s’en prenait à cette vision des choses. Le mot de passe populiste était indépendance et non pas inter-dépendance. Les populistes considéraient l’autonomie et la confiance en soi (qui bien sûr n’empêchaient pas la coopération dans la vie civique et économique) comme l’essence de la démocratie, une vertu qui n’a jamais cessé d’être requise » 8.
La préservation d’un ethos démocratique n’était possible que dans de petites communautés locales. La moralité commune, fondée sur l’effort et l’accomplissement, est aux antipodes de la valorisation victimaire :
« Dans l’idée que je m’en fais, le populisme souscrit sans équivoque au principe du respect. C’est entre autres pour cette raison que l’on doit préférer le populisme au communautarisme, trop prompt au compromis avec l’État providence et à adhérer à son idéologie de la compassion. Le populisme a toujours rejeté une politique fondée sur la déférence aussi bien que sur la pitié. Il est attaché à des manières simples et à un discours simple et direct. Les titres et autres symboles d’un rang social éminent ne l’impressionnent pas, pas plus que les revendications de supériorité morale formulées au nom des opprimés. […] Le populisme est la voix authentique de la démocratie. Il postule que les individus ont droit au respect tant qu’ils ne s’en montrent pas indignes, mais ils doivent assumer la responsabilité d’eux-mêmes et de leurs actes. Il est réticent à faire des exceptions, ou à suspendre son jugement, au motif que c’est la faute à la société. Le populisme est enclin aux jugements moraux, ce qui de nos jours semble en soi péjoratif, marque suffisante de l’affaiblissement de notre capacité à juger de manière discriminante par le climat moral de souci humanitaire » 9.
Le développement de la société industrielle de masse met à mal un tel cadre moral et civique. C’est la fin du populisme tel que le comprend Lasch :
« Ce qu’ils [les populistes] reprochaient à la production de masse et à la centralisation politique étaient qu’elles affaiblissaient l’esprit d’autonomie et la confiance en soi, et dissuadaient les gens d’assumer la responsabilité de leurs actions. Ce qui suggère que ces critiques sont plus convaincantes que jamais, c’est le culte de la victime et sa prédominance dans les campagnes récentes en faveur des réformes sociales. Par contraste, la force du mouvement pour les droits civiques, que l’on peut comprendre comme appartenant à la tradition populiste, c’est justement qu’il s’est toujours refusé à revendiquer une position morale privilégiée pour les victimes de l’oppression. Martin Luther King était un libéral dans sa théologie de l’évangile social, mais c’était un populiste quand il soutenait que les Noirs devaient assumer la responsabilité de leur vie et quand il faisait l’éloge des vertus petites-bourgeoises : travailler dur, rester sobre, cherche son progrès intérieur. Si le mouvement pour les droits civiques a été un triomphe pour la démocratie, c’est parce que sous la direction de King, un peuple rabaissé s’est métamorphosé en citoyens actifs, fiers d’eux-mêmes, qui, tout en défendant leurs droits constitutionnels, ont atteint une dignité nouvelle » 10.

Abaissement des exigences morales
Si l’égalité des citoyens peut avoir un sens, elle ne peut être seulement l’égalité formelle, déjà dénoncée en son temps par Marx. L’égalité devant la loi ne suffit pas. Il faut encore que soit conservée une certaine égalité matérielle, une uniformité des conditions de vie, base indispensable pour une communauté d’aspiration. La démocratie implique la participation de chacun : encore faut-il y être préparé : elle ne s’obtient pas sans que chaque citoyen se dévoue à un idéal de vie. La liberté en ce sens demande des efforts hors du commun, et elle les demande à chacun :
« L’égalité politique – la citoyenneté – met à égalité des gens qui autrement sont inégaux dans leurs capacités, et l’universalisation de la citoyenneté doit donc être accompagnée non seulement par une formation théorique dans les arts de la citoyenneté mais par des mesures conçues pour assurer la distribution la plus large de la responsabilité économique et politique, dont l’exercice est encore plus important qu’une formation théorique pour enseigner à bien juger, à parler de manière claire et convaincante, à avoir la capacité de décider et à être prêt à accepter les conséquences de nos actions. C’est en ce sens que la citoyenneté universelle implique tout un monde de héros. La démocratie a besoin d’un tel monde si la citoyenneté ne veut pas devenir une formalité vaine » 11.
Passant en revue les fausses valeurs contemporaines, ersatz des vertus originelles du populiste, le sociologue mène une attaque en règle contre la tolérance, qui serait, croit-on, à même de faire cohabiter des individus aux modes de vie très différents. La tolérance n’est en fait qu’une manière de s’accommoder, encore une fois, de l’échec d’une société unie. Sa valorisation s’inscrit dans un abaissement de nos exigences en matière morale (lowering expectations) :
« La démocratie demande aussi une éthique plus stimulante que la tolérance. La tolérance, c’est bien joli, mais ce n’est que le commencement de la démocratie, non sa destination. De nos jours, la démocratie est plus sérieusement menacée par l’indifférence que par l’intolérance ou la superstition […] Nous sommes résolus à respecter tout le monde, mais nous avons oublié que le respect doit se gagner. Le respect n’est pas synonyme de tolérance ou de prise en compte de “modes de vie ou communautés différents”. Il s’agit là d’une approche touristique de la morale. Le respect est ce que nous éprouvons en présence de réussites admirables, de caractères admirablement formés, de dons naturels mis à bon usage. Il implique l’exercice d’un jugement discriminant et non d’une acceptation indiscriminée » 12.
S’affichant comme ouvertes d’esprit, prête à accueillir toutes les différences, les classes dominantes mènent la chasse à l’intolérance, vice qu’elles attribuent bien sûr au peuple dans son ensemble : « Le problème de l’intolérance raciale est étroitement lié au fanatisme. Ici encore, il y a une bonne dose de complaisance et de pharisaïsme qui se mêlent dans la peur de l’intolérance. Les classes intellectuelles semblent souffrir de l’illusion qu’elles sont les seules à avoir triomphé des préjugés raciaux. Selon elles, le reste du pays demeure incorrigiblement raciste. […] Du point de vue des gens qui sont obsédés comme d’une idée fixe par le racisme et le fanatisme idéologique, la démocratie ne peut vouloir dire qu’une seule chose : la défense de ce qu’ils appellent la diversité culturelle. Mais il y a des questions bien plus importantes qui sont posées aux amis de la démocratie : la crise de la compétence ; la diffusion de l’apathie et d’un cynisme étouffant ; la paralysie morale de ceux qui mettent au-dessus de toutes les valeurs “l’ouverture d’esprit”» 13.
Décadence de l’école et de l’université
Christopher Lasch traque la décadence des exigences démocratiques dans le système d’enseignement. Sous couvert d’être plus libéral, plus ouvert à tous, il n’a cessé de se délester de sa mission de formation d’un citoyen libre et autonome. Gageons qu’un tel propos, qui concerne la société américaine, a des chances de rencontrer certains échos chez nous :
« L’Histoire s’est effacée devant une version infantilisée de la sociologie, conformément au principe erroné selon lequel le plus court chemin pour s’assurer l’attention de l’enfant est d’insister sur ce qui lui est le plus familier : sa famille ; son quartier ; les industries locales ; les technologies dont elles dépendent. Il serait plus sensé de supposer que les enfants ont besoin d’apprendre des choses sur des endroits lointains et des époques révolues avant de pouvoir trouver un sens à leur environnement immédiat. Puisque la plupart des enfants n’ont pas l’occasion de voyager au loin, et puisque dans notre monde le voyage n’ouvre guère l’esprit de toute façon, l’école peut fournir une solution de substitution -mais pas si elle s’accroche à la notion que la seule façon de “motiver” les enfants est de ne les exposer à rien qui ne soit déjà familier, rien qu’ils ne puissent immédiatement appliquer 14».
La méthode pédagogique nouvelle ne prétend pas seulement améliorer l’ancienne, mais de plus aider l’élève à se faire sans effort une bonne image de lui : « Les enfants ont besoin de risquer l’échec et la déception, de surmonter des obstacles et de venir à bout des terreurs qui les environnent en les affrontant. On ne peut pas recevoir une bonne opinion de soi ; on doit la gagner. La pratique thérapeutique et pédagogique actuelle, qui est toute « empathie » et « compréhension », espère fabriquer la bonne opinion de soi sans risque. Même des sorciers ne pourraient pratiquer un miracle médical de cette ampleur » 15.
Situés à l’autre bout de la chaîne de l’enseignement, les professeurs d’université ne sont pas épargnés par la critique de Lasch. Les spécialistes de littérature se complaisent bien souvent dans un relativisme du sens, coupant l’étude des textes de référence au monde réel. La littérature n’est alors plus qu’un jeu gratuit avec le langage.
« Kimball 16. dénonce le carriérisme qui sous-tend toute cette intellectualisation frivole sur l’indétermination du langage et le statut problématique de la vérité et du sujet. Apparemment indifférents au monde pratique et ordinaire tant ils tiennent à ce que le langage, l’art et même l’architecture ne renvoient qu’à eux-mêmes, ces nouveaux humanistes redeviennent très terre-à-terre quand il s’agit de leur propre progression sur l’échelle académique. Les études littéraires sont devenues auto-référentielles dans un sens dont se gardent bien de parler ceux qui insistent sur la dimension inéluctablement auto-référentielle du langage : leur fonction principale est de constituer des réputations universitaires, de remplir les pages des publications savantes et de soutenir l’entreprise des études littéraires 17 ». Lasch montre que, dans des cas extrêmes, certains intellectuels se plaisent même à douter de la réalité de l’existence, douteux privilège réservé à des gens qui ont oublié ce qu’était le travail réel, en confrontation avec le monde matériel.
Christopher Lasch ne se contente pas de mettre en lumière l’inconséquence de la critique sociale menée par des universitaires enfermés dans leurs abstractions : il en montre aussi l’origine, qui tient à une situation objective, celle de l’asservissement des universités à l’industrie capitaliste. Le propos retrouve un ton nettement marxiste : une division économique objective se traduit par une division dans les consciences et les discours : privés de moyens de s’intéresser au monde réel, les chercheurs se réfugient dans les abstractions. Leurs critiques du système en place prennent un tour dérisoire.
« Il ne fait pas de doute qu’ils aimeraient bien le croire, mais leurs activités ne sont pas une menace sérieuse pour le contrôle des universités par les grandes entreprises et c’est ce contrôle des grandes entreprises qui a corrompu notre enseignement supérieur, non le gauchisme universitaire. C’est ce contrôle du grand capital qui a détourné les ressources sociales pour les transférer des humanités vers la recherche militaire et technologique, qui a encouragé l’obsession de la quantification qui a détruit les sciences sociales, qui a substitué à la langue anglaise un jargon bureaucratique et créé un appareil administratif au sommet hypertrophié dont la vision éducative se résume au bilan comptable. L’un des effets de ce contrôle capitaliste et bureaucratique est de faire fuir les chercheurs capables de pensée critique des sciences sociales vers les humanités, où ils peuvent donner libre cours à leur goût pour la “théorie” sans la discipline rigoureuse de l’observation sociale empirique […] Une critique sociale qui s’occuperait des vrais problèmes de l’enseignement supérieur aujourd’hui -l’assimilation de l’université à l’ordre capitaliste et l’émergence d’une classe de la connaissance dont les activités “subversives” ne menacent sérieusement aucun intérêt établi – serait une nouveauté bienvenue dans le discours contemporain. Toutefois, pour des raisons évidentes, ce type de discours a peu de chances de se voir encouragé soit par le gauche universitaire soit par ses critiques droitiers » 18.
Le sociologue ne tombe pas dans le piège de l’illusion pédagogiste, si courante chez les enseignants -travers professionnel peut-être inévitable- illusion qui consiste à croire qu’une réforme morale et sociale doit commencer à l’école et que toute éducation, en fait, a lieu dans l’école. Dans ses autres ouvrages, l’auteur a déjà eu l’occasion de déplorer la perte de pouvoir de la famille face aux institutions politiques et bureaucratiques. Le monde adulte lui-même est touché, montre Lasch, par un déclin de l’aspiration démocratique, une perte des pratiques de citoyenneté qui assuraient, auparavant, le maintien d’une mentalité authentiquement populaire, transmise aux enfants en dehors du temps scolaire.
Lasch a de belles pages sur la perte des lieux intermédiaires de rencontres (les pubs, les salles de réunions), au profit de lieux fermés (clubs) et d’espaces privés : ainsi les centres commerciaux, peu propices aux discussions spontanées, où les associations et partis politiques ne peuvent plus distribuer de tracts etc. C’est le tissu social qui, matériellement, se prête de moins en moins aux rassemblements civiques. La ségrégation urbaine permet la ségrégation sociale, avec ses gated communities, ses immeubles sécurisés, ses quartiers isolés des lieux de rassemblements populaires. Le livre décrit un monde de plus en plus froid, fonctionnel et triste. Les différentes communautés (Noirs, Latinos, homosexuels etc.) se sont laissé prendre au piège de l’enfermement, en constituant des ghettos, bien loin de l’idéal des communautés de pionniers autonomes, qui ont été les piliers de la démocratie américaine. L’éclatement des valeurs communes produit non une société multicolore, un joyeux melting-pot, mais un mélange amorphe, où la tolérance sert de liant minimal entre des groupes d’individus qui ne veulent plus se parler.
Méfiants envers les autres, les membres de la communauté se réfugient dans une version fantasmée de leur identité et développent des revendications agressives, selon le modèle libéral actuel qui veut que toute frustration soit intolérable. Plus généralement, la société moderne, loin d’assurer l’épanouissement individuel et collectif, se construit plutôt sur l’effondrement de la personnalité. Lorsqu’elle promeut une vaste gamme de modes de vie alternatifs, transgressifs, qu’elle rompt les carcans moraux et prétend nous libérer de toute contrainte, elle fragilise la majorité des individus, qui n’ont pas tous envie de jouir sans entrave. Cette crise a des conséquences psychologiques profondes. A ce sujet, on peut lire La culture du narcissisme, du même auteur, qui propose un portrait saisissant de l’homme contemporain et de sa perte d’emprise sur son existence.
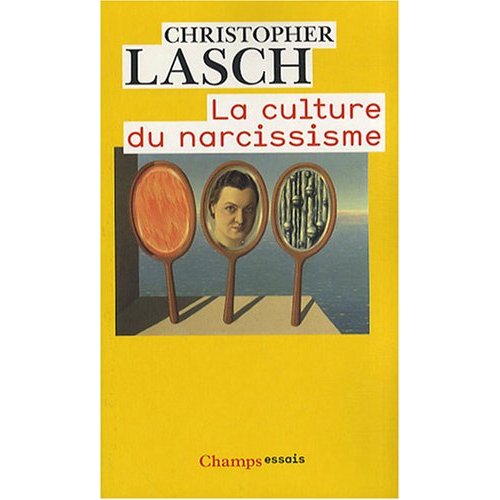
Perte du sens de la parole publique
Symptôme important de ce que Lasch nomme l’Âge du Toc, la perte du sens de la parole publique affecte la vie politique dans son ensemble. Que ce soit dans les débats entre candidats ou dans les colonnes des journaux, le style écrit l’emporte sur l’oralité. Contre l’idée récente qu’hommes politiques ou journalistes devraient être des experts et parler comme tels (en étant objectifs, bien informés, impartiaux), l’auteur rappelle que le débat se nourrit d’abord de controverses, bien plus utiles aux discussions que la recherche du consensus.
« Les débats Lincoln-Douglas ont été l’exemple du meilleur de la tradition orale. Selon les normes modernes, Lincoln et Douglas ont enfreint toutes les règles du discours politique. Ils ont soumis leurs auditoires (qui rassemblaient jusqu’à quinze mille personnes en une fois) à une analyse minutieuse de questions complexes. Ils ont parlé dans un style piquant, familier, parfois audacieux, et avec une candeur considérablement supérieure à celle que les politiciens jugent sage d’utiliser aujourd’hui. Ils ont pris des positions bien tranchées qu’il devait leur être difficile d’abandonner. Ils se sont conduits comme si les responsabilités politiques étaient porteuses de l’obligation de clarifier les problèmes au lieu simplement de celle de se faire élire » 19.
Gageons qu’il y a là de quoi éclairer la dernière campagne présidentielle française, jugée morose par beaucoup d’analystes eux-mêmes enclins à la morosité.
Le personnel politique est de plus en plus assujetti aux réquisits des journalistes. Ils doivent formater leur langage pour bien passer dans les interviews :
« Le contraste entre ces débats justement célèbres et les débats pour les élections présidentielles de nos jours, où ce sont les médias qui définissent les thèmes et déterminent les règles du jeu, est sans équivoque et très clairement à notre désavantage. Faire interroger des candidats à une charge politique par des journalistes -ce qui est devenu la formule obligée du débat – tend à grossir l’importance des journalistes et à réduire celle des candidats. Les journalistes posent des questions – prosaïques et prévisibles pour l’essentiel – et aiguillonnent les candidats pour qu’ils leur donnent des réponses rapides et spécifiques, se réservant le droit d’interrompre les candidats et de leur enlever la parole à chaque fois qu’ils paraissent s’écarter du thème imposé. Pour se préparer à cette épreuve, les candidats se fient à leurs conseillers qui leur farcissent le crâne de faits et de chiffres, de slogans faciles à retenir et de toute autre chose faisant passer l’impression d’une compétence très large et imperturbable. […] Le format du débat télévisé demande que tous les candidats se ressemblent : confiants, sereins et donc irréels » 20.
Divorce du savoir et de l’opinion
Lasch pointe un divorce profond entre l’opinion et la science. Les universitaires de la gauche radicale ont tendance à confondre les deux : tout savoir n’est qu’idéologie. A l’inverse, sous le règne des experts, la séparation des deux est complète : au public ignorant des avis peu informés ; aux connaisseurs la possession d’un savoir légitimant leur autorité. Or, la démocratie ne peut vivre que d’une confrontation permanente entre savoir et opinion. La démocratie suppose la diffusion de l’intelligence dans l’opinion, pas son accaparement par une classe de professionnels chargés de guider les gens au mieux de leurs intérêts. Le déclin de l’esprit de controverse s’explique par cette même séparation. Faute de ce jeu pour ainsi dire agonal, la démocratie reste lettre morte, le débat se met à ronronner entre experts de plateaux télé. N’est-ce pas aussi par esprit de controverse, pour clouer le bec à l’adversaire, que l’on en vient à s’informer vraiment ? Chaque citoyen devrait être capable de s’exprimer sur l’état des affaires publiques et de soutenir une polémique entre opinions rivales.
On retrouve là une autre conséquence de la division du travail manuel et intellectuel, où le second en vient à dominer socialement le premier. L’exercice oratoire finit par imiter les productions écrites du monde savant. Pour convaincre, pour avoir l’air de s’y connaître, il faut parler comme dans les livres : donner à sa parole l’autorité de la chose écrite. La parole perd en “naturel”, elle se professionnalise. Et l’oubli du pouvoir de l’oralité va de pair avec la désertion de l’espace public, agora où tout un chacun devrait pouvoir s’exprimer librement. Les lieux de discussion se compartimentent, ils sont de plus en plus délimités.
« Dans son zèle à informer le public, une bonne partie de la presse est devenue le canal tout trouvé qui est l’équivalent de cet insupportable courrier promotionnel qui encombre nos boîtes aux lettres. Comme la poste -encore une institution qui servait autrefois à élargir la sphère de la discussion interpersonnelle et à créer des “comités de correspondance” – elle distribue aujourd’hui une profusion d’information inutile, indigeste, dont personne ne veut, et qui pour la plus grande part va finir au panier sans qu’on l’ait lue. L’effet le plus important de cette obsession de l’information, à part la destruction d’arbres pour fabriquer du papier et le fardeau croissant que représente “la gestion des déchets”, est d’affaiblir l’autorité du mot. Quand on se sert des mots comme de simples instruments de propagande ou de promotion, ils perdent leur pouvoir de persuasion. Ils cessent bientôt d’avoir la moindre signification. Les gens perdent leur capacité à se servir du langage avec précision et de façon expressive, ou même à distinguer un mot d’avec un autre. Le mot parlé se modèle sur le mot écrit au lieu que ce soit l’inverse, et la parole ordinaire commence à ressembler au jargon ampoulé que nous trouvons dans les journaux 21».
La fin de la névrose infantile ?
La dernière partie du livre, intitulée « L’âme dans sa nuit obscure », est sans doute la plus passionnante, en ce qu’elle va au cœur du déclin de l’esprit américain et qu’elle livre peut-être la clef de l’oeuvre de Lasch. Le titre lui-même est surprenant, de la part d’un sociologue de formation marxiste, puisque la nuit obscure de l’âme est une référence directe à l’expérience mystique de dépossession de soi, étape centrale de la quête de Dieu. La fin du livre est ainsi comme le testament intellectuel de l’auteur : il nous y confie son inquiétude la plus profonde quant au présent, mais aussi ses espoirs.
Lasch engage une discussion critique sur les diverses pratiques thérapeutiques qui fleurissent depuis un siècle, au premier chef la psychanalyse. Ces pratiques ont la prétention de nous révéler la vérité sur notre intériorité et de nous aider à mieux vivre nos conflits, en nous débarrassant de tout sentiment de culpabilité. Nous sommes entrés dans l’âge de l’Etat-thérapeutique qui, avec ses cohortes d’experts en traitements de soi, prétendent faire le bonheur des gens. Ultimement, Lasch s’inquiète des effets de la psychanalyse, dont il a lui-même beaucoup usé dans son étude sur la personnalité narcissique. La fin de la honte est-elle une si bonne chose ? Suffit-il de faire taire la culpabilité pour acquérir une bonne image de soi ? Au fond, une croyance largement partagée voudrait que nous fussions sortis de l’enfance de l’humanité, quand l’homme vivait écrasé par la superstition religieuse.
Cette croyance à une guérison de nos malheurs existentiels par la médecine est pour Lasch l’illusion la plus accablante de notre époque, la meilleure preuve de la perte de contact avec la réalité d’une partie des élites. L’illusion religieuse a décliné, pour laisser place à une illusion tout aussi puissante, le scientisme psychologisant. Par un travail sur lui-même, l’homme serait au fond capable de connaître un état de plénitude assurée. L’homme serait devenu vraiment maître de lui-même et du monde. Il n’y a donc qu’à se laisser doucement guider pour y arriver. De là divers discours thérapeutiques sur le mal-être au travail, la pédagogie différenciée à l’école, les bienfaits de la culture élevée au rang de relève de la religion. Lasch pointe l’assoupissement moral de notre époque, son pharisaïsme profond, sa perte à la fois de sens moral et de sens du tragique de la vie -l’un n’allant pas sans l’autre pour l’auteur.
Face aux divers succédanés de spiritualité, face à la dégradation de la religiosité en idéologie thérapeutique, véritable panacée existentielle, Lasch demande qu’on choisisse, et qu’on choisisse avec fermeté, et même avec héroïsme : l’incroyance ou la religion. Ce pourquoi il loue un Freud ou un Weber pour leur position conséquente quant à la consolation religieuse : « Comme Freud, avec lequel il a beaucoup en commun, Weber dédaignait la consolation de la religion et ses ersatz laïcs, et il soulignait que l’intellectuel avait le devoir de “supporter le destin de son temps comme un homme”. De la même manière, Freud parlait d’un ton soucieux mais ferme : renonçons à ces enfantillages une fois pour toutes. Comparant la religion à une “névrose d’enfance”, Freud affirmait avec force que “l’être humain ne peut pas rester éternellement enfant”. Il ajoutait que “c’est déjà quelque chose de savoir qu’on en est réduit à sa propre force”, et il y a un certain héroïsme dans la détermination commune à Freud et Weber d’affronter sans broncher des réalités impossibles à changer, de leur point de vue, et de vivre sans illusions.
Ceux qui cherchaient quelque chose en quoi croire ne pouvaient guère trouver de bien grande consolation dans cette adhésion sans compromis à l’intégrité intellectuelle, selon l’expression de Max Weber. Ils avaient plus de chances d’être séduits par l’esthétisme d’un Oscar Wilde ou par la version spiritualisée de la psychanalyse produite par Carl-Gustav Jung » 22.
Cet humanitarisme émollient, suggère Lasch, est bien la preuve que nous ne sommes pas sortis de la névrose d’enfance, alors même que nous nous croyons supérieurs aux hommes des siècles passés.

L’espoir contre l’optimisme
Lasch a toujours montré une opposition ferme à la mentalité optimiste. Historiquement, l’optimisme est défendu par les mouvements progressistes et révolutionnaires qui attendaient de l’avenir une amélioration considérable, peut-être totale, de la condition humaine. A l’inverse, le pessimisme était l’humeur des romantiques et des réactionnaires, attachés à l’Ancien Régime, à la grandeur disparue de l’homme dans un monde moderne voué à la médiocrité.
Lasch, pour sa part, refuse tout net ces deux attitudes, qu’il tient pour également fausses. L’optimiste contemporain croit en avoir fini avec l’ancien aveuglement dans lequel la religion maintenait l’homme :
« Nous pourrions dire que le désillusionnement est la forme caractéristique de l’orgueil moderne, et cet orgueil ne se donne pas moins à voir dans le mythe nostalgique du passé que dans la version plus agressivement triomphante du progrès culturel qui écarte le passé sans regrets. En surface, la nostalgie a une attitude aimante dans sa recréation du passé, mais elle ne l’évoque que pour l’enterrer tout vivant. En commun avec la croyance au progrès, à laquelle son opposition n’est que de surface, elle partage l’ardeur à annoncer que le passé est mort et à nier que l’histoire ait une emprise sur le présent. Ceux qui pleurent la mort du passé et ceux qui la célèbrent partent les uns comme les autres de l’assurance que notre époque est sortie de l’enfance […] Les uns comme les autres sont régis dans leur attitude envers le passé par le préjugé dominant qui refuse de croire aux fantômes » 23.
Adulte est celui qui croit aux fantômes, c’est à dire au poids de l’histoire et de l’héritage, tandis que l’enfant est dans un présent immédiat, insouciant de ce qui a pu se produire avant. La société thérapeutique, en prétendant offrir une maîtrise toujours accrue sur la vie humaine, nous procure une illusion qui a bel et bien de l’avenir…
« La victime la plus important de cette tournure de pensée est peut-être la compréhension correcte de la religion. Dans les commentaires sur la situation spirituelle moderne, on traite constamment la religion comme source d’assurance intellectuelle et émotionnelle et non pas comme une contestation de la complaisance et de l’orgueil. Ses enseignements éthiques sont lus de façon erronée comme un ensemble de commandements simples qui ne laissent aucune place à l’ambiguïté ou au doute » 24.
Lasch renverse l’opinion moderne qui prévaut en général quant à la religion : elle ne serait qu’un système de défense contre les humiliations infligées par la vie. Les gens croyaient en un autre monde parce que celui-ci était trop cruel pour les satisfaire… Lasch prend le contrepied de cette opinion, en soulignant le confort intellectuel de notre époque, et nous rappelle que la foi religieuse a d’abord pour ennemi le pharisaïsme. La foi suppose le doute, l’inquiétude, la remise en question des certitudes sur la place de l’homme dans le monde. Tout le contraire de l’attitude contemporaine, qui prend l’homme pour but et sens du monde, et considère comme intolérable dans l’absolu tout mal venant nous accabler. Comme si le monde était fait pour notre bien-être, attitude que l’on peut, en suivant l’esprit du livre, qualifier de pharisaïsme laïc :
« Incapables de concevoir un Dieu qui ne considère pas le bonheur des hommes comme l’alpha et l’oméga de la création, ils ne peuvent accepter le paradoxe qui est au centre de la foi religieuse : le secret du bonheur consiste à abdiquer le droit d’être heureux » 25.
C’est pour nous rappeler que l’homme n’obtient rien qu’il n’ait voulu et conquis que Lasch nous rappelle à cette nuit obscure constitutive de toute âme vivante. Seul le pharisien se sent en permanence satisfait de sa condition ; il pense qu’il y a convergence entre les désirs humains et les fins de Dieu. L’ennemi du chrétien sincère n’est pas le mécréant mais le pharisien -il fallait peut-être un auteur marxiste et populiste pour nous le rappeler. Ce dont nous avons besoin pour affronter avec force et courage l’existence, ce n’est pas d’optimisme -qui n’est que le miroir inversé de la nostalgie, mais d’espoir -en tant que l’espoir est cette force indispensable pour affronter les limites tragiques de notre condition.
On pourrait adresse une objection à l’auteur : tant l’optimisme que l’espérance sont des attitudes de déni de réalité : si l’optimiste se fait des illusions sur le présent et le passé, celui qui affiche son espoir semble naïf -là où la lucidité devrait le mener au cynisme, à la résignation face au caractère repoussant de l’existence. Lasch répondrait certainement que les illusions optimistes nous confortent dans notre vanité, là où la foi et l’espoir sont des vertus qui mènent à se battre et « y croire », malgré tout.
On le voit, sur l’idéal de liberté et sa perversion, sur les valeurs démocratiques et leur déclin, Christopher Lasch a dit l’essentiel. Contre les plaisirs de l’autosatisfaction, le grand sociologue américain nous propose plutôt un bonheur ordinaire, celui d’une pensée sans concession face à l’abaissement des exigences humaines.
- Christopher Lasch, La révolte des élites et la trahison de la démocratie, 1994 ; Flammarion-Champs, 2010.
- Page 37.
- Page 37.
- Page 22.
- Page 41.
- Page 74.
- Page 86.
- Pages 92
- Page 114.
- Pages 92-93.
- Page 97.
- Page 98.
- Pages 98 et 100.
- Page 166.
- Page 210.
- cf. Tenured Radicals : How Politics Has Corrupted Higher Education de Roger Kimball, New-York, 1990. Dans la bibliographie de son livre, C. Lasch note : «Polémique utile, mais partiale, contre la gauche universitaire, s’appuyant sur une défense du “fondationnalisme”»
- Page 188.
- Page 197.
- Pages 170.
- Pages 170-171.
- Page 180.
- Page 238.
- Pages 244
- Pages 245.
- Page 248.








