Le collectif que Christiane Chauviré a dirigé autour du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, édité chez Vrin en 20091 peut surprendre à plus d’un titre. Réunissant huit auteurs, il ne propose pas tant une lecture du Tractatus qu’il ne thématise certains problèmes très circonscrits de l’œuvre de Wittgenstein, en s’appuyant sur l’ensemble des interprétations déjà existantes. De ce fait, loin de constituer une lecture de la première œuvre de Wittgenstein, il se présente bien plutôt comme une contribution savante aux problématiques herméneutiques inhérentes à l’œuvre de Wittgenstein, ce qui rend plus qu’intrigant le choix du titre retenu. Alors que le lecteur s’attend à lire des éclairages sur tel ou tel point obscur du Traité, ce sont bien souvent de très longs détours par la littérature secondaire qui émaillent ce collectif, et qui, s’ils ne sont pas toujours inutiles, peuvent décevoir l’attente suscitée par le titre. Qu’il soit question essentiellement d’herméneutique de l’œuvre de Wittgenstein, cela se comprend dès le premier article, puisque Christiane Chauviré pose d’emblée trois façons de lire le Tractatus :
– Une lecture métonymique, qui expliquerait le tout à partir d’une partie jugée éclairante.
– Une lecture historique, comme celle de Mme Anscombe, repérant les sources, et tendant vers l’érudition, et qui se retrouve chez Pears, McGuiness, Diamond, etc.
– Une lecture rétrospective qui, à partir des Recherches philosophiques essaye de comprendre le Tractatus ; Hacker et Baker, ou même Bouveresse illustrent cette dernière tendance.
D’emblée, nous sommes donc plongés au cœur des débats herméneutiques, et c’est donc moins à une lecture proprement dite que nous convie ce collectif qu’à une sorte de débats portant sur l’interprétation qu’il conviendrait de donner à tel ou tel paragraphe du Traité.
A : La question des concepts formels
Un des points les plus éclairants du collectif porte sur la notion de « concept formel », à laquelle Ludovic Soutif consacre le premier article, intitulé « Variété et concepts formels. Sur le statut de certains concept généraux dans le Tractatus ». L’idée générale qui y est défendue est limpide : si l’on utilise les concepts formels comme s’ils étaient de vrais concepts, alors on sombre dans le non-sens. Toute la question est alors de comprendre à quoi correspondent les concepts formels, et de pouvoir en fournir une définition satisfaisante. Quelle définition propose Ludovic Soutif ? « Notre hypothèse de lecture est que la possibilité d’une extension de la notion de concept formel à des concepts tels que ceux de monde, d’expérience ou de champ (espace) visuel cache mal une asymétrie entre deux sortes de concepts formels : ceux dont le rapport de subsomption ne peut être exprimé au moyen d’une fonction parce qu’ils correspondent à un type logique (couleur, objet, nombre, et dans une certaine mesure, espace) et ceux dont le rapport de subsomption ne peut être exprimé parce qu’ils désignent (improprement) une totalité unique d’éléments appartenant à eux-mêmes à des types logiques et ontologiques distincts ; bref, l’ensemble d’une variété plutôt que l’une de ses dimensions. »2
Pour étayer son propos, L. Soutif va diriger son attention vers les œuvres de Frege et Russell, et ce sera l’occasion de montrer que Wittgenstein répond à un problème spécifiquement frégéen, à savoir celui de la naissance de pseudo-propositions à partir des concepts formels. Frege constate en effet que dès que nous cherchons à exprimer dans le langage la nature prédicative d’une fonction, nous sommes conduits à la dénaturer en la faisant apparaître comme un objet, comme une entité saturée : si je prends par exemple le cheval, et si je dis que le concept cheval est un concept, alors le fait même de dire « le concept cheval » comme sujet grammatical entre en contradiction avec la nature prédicative du concept. « En d’autres termes, commente L. Soutif, pour Frege, le fait qu’un concept soit un concept, qu’un concept particulier comme le concept cheval ou le concept nombre premier tombe sous la catégorie concept et, de même, le fait qu’une fonction particulière tombe sous la catégorie fonction est quelque chose qui ne peut être exprimé dans la langue naturelle. »3 Voilà le problème initial de Frege que L. Soutif exprime on ne peut plus clairement.
Quel usage Wittgenstein va-t-il alors faire de ce problème légué par Frege ? Wittgenstein reprendra l’idée que nous ne pouvons pas exprimer dans la langue naturelle ce qui tombe sous un concept formel comme son objet. Le non-sens apparaît quand on se sert d’une expression prédicative pour indiquer la catégorie logique : si nous analysons ce qui vient d’être dit, nous voyons que Wittgenstein va plus loin que Frege – telle est en tout cas la thèse de L. Soutif – puisqu’il l’étend à toute catégorie logique. Un concept formel peut alors être compris comme ceci : je ne peux pas imaginer que l’objet tombant sous le concept ne tombe pas sous le concept. Je ne peux pas imaginer qu’une tache soit dénuée de couleur, mais je peux imaginer qu’elle n’ait pas telle couleur. Idem pour un objet : il doit occuper une place dans l’espace. Donc la couleur pour la tache, l’espace pour l’objet, ne sont pas des concepts véritables, ils sont seulement formels, c’est-à-dire qu’ils sont ce sans quoi je ne pourrais pas penser l’objet.
Quelle est alors la menace qui se présente et que l’on devine avant même que L. Soutif ne la soulève ? C’est celle de la nature conceptuelle du monde ; le monde n’est-il qu’un concept formel ? Ne pouvons-nous penser tout objet qu’en présupposant le monde ? Voilà le problème auquel nous sommes confrontés. Dans la mesure où il n’existe aucun point de vue extérieur au monde, le monde semble être un concept formel. Ainsi, « le concept formel de monde n’exprime pas une forme logique spécifique par distinction d’avec d’autres (ou un type syntaxique spécifique par opposition à d’autres) mais bien la forme logique unique commune aux faits propositionnels et à ce qu’ils représentent et que cela ne peut être exprimé dans l’idéographie par l’emploi d’une variable assortie de règles spécifiques d’obtention de ses valeurs. »4 Ce que cherche donc à montrer L. Soutif, c’est que la possibilité même d’une transposition de tous les faits dans les propositions tient à la nature formelle du monde : c’est parce que les faits et les propositions ont les mêmes formes que le sens est finalement possible.
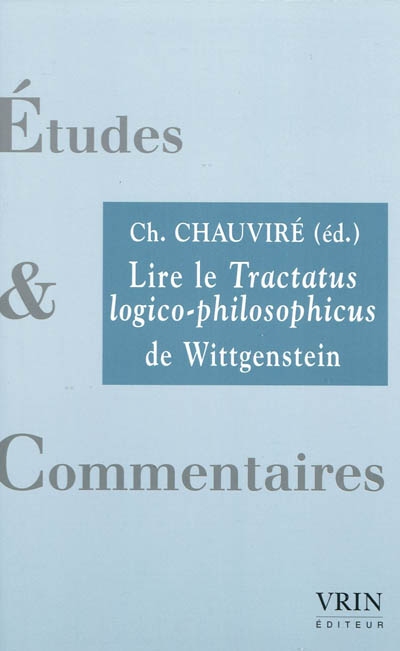
L. Soutif n’est pas le seul à aborder la question des concepts formels ; Jacques Bouveresse s’empare également de la question, pour montrer que c’est là peut-être ce qui est le plus clivant entre Frege et Wittgenstein ; Frege ne distingue pas, contrairement à Wittgenstein, les concepts formels des concepts matériels, c’est-à-dire qu’il ne distingue pas les propriétés absolument indétachables de l’objet de celles qui le sont ; une propriété interne, dira Wittgenstein, c’est une propriété sans laquelle on ne saurait penser l’objet. Ce que voit donc Wittgenstein, et que ne voit pas Frege, c’est ceci : les concepts formels ne peuvent être représentés par des fonctions, puisque les caractères qui les constituent sont des propriétés formelles ne pouvant être exprimées par des fonctions. Un concept formel ne peut être exprimé que par une variable. « L’univers frégéen des objets, poursuit Bouveresse, est un univers complètement homogène. Il ne comporte ni stratification dans le sens vertical ni compartimentation dans le sens horizontal. »5
B : Wittgenstein en dialogue 1 : Russell
Ainsi que nous venons de le voir, notamment par rapport à Frege, ce collectif cherche à aborder le rapport de Wittgenstein à ses prédécesseurs, c’est-à-dire ceux avec lesquels il est en perpétuel dialogue. Nous venons de voir comment l’élaboration de concept formel est une réponse à Frege, mais le premier des interlocuteurs est évidemment Russell. On trouve ce dernier d’abord dans un débat autour de la délimitation du domaine de sens qu’il fait dépendre d’une fonction universellement quantifiée de la vérité d’une autre fonction, affirmant qu’il n’y a pas d’autres instances de la fonction propositionnelle que celles contenues dans le domaine de sens, ce qui revient au fond à confondre les deux sortes de généralités. Cela veut dire que la clôture du domaine de sens de la fonction dépend de la valeur de vérité d’une proposition générale spécifique, qui affirme qu’il n’y a pas d’autres instances de la fonction que celles qui sont contenues dans ce domaine. Cela est tout à fait passionnant quant à la compréhension de ce que fait Wittgenstein car ce qui vient d’être dit se trouve aux antipodes de Wittgenstein pour lequel, que le monde soit déterminé par les faits dont il se compose, ne dépend pas de la valeur de vérité d’une proposition générale spécifique prenant pour objet la totalité des valeurs de la fonction propositionnelle. Tous les faits, pour Wittgenstein, sont des faits de premier ordre concernant les individus et il n’existe pas pour lui de faits autonomes d’ordre supérieur, ce qui indique précisément le lieu d’une rupture nette avec la théorisation russellienne de la délimitation du sens.
On retrouve Russell dans le cadre de la théorie des types, notamment en 3. 33 dans le Tractatus, dont traite Sébastien Gandon au sein du collectif. Toute la difficulté est de comprendre à quel moment de la pensée de Russell s’oppose Wittgenstein ; en 1910, les conceptions de Russell sont encore mouvantes, et rendent délicate la compréhension du différend ; « nous aimerions explorer ici, écrit Gandon, l’idée que 3. 33 sq., loin de s’opposer frontalement à la théorie de Russell (laquelle ?), témoigne des tensions et des hésitations internes à la recherche russellienne. »6 Qu’est-ce à dire ? Chez Russell, les contraintes typologiques sont adossées à des considérations sur la réalité ; or, à cette époque, Wittgenstein oppose a posteriori et a priori logique, et est donc amené à refuser l’adossement russellien des contraintes à la réalité. De ce fait, dans la perspective de Wittgenstein, soit les lois typologiques sont des conditions de possibilité du sens, elles sont alors a priori et ne peuvent être justifiées empiriquement, soit elles ont trait à la structure du donné, mais elles sont a posteriori et n’ont rien à voir avec la nature du sens et du logique. Bref, Wittgenstein introduit là une disjonction qui attaque Russell de front. En outre, et c’est là ne fond de l’attaque contre la théorie des types, Russell aurait cru qu’il y avait des combinaisons absurdes de signes (paradoxes) qui nécessitaient des combinaisons particulières, ce qui revenait à dire qu’il y avait des non-sens plus importants que d’autres. « Selon Wittgenstein, écrit Gandon, la simple capacité d’identifier les symboles de notre langue devrait suffire à rendre superflue toute théorie des types. »7
Peut-on voir les choses autrement ? L’interprétation de Landini et Klement, pose que l’affirmation de Wittgenstein selon laquelle dans la syntaxe logique, la signification du signe ne joue aucun rôle, n’est plus une opposition frontale à Russell mais est la reformulation d’une idée qui est au fondement des Principia. « L’affirmation qu’il n’y a qu’un type fondamental de choses trouverait son pendant dans la thèse tractacusienne selon laquelle les propositions sont des combinaisons d’objets (non typologiquement différenciés), et Wittgenstein nous dirait en 3. 33, sq. que la notion de type ne concernerait que des constructions linguistiques, non des choses à proprement parler. Bref, l’auteur du Tractacus pourrait être lu comme un lointain précurseur de l’interprétation radicalement nominaliste des Principia avancée aujourd’hui par Landini et Klement. »8 En outre, l’importance accordée à la forme propositionnelle peut être liée à la priorité accordée chez Russell à la proposition sur la fonction propositionnelle.
La relation à Russell s’avère ainsi infiniment plus complexe qu’il n’y paraissait et l’auteur se trouve comme contraint d’abandonner la lecture de Wittgenstein pour y voir un peu plus clair ; nous sommes ici au cœur de ce qui fait l’ambiguïté de ce recueil, à savoir cette lecture du Tractatus qui invite à quitter le Tractatus pour interroger Russell, Whitehead, et les interprétations classiques de Wittgenstein, ce qui occulte quelque peu le texte même du Traité, et qui ne peut conduire qu’à une indécision finale quant au fait de savoir si, en 3. 33, Wittgenstein critique bel et bien Russell.
On retrouve Russell avec la question du solipsisme, question abordée par Elise Marrou dans un article intitulé « « A somewhat discussion of solipsism. » La réponse de Wittgenstein à Frege » L’auteur de l’article aura à cœur de montrer que Russell fait du solipsisme une doctrine philosophique de grande portée, et qu’il en regrette la sous-évaluation dans laquelle la tradition philosophique l’a maintenu. Cela ne signifie pas que Russell adhère à la thèse solipsiste, mais il décide de prendre une telle thèse au sérieux et donc de la combattre philosophiquement, en posant la question redoutable : comment connaître au-delà de l’expérience privée ? La connaissance par description vient élargir et déplacer les limites imposées par la connaissance par acquaintance. Nous sommes en effet coupés de ce avec quoi les autres sont en acquaintance et la connaissance par description est un pis-aller. « La connaissance par description étend la portée de la connaissance par acquaintance tout en y reconduisant : c’est là le sens de la solidarité que Russell établit entre l’acquaintance comprise dans sa primauté cognitive (toutes nos connaissances dépendent de l’acquaintance) et l’acquaintance dans sa primauté sémantique (toute proposition que nous comprenons doit être composée de constituants avec lesquels nous sommes en acquaintance). »9 Par cette connaissance par description, Russell contourne le problème : il ouvre la possibilité d’une connaissance indirecte, et libère la possibilité d’une connaissance indirecte des autres esprits. « La connaissance par description s’offre par conséquent à la fois comme la réponse russellienne au solipsisme et comme ce qui ne peut combler définitivement l’inquiétude sceptique. »10
C : Wittgenstein en dialogue 2 : Frege
Comme nous l’avons déjà aperçu, Wittgenstein ne se contente pas d’entretenir un dialogue plus ou moins explicite avec Russell, il le complète fort souvent avec Frege, dont nous avons vu combien le problème des concepts formels constituait une réponse à ce dernier.
L’ensemble du collectif tend à montrer que Wittgenstein accomplit un progrès réel vis-à-vis de Frege, cela est très net avec l’article de J. Bouveresse, reprenant les analyses du concept formel, afin de montrer combien le problème avait échappé à Frege. Rappelons les termes du débat : le concept cheval n’est pas un concept, ce qui pose problème à Wittgenstein mais pas à Frege ; aux yeux de Bouveresse, si cette question ne traumatise pas Frege tant que cela, c’est qu’il n’a jamais été tenté de considérer que la nécessité de recourir à un mode d’expression approximatif, métaphorique, imposait de conclure que la nature des choses concernées n’est pas et ne peut pas être réellement comprise. Bref, on ne peut pas indiquer pour une définition ce qu’est une fonction. Un commentaire explicatif suffit. Ce qui demeure déconcertant, c’est que le concept cheval n’est pas un concept alors que la ville de Berlin est une ville et le volcan Vésuve un volcan. Frege, toujours selon Bouveresse, n’a pas pris toute la dimension du drame philosophique qui se joue dans ces remarques élémentaires, car il ne distingue pas, comme le fera Wittgenstein, les concepts formels des concepts matériels. « L’univers frégéen des objets, écrit Bouveresse, est un univers complètement homogène. Il ne comporte ni stratification dans le sens vertical ni compartimentation dans le sens horizontal. »11
La question du solipsisme se pose également chez Frege : ce dernier affirme que, tant que l’on ne distingue pas suffisamment la logique de la psychologie, on sombre dans le solipsisme. Contrairement à Russell, Frege ne fait pas du solipsisme une objection sérieuse à la connaissance ou au sens, il n’en fait que le produit d’une confusion élémentaire, d’une insuffisante distinction des domaines. Wittgenstein considère fort logiquement que les attaques de Frege sont trop faibles, relèvent plus de l’humeur que de l’argumentation vraiment philosophique, affirme Elise Marrou ce qui, une fois de plus, tend à abaisser Frege au profit de Wittgenstein ; redisons-le clairement : il y a clairement au sein de ce collectif une nette tendance à dévaloriser Frege, lequel est souvent présenté comme quelqu’un qui n’aurait pas perçu la gravité de certains problèmes, ou qui n’aurait pas su procéder aux distinctions essentielles que nécessitaient ses recherches. A l’encontre, donc, de Frege, Wittgenstein essaiera de sauver une part de vérité du solipsisme dont il nous faut préciser la teneur. « La part de vérité du solipsisme réside donc selon nous [Elise Marrou] pour Wittgenstein dans l’affirmation que la pensée et le monde ne sont pas des entités indépendantes dont il faudrait assurer la correspondance ou la conformité. Mais le solipsiste l’affirme en se prévalant d’une clause d’appropriation qui est superflue : en affirmant que les limites de mon langage sont les limites de mon monde, je n’affirme rien de plus que les limites du langage sont les limites du monde. »12 Si le solipsisme est correct, affirme Wittgenstein, ce n’est pas comme intuition mais au sens où, « voulant formuler le caractère interne de la relation qui unit le langage au monde, le solipsiste en présuppose une vue from sideways on et par là, présuppose exactement ce qu’il entendait récuser. »13
Conclusion : un titre décidément trompeur
Ce collectif est évidemment d’excellente tenue, mais il ne nous semble pas répondre précisément à ce qu’annonce le titre : encore une fois, il s’agit moins d’une lecture du Tractatus qui viserait à en clarifier le sens que d’une discussion savante, mobilisant un très grand nombre d’interprètes, occultant parfois le sens même du Traité au profit de débats herméneutiques qui n’aident guère à accroître la compréhension de Wittgenstein. Il s’agit donc pleinement d’un ouvrage introduisant au « conflit des interprétations », et perdant parfois un peu de vue Wittgenstein lui-même, ce qui peut être décevant quand on propose une lecture de l’auteur en titre. Le dernier article du recueil, celui de Sandra Laugier, quoiqu’à la fois fort clair et passionnant, condense toute l’ambiguïté de ce collectif : mobilisant Cavell, Granger, et bien d’autres, l’article réside bien davantage dans une discussion de l’interprétation dite orthodoxe – celle voulant que, pour délimiter le sens, il faille déjà avoir un pied dans le non-sens –, que dans une discussion de Wittgenstein lui-même ; cela ne signifie pas, bien sûr, que le Tractatus soit perdu de vue, mais à force de vouloir se référer à la littérature secondaire en premier lieu, se crée une exégèse encombrante et occultante, ayant pour effet de brouiller l’objet du discours.
Le problème des lectures orthodoxes, explique fort bien Sandra Laugier, est qu’elles posent l’idée que certaines propositions métaphysiques expriment dans le langage ce qui ne peut qu’être montré, produisant donc du non-sens, mais « un non-sens intéressant ou utile »14 Contre cela, Mme Laugier invite à renoncer à un point de vue transcendant sur le langage, sous peine de mésinterpréter le Tractatus. On délimite certes l’expression de pensée, « mais c’est à une limitation interne que veut nous éduquer Wittgenstein et qui constitue la thérapeutique du Tractatus. »15 Passionnante explication de texte ici proposée ; mais pourquoi aussitôt après brouiller les cartes en quittant Wittgenstein pour rejoindre Carnap et Heidegger, alors même le projet collectif consiste à lire Wittgenstein ? Le titre nous paraît définitivement mal choisi.
- Christiane Chauviré (éd.) : Lire le Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, Vrin, 2009
- Ludovic Soutif, in Christiane Chauviré, op. cit. p. 23
- Ibid. p. 25
- Ibid. pp. 35-36
- Bouveresse, in Chauviré, op. cit. p. 82
- Ibid. p. 92
- Ibid. p. 98
- Ibid. p. 107
- Marrou, in Chauviré, op. cit. p. 198
- Ibid. p. 199
- Bouveresse, in Chauviré, op. cit. p. 82
- Marrou, in Chauviré, op. cit. p. 211
- Ibid. p. 212
- Laugier, in Chauviré, op. cit. p. 251
- Ibid. p. 253







